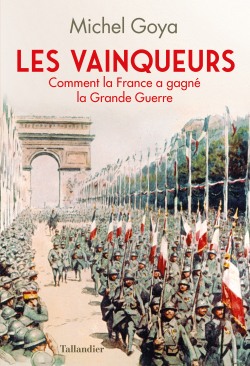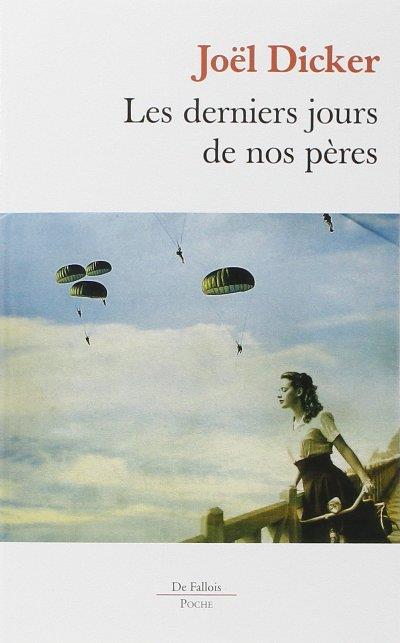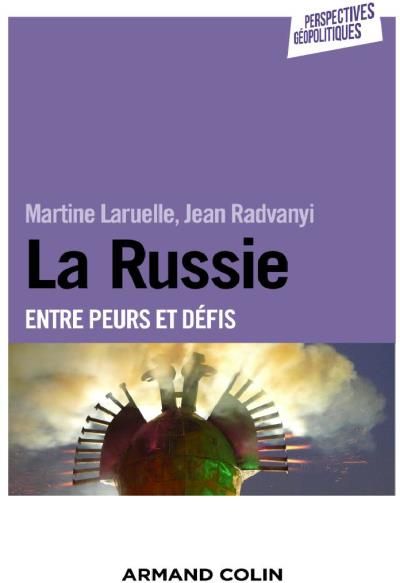Biographie de Eric Anceau.

L’inconvénient d’un pays qui place au pinacle ses écrivains, c’est que ces derniers obtiennent la capacité d’obscurcir la manière dont est faire l’histoire. Ainsi, le mot de V. Hugo sur Napoléon III, affligé de l’épithète de « le Petit ». La déception de ne pas être devenu ministre de l’exilé de Jersey et Guernesey a donc influencé profondément la manière dont on a vu, pendant des décennies, les 23 années de la présidence et du règne de Napoléon III. La Troisième République, née de la défaite de Sedan, n’allait bien entendu pas avaliser les choix de l’empereur, qui pourtant était bien plus socialiste qu’eux. Avec les Trente Glorieuses et en 1958 le retour d’un pouvoir approchant le bonapartisme, la vision de l’action du premier président et du dernier empereur français commence à changer. Les études faites par les étrangers commencent aussi à infuser dans les cercles universitaires français au point que, en 2019, on reparle du projet déjà ancien de rapatrier les cendres de la famille impériale depuis l’Angleterre. Une considération dont ne bénéficient pas les autres souverains exilés …
La biographie commence de manière attendue par l’environnement familial de Louis-Napoléon Bonaparte, né Charles-Louis de Hollande en 1808. Fils de Louis Bonaparte et de Hortense de Beauharnais, il est le neveu l’un des neveux de Napoléon Ier mais aussi le petit-fils de l’impératrice Joséphine. En 1815, il part vivre avec sa mère à Arenberg, au bord du Lac de Constance. Avec son frère aîné Napoléon-Louis il s’engage pour l’unité italienne mais sans appartenir à la société secrète de la Charbonnerie (son frère décède en Italie en 1831). Officier dans l’armée suisse, il se passionne pour l’artillerie et écrit un manuel qui connaît le succès. Avec la mort de Napoléon II et de son frère aîné, il devient le prétendant impérial et tente une première fois de prendre le pouvoir au travers de la tentative de coup d’Etat de Strasbourg en 1836. L’échec le conduit à voyager aux Etats-Unis puis en Angleterre. De l’Angleterre, Louis-Napoléon retente sa chance en 1840 en débarquant à Boulogne, projetant d’entraîner la garnison locale à sa suite. Nouvel échec. Il est cette fois-ci enfermé au fort de Ham, une détention qui lui permet de beaucoup lire, d’écrire (il est l’auteur de nombreux livres et brochures tout au long de sa vie) et de rencontrer de nombreux visiteurs. Après s’être échappé grâce à un déguisement, il retourne en Angleterre en mai 1846 via la Belgique. La fin de la monarchie de Juillet au printemps 1848 lui permet de revenir en France et il est plusieurs fois élu député. Le 10 décembre 1848, il est élu président de la République, le premier de l’histoire des républiques françaises.
Mais l’opposition est telle entre la Chambre des Députés et la présidence que cela ne peut se régler que par un coup d’Etat, venant d’un côté ou de l’autre. Louis-Napoléon prend l’initiative et le 2 décembre 1851, il s’institue dictateur avant, exactement un an plus tard de proclamer l’Empire au travers d’un plébiscite. Chef de l’Etat et en même temps chef du gouvernement, les ministres ne sont responsables que devant lui. Le Corps législatif n’est cependant pas fermé à une opposition, néanmoins très réduite par le système de la candidature officielle. L’empire use de censure et de répression que peu de temps et de nombreux exilés de 1852 rentrent dans les années qui suivent. Le régime ne se veut pas libéral mais veut réglementer l’industrialisation qui s’accélère dans le pays. Canaux, voies ferrées et usines se multiplient. A partir de 1859, l’empereur apporte des modifications constitutionnelles qui donnent de plus en plus de liberté aux élus, ouvrant ainsi la période dite de l’empire libéral. Cela va si loin qu’en 1870, l’empire est une monarchie constitutionnelle avec à la tête du gouvernement (et au grand déplaisir des soutiens napoléoniens de la première heure) le républicain E. Ollivier. Conscient du danger de la Prusse après la bataille de Sadowa en 1866, l’empereur ne parvient cependant pas à faire passer sa réforme militaire laissant l’armée dans un état pour le moins insatisfaisant (un second Empire sans la contrainte des dictatures et sans la force du sacrifice patriotique des gouvernements libéraux p. 57), comme le montre la guerre franco-allemande de 1870. Malade, l’empereur est pourtant contraint de commander l’armée, après le fiasco de la déclaration de guerre et son enchaînement d’incompétences. Défait à Sedan, il capitule et part pour Cassel comme prisonnier de guerre. A la fin de la guerre, plus utile à Bismarck comme prisonnier et ne pouvant (pour le moment pense-t-il) rentrer à Paris, il retourne une nouvelle fois en Angleterre où l’attendent déjà l’impératrice Eugénie (épousée en 1853) et son fils le Prince impérial (né en 1856). Il meurt en Angleterre en 1873, après une longue maladie de la pierre.
Cette biographie est une biographie à l’ancienne comme le dit expressément l’auteur (et donc n’est pas le prétexte pour brosser un tableau bien plus large comme l’a fait S. Kracauer avec sa biographie de J. Offenbach). Le contexte n’est évidemment pas absent (E. Anceau parle de personnes de leur temps) mais on reste concentré sur Napoléon III. Les 600 pages que compte cet ouvrage sont d’une grande clarté tout en ne faisant pas de concession à la facilité historique, avec de très nombreuses notes. Certaines choses sont bien connues du public et ne seront pas des nouveautés pour le elcteur déjà un peu renseigné. Comme par exemple l’intérêt de l’empereur pour l’archéologie et pour Jules César (dont il écrit une biographie avec l’aide d’historiens professionnels). Mais d’autres éléments permettent une mise à jour motivée scientifiquement. Ainsi, si l’impératrice soutenait un parti catholique ultramontain, elle n’était pas bigote et très engagée pour la scolarité des filles (p 231). D’autres volontés politiques ou réalisation ont été oubliée ou escamotées par la propagande républicaine de l’après 1870. Napoléon III souhaitait la création d’un royaume arabe en Algérie ( avec nationalité française p. 415), a autorisé les syndicats, veut l’abolition du livret ouvrier (p. 461), envisage l’intéressement des mineurs aux bénéfices des mines (p. 483) et souhaitait déjà une école obligatoire et gratuite (p. 425). Napoléon III avait une vision stratégique planétaire (p. 272-273), une patience et une ténacité farouche dans la conduite des réformes qu’il voulait mener (des reculs tactiques, pas des abandons), guidé par une pensée saint-simonienne véritable, un intérêt dès son plus jeune âge pour le droit des peuples et les classes laborieuses (il fustige ceux qui s’indignent d’iniquités au loin et restent sans pitié pour celui qui souffre sous le même toit p. 263), un libéralisme contrôlé et progressif, que ce soit économiquement comme politiquement. Malgré les insistances de tous bords, le suffrage universel n’a jamais été remis en question.
Le XIXe siècle apparaît pleinement dans ce livre comme une période charnière, où l’esprit de la Révolution se diffuse encore longtemps et peut atteindre tous les recoins du droit et des pratiques étatiques de manière différée. Le siècle de l’industrialisation est aussi celui qui ne considère pas encore comme impossible l’achat d’un pays (comme le Luxembourg en 1860, tandis que le canton de Neuchâtel était encore possession prussienne jusqu’en 1856). Des monarchies constitutionnelles qui ont des politiques dynastiques partout en Europe …
Tout est-il parfait avec un livre aussi solidement documenté ? L’auteur se trompe par exemple en disant que la visite de la reine Victoria est la première visite d’un souverain britannique en France depuis la Guerre de Cent Ans, alors que le Camp du Drap d’Or a lieu en 1520 (p. 283). On peut aussi critiquer le lien mécanique que voit E. Anceau entre incompétence tactique et stratégique et le fait pour un officier de sortir du rang (p. 510). Mais ses comparaisons avec N. Sarkozy sont bien senties (le livre est paru en 2008) dans un épilogue qui forme un résumé de tout premier ordre. On est plus que très nettement dans le positif.
(Haussmann en Haussmann/Osman Pacha ou « les comptes d’Haussmann », la critique pouvait être inventive p. 465/467 …7,5)