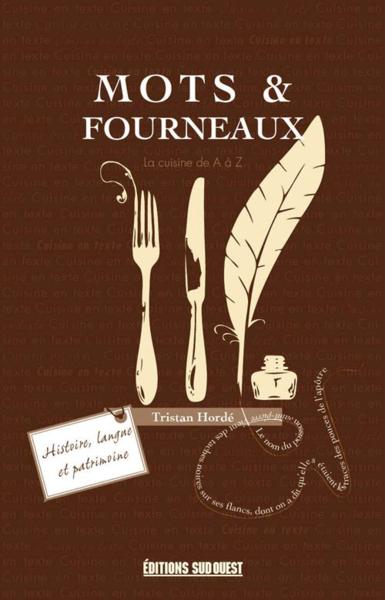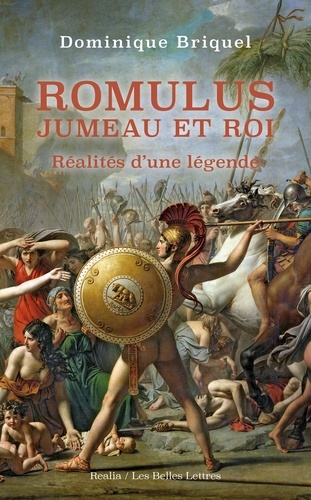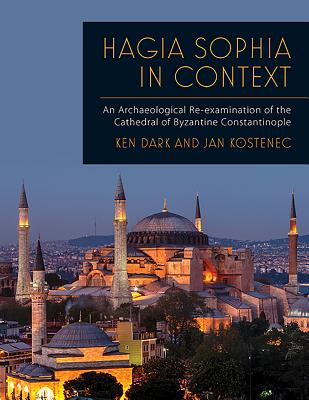Magic and Mind in Late Iron Age Scandinavia
Essai d’archéologie viking de Neil Price.

Rien n’est certain sauf le loup et le Ragnarǫk. p. 328
Si la mythologie nordique bénéficie d’une connaissance superficielle mais large au sein de la culture populaire européenne (bien aidée en cela par les nombreuses productions artistiques qui la prennent pour source d’inspiration), la question de la religion des habitants de la Scandinavie au Haut Moyen-Age est restée bien en retrait. Et pour cause : hors l’importance du sacrifice, il est peu de choses certaines. Temples, espace sacré au sein d’une exploitation agricole aristocratique, bosquet ou lac sacrés ? La question des lieux et des possibles évolutions ou particularités locales est encore très débattue (mais le débat se tourne actuellement vers la solution de lieux multifonctionnels, p. 31). Il en est de même des pratiques et des croyances. Comme il apparaît peu probable que les auteurs des sagas du milieu du Moyen-Age aient recopié mot à mot des sources écrites plus anciennes, ces mêmes sagas ne peuvent rendre compte sans critique et à elles seules de l’état des croyances lors de la période de la colonisation viking (VIIIe-XIe siècles). C’est là qu’intervient l’archéologie, qui chez N. Price vient établir un dialogue avec les sources textuelles quand cela est possible. Chez l’auteur britannique (qui enseigne à Uppsala), la religion ce n’est pas que le culte « officiel » aux dieux et aux esprits (ce qui serait trop dépendant d’une Weltanschauung chrétienne contemporaine) mais aussi tout le monde supranaturel dans lequel baigne le Scandinave des deux sexes au Haut Moyen-Age. Le moyen pour les Humains d’agir sur le monde, au travers des forces supranaturelles, c’est la magie, le seiðr, et dont les grands-maîtres sont Freya et Odin.
Le présent livre étant l’édition d’une thèse de doctorat parue en 2002 (mais dans la version augmentée de 2019), il ne s’adresse pas à un public très large et démarre assez classiquement par des considérations méthodologiques. Dans la grande tradition britannique, cette partie méthodo-philosophique est très maîtrisée (avec une histoire des courants historiographiques et comment l’auteur se place par rapport à eux) et aboutit à un deuxième chapitre qui se concentre plus spécifiquement sur les problèmes que rencontre l’étude de la sorcellerie norroise et en premier lieu l’absence de système. N. Price détaille aussi la composition de la « population invisible » de la Scandinavie au-delà des dieux eux-mêmes (p. 27), qu’ils soient servants des dieux (corbeaux, boucs etc.), les Nornes, les géants, les elfes, les nains, les ogres et les trolls, les esprits gardiens de lieux, le Cauchemar et les projections de l’esprit humain. Puis l’auteur va plus loin dans la description des différents types de magie : le seiðr à proprement parler (lié à l’esprit et à l’invocation), le galdr (parlé, chanté, lié à la malédiction), le gandr (lié à l’énergie du chaos primordial), l’útiseta (être assis à l’extérieur, souvent sous un pendu, près d’une tombe ou d’une eau courante), la sorcellerie dite odinnique (propre à Odin aux dires des sources) et enfin une magie à bas bruit (littéraire). Une fois les termes définis, N. Price passe aux sources littéraires avant de consacrer plusieurs pages à l’historiographie du sujet et notamment les relations entre l’histoire des religions et l’ethnologie, ou comment l’idée de chamanisme fait son apparition dans l’étude des croyances des habitants non-Lapons de la Scandinavie haut-médiévale.
Le chapitre suivant va au cœur du problème en étudiant de manière ordonnée la magie chez les Vikings. A tout seigneur tout honneur, Odin ouvre le bal (actions, noms), suivi de Freya puis des acteurs humains de la magie, hommes et femmes. Et ces acteurs sont parfois inhumés, et certaines de leurs tombes ont peut-être été déjà fouillées. L’auteur propose plusieurs tombes au lecteur qu’il pense être celles de praticiens (Birka, Klinta, Fyrkat, Kaupang, Gausel, Ile de Man, Oseberg). Pour chaque cas, la fouille, le site et la tombe sont analysés de manière très serrée. Puis N. Price s’intéresse à d’autres artefacts qui peuvent marquer la pratique de la magie : des masques, des tambours, des boucliers, des charmes, des narcotiques et bien sûr des baquettes (en métal ou en bois, très en détail). Les chants et la transe ne prennent pas beaucoup de place dans le développement, beaucoup moins que la question très complexe du genre des pratiquants : même si Odin (dieu roi et guerrier) est le patron des magiciens, les hommes qui pratiquent sont vus comme efféminés, une qualification très invalidante dans la société viking. Ce que l’auteur élargit en considérant le lien entre magie, érotisme et pratique sexuelle (p. 177). La fin du chapitre est centrée sur les champs d’application dits « domestiques » de la magie (non guerriers, c’est-à-dire la météorologie, la guérison ou l’envoi de maladie, la divination etc.).
Le quatrième chapitre n’est pas un contrepoint, c’est l’argument central de la démonstration de l’auteur. En analysant de la même façon le chamanisme lapon, il appuie sur leur proximité, voire leur identité. Le chapitre débute par une actualisation des aires de peuplement lapons (culture Sami), qui commençaient bien plus au sud qu’aujourd’hui. Il y a très clairement un entremêlement entre les deux cultures, norroise et sami, dans ce qui est aujourd’hui la Norvège et la Suède. La cosmogonie sami, son monde invisible, l’onomastique et les sources sont décrites par l’auteur, avant de passer aux rituels et aux matérialisations de ces mêmes rituels (tambours, mailloches, pointeurs) pour enfin finir sur les caractéristiques de la magie lapone (noaidevuohta) : fonctions et champs sont les mêmes que la magie norroise.
Le chapitre suivant quitte en grande partie le Nord de l’Europe pour comparer d’autres religions circumpolaires et le chamanisme norrois. En Russie, les premiers textes sur le sujet datent du milieu du XVIIe siècle (p. 231). Mais l’exploration ne se limite pas à la Sibérie et le lecteur voyage tout de même beaucoup : Mongolie, Côte Nord-Ouest américaine et Canada intérieur. Puis N. Price revient en Scandinavie et s’attaque à la question du seiðr avant les Vikings (p. 260) et comment il faut comprendre le chamanisme en contexte norrois (Sleipnir et Loki, p. 266-268).
Le versant « domestique » de la magie ayant principalement été l’objet de l’essai jusqu’à présent, l’auteur passe maintenant à la face guerrière (sixième chapitre). Et la guerre est très présente dans un monde fait de petites chefferies n’ayant pas encore de royaume au-dessus d’eux … N. Price précise d’abord la figure de la valkyrie qu’il avait laissé de côté dans le premier chapitre, puis enchaîne sur la réalité des femmes combattantes (ce dont nous aurons à l’avenir encore à discuter …) avant de revenir sur les sources et l’onomastique entourant cette figure accueillant les combattants choisis dans la halle d’Odin pour y attendre le combat dernier. Le chapitre se poursuit avec les différentes sortes de magie utilisées lors de batailles selon la littérature et les acteurs (guerriers, sorciers) de ces sorts. La question du change-forme est bien entendue traitée elle-aussi, plus en largeur (p. 301) avec les berserkir (ours) et les ulfheðnar. Constantin Porphyrogénète, empereur byzantin, relate lui-même une cérémonie norroise avec des guerriers masqués et revêtues de peaux à laquelle il a assisté (p. 307), mais des pierres runiques et d’autres artefacts de plus petites tailles sont aussi analysés. La encore, l’extase, l’effet psychique de la violence de masse (avec une comparaison faite avec ce que dit Homère p. 315) sont évoqués comme un renversement intéressant concernant la Scandinavie : là où d’autres cultures animalisent l’ennemi, les norrois eux se transforment en prédateurs (avec un aspect sacrificiel à Odin ?).
L’avant-dernier chapitre forme la conclusion de la première édition. Il revient sur quelques points mais l’auteur se permet aussi une petite évocation qui n’est pas sans qualités littéraires (notre exergue), puis ce très court chapitre se clôt avec quelques ouvertures et une explication des origines des petites histoires qui ont ouvert ce livre.
Le dernier chapitre est une postface. Tous les autres chapitres ont été remaniés et augmentés pour la seconde édition mais le dernier chapitre est quant à lui entièrement neuf. Il fait le point sur la réception du livre au début du XXIe siècle, sur son influence, et l’auteur prend beaucoup de temps pour répondre aux critiques ou préciser un point après un développement inattendu ou inconnu (le bâton de sorcière vu comme quenouille et la projection filaire de l’âme p. 339). Le texte prend fin sur quelques ouvertures de pistes supplémentaires et une mise au point finale sur sa vision des Vikings : ce ne sont pas des héros romantiques.
Avec un tel livre, la couverture ne se referme pas avant d’avoir sous les yeux une bibliographie très conséquente (sur à peine 42 pages …) et un index (qui n’est pas sans manques).
Ce livre n’a aucune prétention à la vulgarisation. Et s’il est quelques passages qui souhaitent faire une présentation cosmogonique, elle tourne court très vite, ou plus précisément, elle devient unidirectionnelle. Et même pour ceux déjà un peu versés dans le Nord ancien, tout ne roule pas comme sur des roulettes. Les chapitres sur le chamanisme lapon et circumpolaire sont particulièrement âpres et le train ne passe pas deux fois … Sans parler du fait qu’il faut attendre la p. 84 pour que démarre la partie archéologique, ce qui peut rebuter un lecteur non préparé. La contrepartie, c’est la qualité et le foisonnement. L’expérience du terrain se sent très bien, systématisée avec le temps, et qui s’ajoute à de nombreuses autres qualités (linguistiques notamment mais aussi de modestie et d’honnêteté intellectuelle). Le mariage entre sources littéraires et archéologique est un modèle du genre et rencontre notre vision de ce que l’on pourrait faire dans d’autres aires géographiques. La très haute qualité des analyses est servie par des illustrations nombreuses et les vues d’artistes des tombes étudiées sont époustouflantes (exécutées par l’islandais Ƿórhallur Ƿráinsson). Nous avons pendant la lecture (très convaincante) pu nous faire beaucoup de remarques qui ne peuvent de très loin pas toutes figurer ici. Certaines ont attrait à l’Italie antique, quand par exemple la tête coupée de Mimir est analysée comme un masque (p. 60) et que l’on pourrait comparer aux têtes coupées divinatrices étrusques ou encore ces vélites romains p. 310 liés aux loups comme les ulfheðnar (une confrérie indo-europénne de jeunes hommes ?). D’autres évoquent quelques imprécisions quand l’auteur s’aventure hors du domaine septentrional, mais rien de méchant (mais le nazisme de E. Jünger est plus que discuté, malgré ce que laisse penser la p. 314).
Mais en regard des moments d’excellente science, lumineux, d’étonnement ou même d’effroi que propose ce livre …
(l’auteur remercie des bars et des restaurants à York et Uppsala p. xx … 8 ,5)