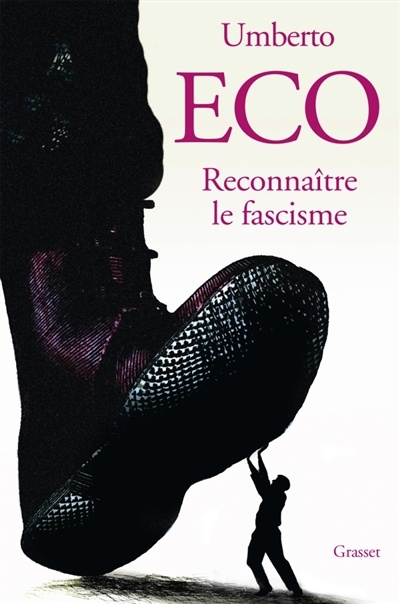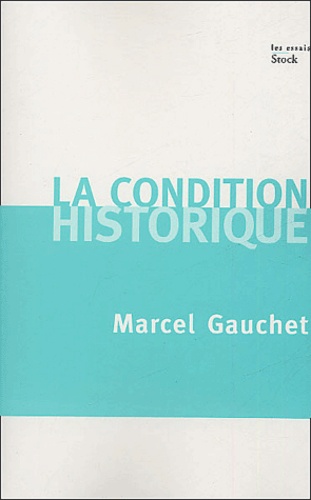La fin de la classe moyenne occidentale
Essai de géographie polémique de Christophe Guilluy.
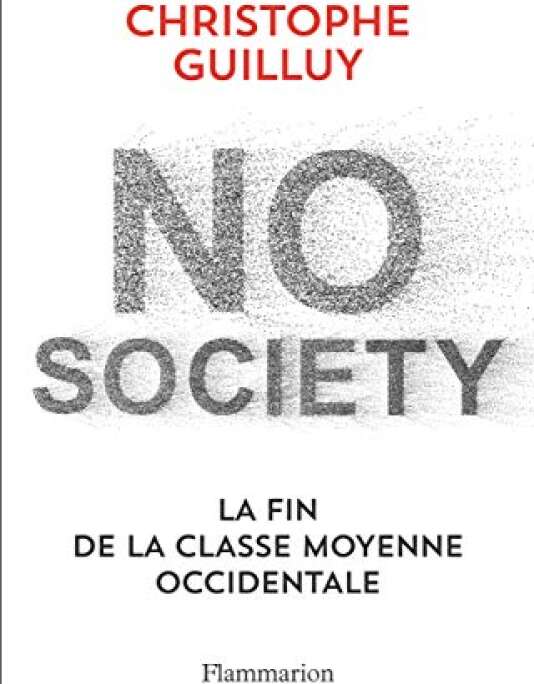
Dans la suite de ces précédents livres, le géographe Christophe Guilluy continue dans cet ouvrage la description géographique d’une société qu’il voit comme au bord de la rupture. Mais ici, on élargit encore l’image. Il n’est plus question de quartiers en déshérence et de campagnes s’enfonçant dans la pauvreté, ni des classes supérieures comme dans les deux précédents ouvrages de l’auteur mais de la classe moyenne. La classe moyenne pour C. Guilluy (qu’il ne définit pas avec autant de précision que Louis Chauvel comme on l’a vu ici), c’est le pivot de la démocratie et la part de la société qui a le plus profité des Trente Glorieuses et de la démocratisation de l’après 1945. Il souhaite démontrer que la classe moyenne s’effondre, se désagrège, grignotée par la précarisation, tandis que les classes supérieures se sont mondialisées et séparées sur reste de la société.
La phrase d’ouverture atteint son objectif : le choc. En reprenant Margaret Thatcher déclarant en 1987 « There is no society », C. Guilluy veut montrer que la sécession des classes supérieures n’est pas une idée du XXIe siècle, tandis que le Premier Ministre britannique voyait plus la nécessité de limiter la redistribution. Mais par la même occasion, il signifie au lecteur que les sociétés sont mortelles, elles aussi avant d’annoncer sa conclusion, moins pessimiste que l’on pourrait le croire après cette première phrase.
Le premier chapitre résume d’une certaine manières la thèse de l’auteur sur les espaces périphériques, français en premier lieu, mais qui peut aussi désigner des territoires en Allemagne ou aux Etats-Unis (p. 33). C. Guilluy décrit aussi la montée du populisme, fruit de la non prise en compte par les élites des intérêts de la majorité que constitue les classes moyennes (occultation ou minimisation p.39). La prise de conscience de ce désintérêt vient de ce que la crise de l’emploi ouvrier, en Lorraine ou dans le Nord par exemple, commencée dans les années 60, a fini par atteindre la classe moyenne : dépeuplement des petites villes rurales, crise commerciale (disparition des commerces en centres-villes), évaporation des services publiques, raréfaction des grands pourvoyeurs d’emplois publiques (caserne, hôpitaux etc.), précarisation. De fait, la classe moyenne occidentale est la seule à ne pas profiter de la croissance mondiale (p. 51).
A l’insécurité économique s’ajoute une insécurité culturelle : la classe moyenne n’est plus la référence culturelle (p. 78). Elles ne sont plus le pôle d’attraction pour les immigrés, surtout parce que personne ne veut intégrer l’équipe des perdants (p. 80-82). Pour l’auteur, il est ainsi paradoxal de se plaindre de la communautarisation quand on a patiemment détruit les conditions de l’intégration en ostracisant le groupe social qui l’assure (ici, Canal + est très nommément visé p. 87). Pour l’auteur, on assiste à une racisation des minorités comme des « petits Blancs », conduisant vers une a-société.
La seconde partie du livre décrit le processus de repli de la bourgeoisie, qui ne se sent plus d’obligations envers le reste de la société. Cette mise a distance sous couvert d’ouverture et « d’antifascisme d’opérette » (p. 125), rêvée par de nombreuses bourgeoisies dans les siècles précédents, a pu se réaliser sans violence (p. 103). C. Guilluy analyse ensuite l’élection de E. Macron comme l’alliance des bourgeoisies de gauche et de droite, en plus des retraités (qui sont ceux qui sont les plus proches de voter ailleurs la prochaine fois), malgré les paradoxes. L’auteur défend son concept de France périphérique (pas synonyme de périphéries) et cite plusieurs fois Christopher Lasch (l’auteur de La révolte des élites). Déjà observable à Londres au moment du Brexit ou à Barcelone, il y a dans les métropoles gentrifiées la tentation de s’ériger en cité-Etat (mais les parallèles de l’auteur avec l’Antiquité sont ici malhabiles, la cité grecque, par exemple, ne se sépare pas de sa campagne). C. Guilluy poursuit ensuite sa démonstration en mettant en relief ce qui pour lui caractérise l’amenuisement de la recherche du bien commun. Et pour l’auteur cela commence avec la mise en état d’impuissance des services publics, une relativisation générale, avec un chaos tranquille, sans révolution grâce à une fuite en avant économique et sociétale caractérisée par l’égoïsme (p. 157).
Dans la troisième et dernière partie, C. Guilluy s’écarte de son sujet de départ pour développer son idée de soft power des classes populaires. Et ce soft power, c’est le populisme ou « la volonté de sortir de la démocratie sans le peuple » (p. 177, citation de J. Julliard). L’auteur avance même que c’est par ce biais la fin de l’hégémonie culturelle du monde d’en haut (dans une comparaison malvenue avec le Heartland géopolitique de H. McKinder p. 187) qui occupe la place laissée vacante par l’amenuisement de la classe moyenne occidentale. Les demandes populistes (parmi lesquelles les frontières te le protectionnisme), plébiscitées par les classes populaires, ont pour but de préserver le collectif (p. 195). Pour l’auteur, cela va à l’encontre du déni des cultures (qui réifie les humains, transportables partout).
Le livre s’achève sur un plaidoyer pour l’intégration. Plus exactement, pour la réintégration des élites dans la société et à reprendre le chemin de l’Histoire, sans un retour à la mendicité pour les classes populaires (p. 231). Il est possible que la métropolisation soit elle-même déjà en crise.
Ce livre, qui navigue on l’a vu entre les sujets (ou plus positivement, veut apporter une conclusion à un cycle) semble avoir été écrit un peu hâtivement. La lecture en est laborieuse, avec des endroits où l’auteur délaye même carrément (p. 39). C’est dommage, puisque l’auteur donne une vision géographique des sociétés occidentales (et française en particulier), une manière d’aborder les choses qui ne se voit pas beaucoup dans l’édition grand public ou les médias. Il y a donc des cartes en cahier central, qui auraient pu être cependant plus grandes. La fougue fait aussi perdre de vue à C. Guilluy certains ordres de grandeur, en qualifiant d’oripeaux les 20% de F. Fillon en 1017 (p. 106). C’est oublier les 19% de J. Chirac en 2002. Il a ensuite été élu.
Mais les critiques que l’on peut formuler sur la forme, assez lourdes, sont rejointes par des erreurs sur le fond, dues à des raccourcis faciles. C’est le cas avec A. Smith p. 122 où l’auteur prétend que la théorie dite du ruissellement est une actualisation de la main invisible du marché. On a déjà vu plus haut que la situation des cités antiques lui était étrangère.
Riche en données, cet ouvrage aurait gagné à bénéficier d’une forme plus aboutie, peut-être moins proche de l’oralité. Il reprend des pistes déjà explorées par l’auteur, qu’il voit confirmées par les élections des années 2016 et 2017 en Occident. Mais est-ce que le mouvement dit des Gilets Jaunes, dans sa diversité, infirme ses thèses ?
(contre le happyendisme p. 37 ! … 6,5)