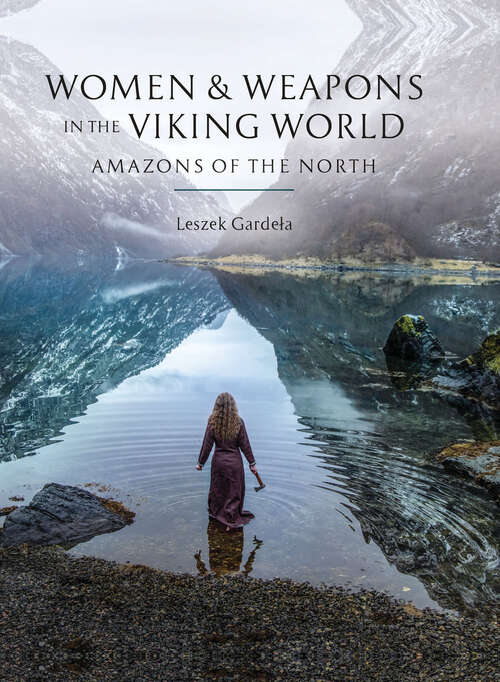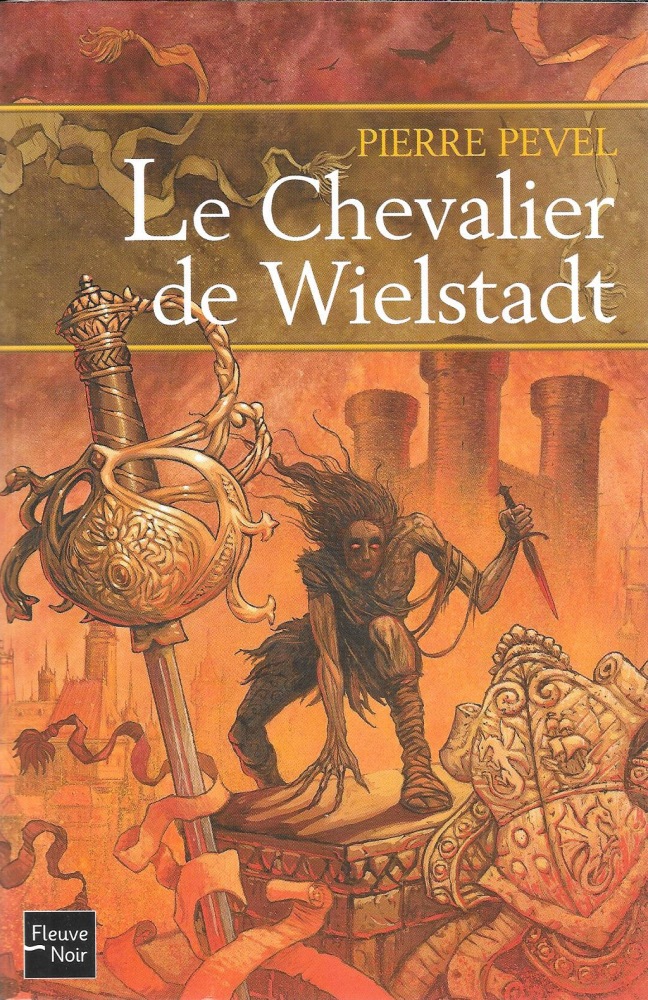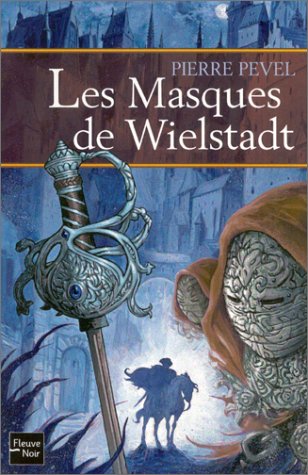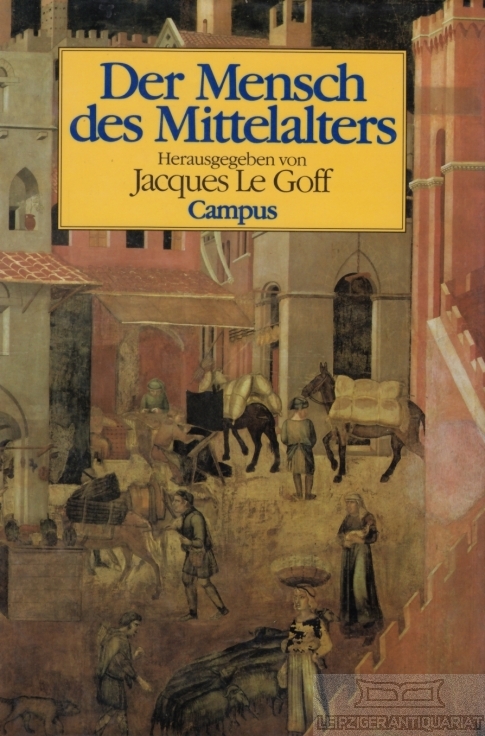Visages du massacre de la Saint-Barthélemy
Essai historique de Jérémie Foa.
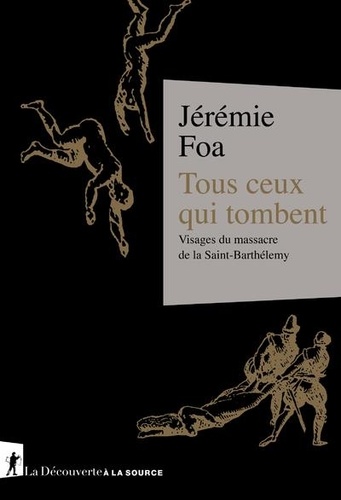
Les huguenots s’estimaient bons citoyens ; les voisins les voulaient vrais fidèles. p. 137
Jérémie Foa fait d’étranges rêves. Il aimerait fouiller sous la Tour Eiffel, ou sous la préfecture à Toulouse. Pour y retrouver les traces des victimes de la Saint Barthélemy, à Paris et dans toute la France, tuées entre août et octobre 1572 et qu’il a côtoyé dans les archives notariales. Parce que leur décès a enclenché la constitution d’actes, pour régler leur succession ou constater leur décès par la déposition de témoins. Mais les notaires enregistrent aussi les inventaires de meurtriers, dévoilant ce que fut leur vie après le 24 août 1572. Loin du roi Charles IX (mais pas forcément loin de la cour royale) ou des tractations avec l’Espagne et l’Angleterre, J. Foa scrute les rues, les ponts et les quais, note les adresses mais surtout met en évidence les relations interpersonnelles de ceux qui y vivent. La grande ville ne rend pas anonyme celui qui y habite. Chacun sait qui sont ses voisins.
Ce livre est composé de 26 chapitres de longueurs variables, aux titres assez souvent cinématographiques. Mais avant cela, il y a un prélude qui donne doublement le ton : il ne sera que très peu question des donneurs d’ordre du massacre et de leurs intentions mais le livre se consacrera à la matérialité du massacre et le texte lui-même s’attachera à atteindre la plus belle tenue littéraire. Les chapitres proposent plusieurs approches. L’un propose de suivre les démarches d’une veuve voulant récupérer ses biens spoliés arguant qu’à la différence de son défunt mari, elle est catholique. Un autre met en lumière tout un groupe de voisins qui déclarent devant notaire qu’untel est catholique et messisant alors qu’il est notoire que cette personne est un huguenot (p. 167 et p. 178, ambivalence des voisins et poids temporaire du papier dans une crise qui est une sortie temporaire de appellations contrôlées). Un autre encore montre que le massacre peut servir de couverture pour l’apurement de contentieux professionnels par voie de tueur à gage (p. 193). Un autre enfin parle d’une réparation pour une blessure causée par une balle perdue … entre miliciens (p. 149).
La milice bourgeoise, justement, est à Paris la cheville ouvrière du massacre (la noblesse venue assister à la noce d’Henri de Navarre et Marguerite de Valois est pour sa part la cible de tueurs de l’entourage des Guises). C’est avant tout un massacre entre voisins, un pogrom entre connaissances. Comme rien dans l’apparence ne peut distinguer un huguenot d’un catholique, c’est la connaissance intime des gens qui permet un classement. Et la milice a pu repérer les tenants de la « nouvelle opinion » depuis des années dans une ville de Paris plus violemment catholique que le roi (la confrérie Sainte-Geneviève comme QG des massacreurs p. 55). Les gens qui sont assassinés à la Saint Barthélemy, leurs corps jetés à la Seine, ont très souvent dans les années précédentes été emprisonnés par la milice, parfois pendant dans des mois (l’auteur fait justement le lien entre les registres d’écrou, le massacre et ceux qui le perpètrent). Ainsi, si la milice a appris à appréhender, connaît les adresses et les visages, les victimes ont aussi appris à laisser passer l’orage et à ouvrir aux représentants de la municipalité qu’ils connaissent. Ce n’est pas une foule emplie de violence aveugle qui agit, ce sont des hommes détenteurs de la force publique qui se connaissent. Le massacre n’a pas été prémédité, il a été préparé (p. 35). Suivent des spoliations massives.
La collection dans laquelle s’inscrit cet ouvrage s’appelle « A la source » et annonce on ne peut plus clairement la ligne directrice du livre. Ce dernier est au plus près des sources, abondamment citées dans le texte mais aussi intelligemment présentées au lecteur (grâce aussi au cahier central avec ses photographies de documents). A cela s’ajoute une ambition littéraire assumée au résultat plaisant (hors peut-être un rare moment p. 125), avec de savoureux archaïsmes très XVIe siècle. L’auteur a de nombreuses cordes à son arc et s’aventure avec à propos dans le champ de la philosophie de l’histoire (p. 124-125 par exemple), mais on sent aussi un intérêt marqué pour de nombreuses autres disciplines des sciences humaines. Enfin, en écrivant sur le passé, J. Foa pense bien évidemment au présent et le lecteur avec lui. Si S. Paty est évoqué (p. 84) comme cas de décapitation d’intellectuel faisant le pendant à celle du philosophe Ramus lors de la Saint Bathélemy, le lecteur quant à lui peut vite faire un rapprochement, hélas non exclusif, avec le génocide du Rouanda. L’auteur exprime -t-il l’envie de croire en une rétribution divine en fin d’ouvrage ? La question reste ouverte mais c’est indéniablement un livre qui donne envie d’être historien et aurait toute sa place dans un cursus universitaire dans une unité de méthodologie.
Et pendant le massacre, la vie normale continue chez les notaires …
(Bon le titre fait un peu film français moqué par les Guignols … 8,5)