Essai d’histoire des sciences et d’histoire locale de Paul-André Rosental.
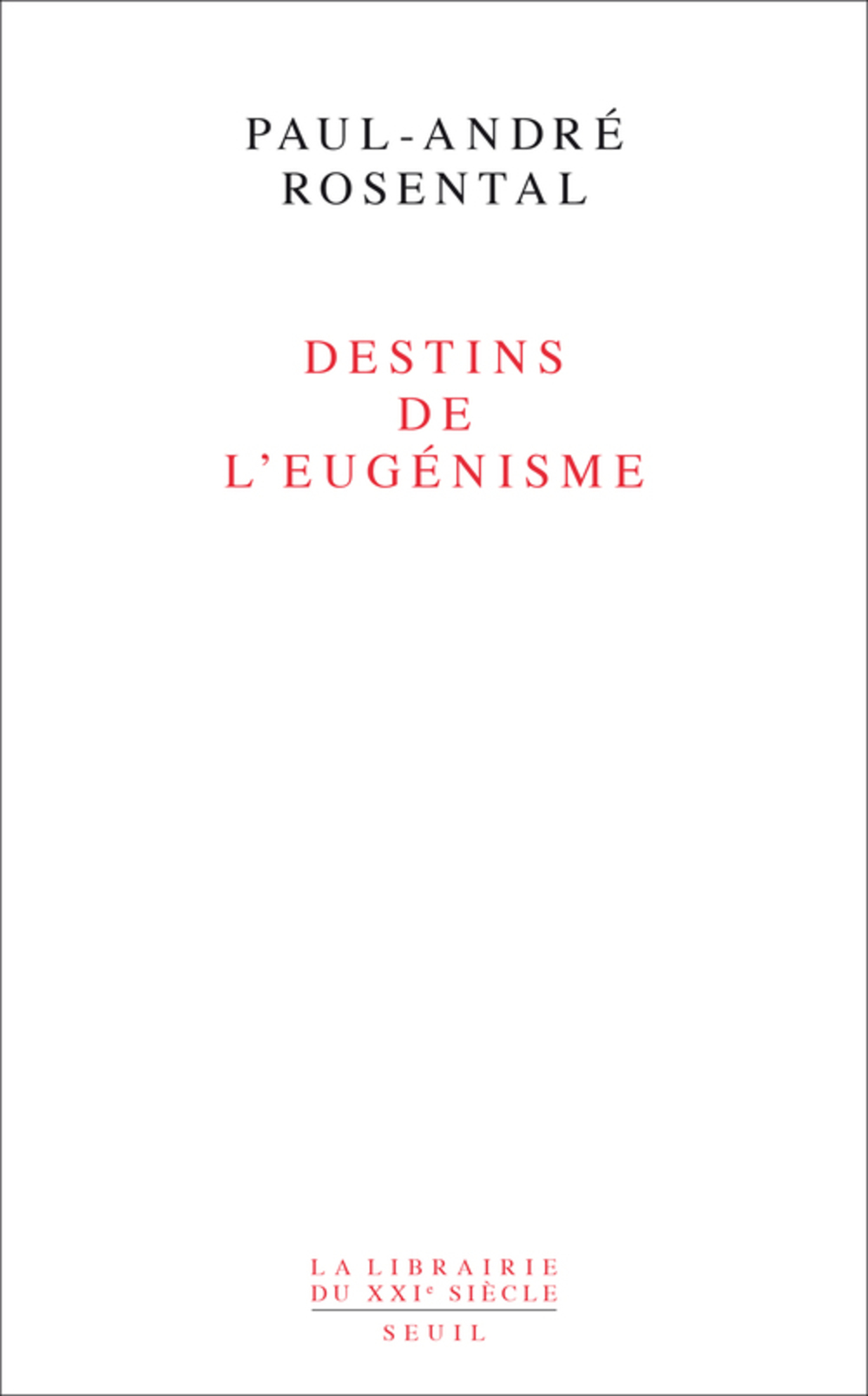
Comme la psychologie de Spencer, la sociologie de Comte, la démographie de Guillard et Bertillon, l’histoire naturelle de Darwin (ou la sociologie de Durkheim juste après …), l’eugénisme ne se définissait pas comme une science mais comme la science. p. 540
Un projet eugéniste, en France, jusqu’à la moitié des années 80, voilà un fait qui soulève immédiatement l’intérêt, tant l’eugénisme est aujourd’hui uniquement associé à une politique d’éradication d’individus qualifiés d’inférieurs, corrupteurs ou inutiles. Et autant dire que la curiosité ainsi créée est très amplement récompensée par plus de 500 pages d’un texte très riche, excellemment construit et méthodologiquement à la pointe. Son auteur, Paul-André Rosental cherche et enseigne à Paris (IEP et INED) et prend pour point de départ la cité-jardin Ungemach, aujourd’hui au pied du Parlement Européen à Strasbourg, alternant les angles et les focales, pour d’écrire l’influence des idées eugénistes entre la fin du XIXe siècle et le début du XXIe.
Le ton est donné dès l’introduction (plutôt personnelle), qui non seulement décrit la découverte à l’origine du livre mais plante aussi le décor historiographique, analysant les conséquences sur les sources de la réception des théories eugénistes (en France et en Allemagne). L’auteur détaille aussi dans l’introduction l’évolution des perceptions du public face aux théories eugénistes, qui ne se limitant pas à la stérilisation et à l’éradication, mais visent l’amélioration de l’Humanité par des moyens plus positifs (eugénisme négatif et positif, p. 26). Les effets de génération parmi les chercheurs en eugénisme sont particulièrement nets, et l’eugénisme n’est pas vu de manière totalement négative après 1945.
Passé l’introduction, l’ouvrage s’organise en quatre parties. La première analyse « l’expérience Ungemach » comme un laboratoire humain. La cité-jardin, composée d’une quarantaine de pavillons à l’origine et conçue par l’architecte Paul de Rutté (spécialiste de l’architecture de style régionaliste), ouvre en 1920. Pas moins de 292 familles se sont portées candidates. Candidates, car pour obtenir un logement dans la cité, il faut satisfaire à un certain nombre de critères édictés par la Fondation qui est maître d’œuvre (le questionnaire change très marginalement entre 1920 et 1985). Ne sont acceptés que des couples jeunes, mariés de peu et appartenant aux classes moyennes (ceux qui ont les clefs de l’avenir de part leur éducation et leur dynamisme selon la vision de l’homme dernière ce projet, Alfred Dachert), afin de leur permettre de faire des enfants. Et si ces derniers ne font pas vite leur apparition, les couples sont dans l’obligation de quitter leur logement. De plus, la future mère de famille doit être femme au foyer, ce dernier pouvant comprendre ni domestiques, ni d’autres adultes ayant des liens familiaux avec le couple locataire. En contrepartie, le loyer est moindre que dans le reste de la ville et la Fondation offre de nombreux avantages en nature et en services à ses locataires. La Fondation n’agit pas seule. Elle bénéficie du soutien de la Ville et en premier lieux du maire, Jacques Peirotes), qui s’est engagée à reprendre la Fondation, ses biens et ses objectifs, en 1950.
La seconde partie (en cinq chapitres et trois intermèdes) se concentre sur la personnalité du directeur de la Fondation Ungemach, Alfred Dachert. Sa carrière dans la confiserie est retracée, tout comme est reconstirué son univers mental, dans un monde où l’on n’attend pas de l’Etat qu’il s’occupe d’amélioration sociale mais où la force agissante dans ce domaine est l’apanage des villes (p. 81). P.-A. Rosental analyse le scientisme à l’origine de « l’expérience Ungemach » (p. 91), son règlement qui n’a rien d’exceptionnel dans l’Alsace ou la France des années 20 (p. 88-89), l’effet ville-frontière à Strasbourg (p. 84) tout en insérant des points historiographiques d’un très grand intérêt (p. 112-113 par exemple). Comment A. Dachert voit le monde est une question à laquelle on peut répondre en lisant ses écrits publiés sous le nom d’Abel Ruffenach, et notamment son heptalogie dramatique (dont certaines parties ont été radiodiffusées dans les années 50). Plusieurs extraits de ces pièces sont présentés et analysés dans le présent ouvrage (p. 139-148), et surtout analysés avec une profondeur admirable, replaçant l’œuvre littéraire de la force motrice de la Fondation dans la production culturelle de son temps. Ils dévoilent une influence eugéniste très marquée, prenant souvent appui sur des références bibliques (comme Noé et l’Arche, p. 147-148) et qui prend sa source dans l’instruction qu’A. Dachert s’est lui-même donnée (la faillite de son père ne lui permet pas de poursuivre des études universitaires et l’oblige à être employé, un traumatisme qui ressort dans ses écrits). Les voyages furent aussi formateurs pour A. Dachert : de la Chine qu’il a brièvement visitée il retient la pensée confucéenne que l’humanité est un tout, et de l’Angleterre, il allie à ses activités professionnelles la visite des premières cités-jardins qui y sont érigées (un concept théorisé par Ebenezer Howard). De l’œuvre d’A. Dachert, on peut extraire un leitmotiv, celui de la nécessaire ascension de l’Humanité (p. 158-159, et qui n’est pas forcément éloigné de H.P. Lovecraft qui fut sans doute aussi influencé par les études sur les descendances – celle sur les Jukes dans l’Etat de New-York – pour donner naissances à ses histoires basées dans des communautés retirées) et d’où découle que sa définition de l’eugénisme comme rationalisation d’un conflit intérieur rejoint l’attraction que l’eugénisme exerçait sur les fractions dominées des élites savantes (p. 185).
De l’analyse de l’univers mental de cet homme d’un autre monde qui fait bâtir une cité-jardin après 1918 (p. 153 : luthérien en pays catholique et républicain, germanophone en France, scientiste après la Première Guerre Mondiale) P.-A. Rosental met aussi en lumière l’aspect théologique de l’eugénisme de A. Dachert, qui conçoit le mal comme nécessaire (p. 181) et le natalisme non comme un étatisme mais de la responsabilité des entreprises, appuyées sur la théologie (p. 174). L’analyse du « décalage mental » d’A. Dachert permet aussi à l’auteur d’interroger la notion de contemporanéité en Histoire (p. 152-153), ce qu’il fait bien évidemment avec brio.
La troisième partie est un retour à la cité Ungemach, que l’on n’avait cependant jamais perdue de vue dans la partie précédente. On revient sur la sélection, qui est à la base de toute l’expérimentation selon les mots mêmes de A. Dachert qui doit aussi se battre contre le piston (p. 214-215), avant de passer à la question de la clause de progéniture, qui permet en cas d’absence d’enfants après un certain temps d’expulser les locataires. Et de cela aussi, c’est le directeur Dachert qui s’en occupe. Si le projet continue sans trop de problèmes dans les années 20 et 30, la Seconde Guerre Mondiale bouleverse la cité. La Fondation est confrontée à des locataires qu’elle n’a pas choisis (dont des collaborateurs du régime nazi récompensés par une maison dans la cité), dans un contexte locatif très tendu. La Fondation est confrontée à des actions en justice qui peuvent remettre en question son but, mais aussi à un changement du cadre législatif qui normalise les baux et empêche donc théoriquement les clauses d’âge et de progéniture. La situation juridique de la Fondation n’est clarifiée qu’en 1949, par rien de moins qu’un arrêt de la Cour de Cassation qui approuve le projet eugéniste de la Fondation (p. 291). L’année suivante, selon les prescriptions de l’acte de donation, la Ville reçoit la propriété de la cité, avec ses critères repris en intégralité. La gestion des locataires se bureaucratise (p. 305-306) et se recentre sur la commune pour ses choix. La crainte de ne pas respecter lesdits critères de sélection est constante, avec références fréquentes à une Fondation qui n’existe plus. Pas d’amnésie administrative ici !
La décision de la Cour de Cassation n’est pas le seul lien entre la cité et des institutions nationales. La Ville de Strasbourg transmet aussi des données relatives aux Jardins Ungemach à l’INED entre 1951 la fin des années 60. Mais les évolutions épistémologiques finissent par rattraper et l’INED et la Ville, et dans les années 80 l’eugénisme est vu comme intrinsèquement mauvais (le mouvement avait déjà débuté dans les années 70 quand les grands théoriciens C.M. Goethe et P. Popenoe sont contestés dans les universités mêmes qu’ils ont financés, p. 345). Mais les années 90 voient déjà de nouvelles tentatives d’épuration qui tentent à nouveau de tracer une ligne entre eugénisme positif et négatif …
La dernière partie se détache à nouveau de la cité Ungemach. P.-A. Rosental pour considérer l’eugénisme et la culture scientifique (principalement) en France. L’INED, créé au sortir du second conflit mondial est directement issu de la Fédération Française pour l’Etude des Problèmes Humains (FFEPH) mise en place par Vichy (et où Alexis Carrel joue un grand rôle, p. 362) et contrairement à ce que l’on pourrait croire, le plus grand nombre d’écrits eugénistes publiés en France l’on été entre 1945 et 1950 (p. 357), alors que justement le racisme a été redéfini (p. 377). L’eugénisme dans son acception française, à la fin du XIXe siècle continue donc de se développer au XXe (p. 370), mais avec des changements sémantiques effectués sous le patronage de la démocratie. On passe ainsi de « hérédité » à « génétique » (p. 381). L’eugénisme se rapproche aussi des Sciences du Travail dès la fin de la Première Guerre Mondiale et ses hécatombes pour « avec peu de sujets, produire le plus possible et bien » (p. 394) mais aussi essayer de régler la question du chômage (p. 390). Avant 1940, le maître-mot de l’eugénisme à la française, c’est la sélection. Après la guerre, passé le pic de publications, l’eugénisme français se transforme en une science eugéniste, avec la volonté de rationaliser l’environnement personnel (p. 441). De nombreux secteurs de la vie sociale sont touchés, comme la Sécurité Sociale dirigée par un eugéniste convaincu en 1952 ou la médecine du Travail (déjà à une place éminente dans la FFEPH, p. 419). Mais la génétique ne peut pas encore tout expliquer après 1945, et c’est ce qui justifie la prolongation de l’expérience de la cité Ungemach. Ce recul de l’eugénisme dans les années 60 et sa diabolisation dans les années 70 n’empêche cependant pas sa réapparition dans les années 80, y compris dans les sciences sociales où l’économie (p. 499, où pour l’auteur on utilise des concepts de manière inconsciente) et même la sociologie est atteinte (Bourdieu et Passeron, p. 468-472). La psychologie, avec le développement personnel, n’est pas en reste, tout comme les questions de parentalité : l’eugénisme devient la science d’être un bon géniteur (p. 514), avec le développement d’un eugénisme privé, avec ses revendications d’ignorances (p. 525).
Le texte s’achève sur un passage plus philosophique (dans son versant moral, p. 524) de l’auteur, qui souligne que la vocation originelle de la cité-jardin Ungemach n’a pas entièrement disparu dans les années 80, ni même à la fin du XXe siècle, puisqu’un critère pour l’obtention d’un logement était encore celui d’avoir une famille nombreuse (p. 520).
Enfin le volume est complété par une annexe présentant les textes d’Abel Ruffenach/Alfred Dachert et une liste des abréviations.
Rendre compte de la richesse de ce livre, plus encore de sa justesse, c’est une tâche que nous allons essayer d’accomplir. En près de 550 pages, P.-A. Rosental livre une étude sans aucun angle mort qui se lit avec une grande aisance, qui intéressera un très large public tout en étant d’une très grande érudition, elle-même le fruit de recherches intenses et faisant appel à tous les registres méthodologiques. La part d’opinions personnelles (dans un genre ethnologique) de l’auteur est pleinement identifiable tout en étant mesurée et si l’auteur se cite souvent en notes dans la dernière partie (surtout son ouvrage L’Intelligence démographique), c’est qu’il n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine de l’histoire des sciences et qu’il est peut-être esseulé en France dans l’étude de l’eugénisme. La seule imprécision repérée concerne le Pavillon Joséphine devenu palais (p. 36) et le lecteur, même familier de la géographie locale, apprendra encore des choses, comme le fait que la rue de la Liberté s’appelle encore Kaiser-Wilhelmstrasse après 1919 (p. 151). C’est, nous pensons, la pointe émergée de l’énorme qualité de ce livre, passionnant de bout en bout.
Pour conclure, ce livre est la parfaite synthèse entre la micro-histoire, l’histoire des sciences, l’histoire des mentalités et d’histoire des organisations. C’est là un futur classique, nécessaire à tout étudiant en sciences historiques, et que nous ne pouvons que très chaudement recommander. Il va de soi que ce n’est pas la dernière fois que nous aurons à parler de la production historique de P.-A. Rosental dans ces lignes.
(une mobilisation citoyenne contre l’implantation d’une usine polluante dès 1920 p. 106-107 …9)
[Les] sciences économiques, une discipline qui entretient parfois un rapport quelque peu instrumental et décontracté avec l’histoire … p. 499

