Réalités d’une légende
Essai de mythographie comparée de Dominique Briquel.
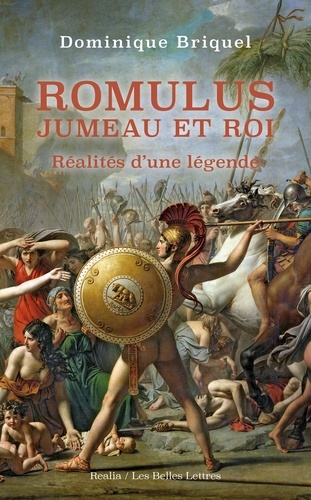
« Que Romulus ait [commis] le meurtre [de son frère], plusieurs [le] nient par impudence ou [le] révoquent en doute par honte, ou [le] dissimulent par douleur. » Augustin d’Hippone, Cité de Dieu, 3, 6.
Quelle mouche très particulière a bien pu piquer les Romains pour se choisir un héros fondateur fratricide de son jumeau et tué par ses compatriotes en raison de sa tyrannie ? Mais sont-ils vraiment les seuls à avoir fait ce choix ou sont-ils, comme les autres indo-européens, les dépositaires d’un ensemble de motifs mythologiques (mythèmes) qui prend dans le centre de l’Italie cette forme particulière ? Rassemblant ici des décennies de recherches sur la question, D. Briquel passe au tamis de la trifonctionnalité indo-européenne (roi/guerrier/producteur, telle que définie par G. Dumézil mais sans pour autant le suivre en tous points) la légende romuléenne dans un livre qui fait voyager de Upsal à Erevan, de Jérusalem à Bombay, pour finalement revenir à Rome.
Comme toute biographie, on commence avec l’enfance du chef. Les Romains de la fin du premier millénaire, vivant dans une Méditerranée occidentale romanisée, voient naturellement Romulus comme le fils du dieu Mars. Les éléments les plus anciens de la tradition, avant l’annalistique du IIe siècle a. C., évoquent eux un dieu masculin du foyer. Le fondateur de la ville de Préneste dans le Latium a lui aussi le même type de géniteur (mais sans jumeau) mais c’est aussi le cas du roi Yima en Iran. Une fois la question des géniteurs éclairci, D. Briquel s’attèle à l’explication de la gémellité. Pour lui, Rémus et Romulus (selon leur rang de naissance) ne peuvent pas êtes assimilés aux Dioscures (p. 34-35), puisqu’ils sont tous les deux mortels mais surtout parce que si Castor décède, ce n’est pas de la main de son frère.
Une fois les jumeaux venus au monde, ils sont exposés dans un panier dans le Tibre. Plusieurs éléments sont alors employés qui, là encore, peuvent être retrouvés dans d’autres aires indo-européennes. La crue du Tibre qui amène le panier sur la berge peut être vue comme une manifestation du « feu dans l’eau », un mythème visible aussi en Inde et en Iran, avec une signification royale. Les arbres (le figuier Ruminal, c’est Yggdrasil), les animaux (les oiseaux auguraux p. 105) et les bergers jouent un rôle symbolique important dans les premières années des jumeaux, le plus souvent dans des séries ternaires à colorations fonctionnelles.
C’est parmi les bergers que les jumeaux vont progressivement se différencier. Le processus est achevé quand ils remettront leur grand-père Numitor sur le trône d’Albe La Longue : c’est Romulus qui conduit militairement les bergers dans Albe et Rémus qui mange les parties destinées aux dieux du sacrifice interrompu par l’attaque des brigands (qu’il a vaincus, et pas son frère !). Romulus est qualifié pour la vie citadine, Rémus n’est pas dans l’impiété mais son acte le destine à rester dans la sauvagerie des marges : il ne peut être le fondateur (p. 167-169). Récuse-t-il le désenchantement du monde ?
Le quatrième chapitre analyse la fondation de l’Urbs et le meurtre de Rémus, qui est dès l’origine un sujet d’interrogation pour les auteurs Romains, de critiques pour les auteurs paléochrétiens et de scandale pour les deux groupes. Pour ce qui est du conflit entre aîné et cadet, D. Briquel va par contre chercher une comparaison dans la Bible et les écrits intertestamentaires (p. 182), dans le changement civilisationnel qui sous-tend la rivalité entre Jacob et Esaü, les fils de Rebecca et Isaac. Esaü l’aîné est le chasseur, Jacob le pasteur. Ce dernier prend l’ascendant sur son aîné (par la ruse, une qualité commune avec Romulus, p. 195-198) et Esaü est tué quand il assaille la tour de Jacob.
Les actes du roi Romulus, le conditor, ne sort pas du schéma trifonctionnel. Sitôt Rome fondée, il se pose la question de sa complétude. Si elle veut un avenir, les hommes qui composent la cité doivent trouver des compagnes. Profitant de la célébration de jeux, les Romains enlèvent des femmes de plusieurs cités latines et des Sabines. Les Sabins en retour attaquent Rome et l’auraient emporté sans l’intervention de Jupiter. La cité est ainsi complète, marquant le début de la civilisation, non pour l’ensemble de l’humanité comme dans d’autres récits (mythe iranien) mais à l’échelle de la Ville (p. 277). Une fois le peuplement acquis, Romulus et Titus Tatius le Sabin règnent conjointement, pendant cinq années où rien ne se passe jusqu’au moment où Titus Tatius ne sanctionne pas le sacrilège de ses amis envers des ambassadeurs lavinates et est assassiné lors d’une cérémonie religieuse à Lavinum (l’une des métropoles de Rome, fondée par Enée). Romulus redevient seul roi de Rome. Ses trois triomphes sont cependant ternis par trois fautes colorées fonctionnellement. La déchéance est ainsi progressive, sa royauté (qui rassemble les trois fonctions) est dépouillée tiers par tiers, menant à une fin misérable.
Romulus, devenu un tyran insupportable, est assassiné par les sénateurs (et démembré) ou enlevé au ciel, selon les versions de la tradition (comparaison avec l’arménien Ara le Beau et avec Freyr/Frotho, avec le lien possible entre les deux version réglé p. 418-419). Il est divinisé sous le nom de Quirinus, le dieu des citoyen, la concorde est rétablie dans la cité et la prospérité n’est pas mise en danger. La particularité de Rome, c’est que son fondateur devient un dieu de la troisième fonction (p. 411). Ainsi s’achève la vie d’un héros, semblable à de nombreux héros (gémellité, exposition, apprentissage, révélation, règne) mais qui a la différence de beaucoup, ne marque pas le début de l’humanité mais se concentre sur l’Urbs seule.
Voici très grossièrement brossé le contenu de ce livre très dense qui analyse sous toutes les coutures la légende de Romulus, dans laquelle il ne faut rien chercher d’historique (moins baroque que les mythes grecs, pas plus réel). D. Briquel utilise la grille de lecture indo-européenne en premier lieu mais n’oublie pas pour autant la critique des textes. La mise en perspective de la vie de Romulus avec celle de Servius Tullius (le sixième roi), le refondateur qui agrandit l’espace sacré de la ville (pomérium), est très souvent utilisée. Malgré la masse d’informations, l’ouvrage reste très pédagogique (des rappels dans les chapitres) avec de nombreux tableaux récapitulatifs permettant de bien visualiser les comparaisons. Toutes ces qualités, tout ce que le lecteur y apprend (un exemple parmi d’autres, sur l’influence du théâtre sur l’annalistique p. 156) et le brio de la démonstration sont malheureusement ternis par des coquilles très nombreuses, y compris dans des noms propres (ou un problème de constance dans la translittération à une page d’écart p. 194-195) et dans la bibliographie. L’auteur n’est ici pas à mettre en cause mais c’est tout de même désagréable, surtout chez un éditeur de ce standing.
Il y a sûrement encore quantités de choses à dire sur les jumeaux fils de Vulcain (sur la postérité de Rémus par exemple) mais dans les limites que s’est posé D. Briquel dans ce livre, il ne peut en rester qu’extrêmement peu. Magistral.
(les « entourloupettes » de l’historien Fabius Pictor p. 111 …8,5/9)


