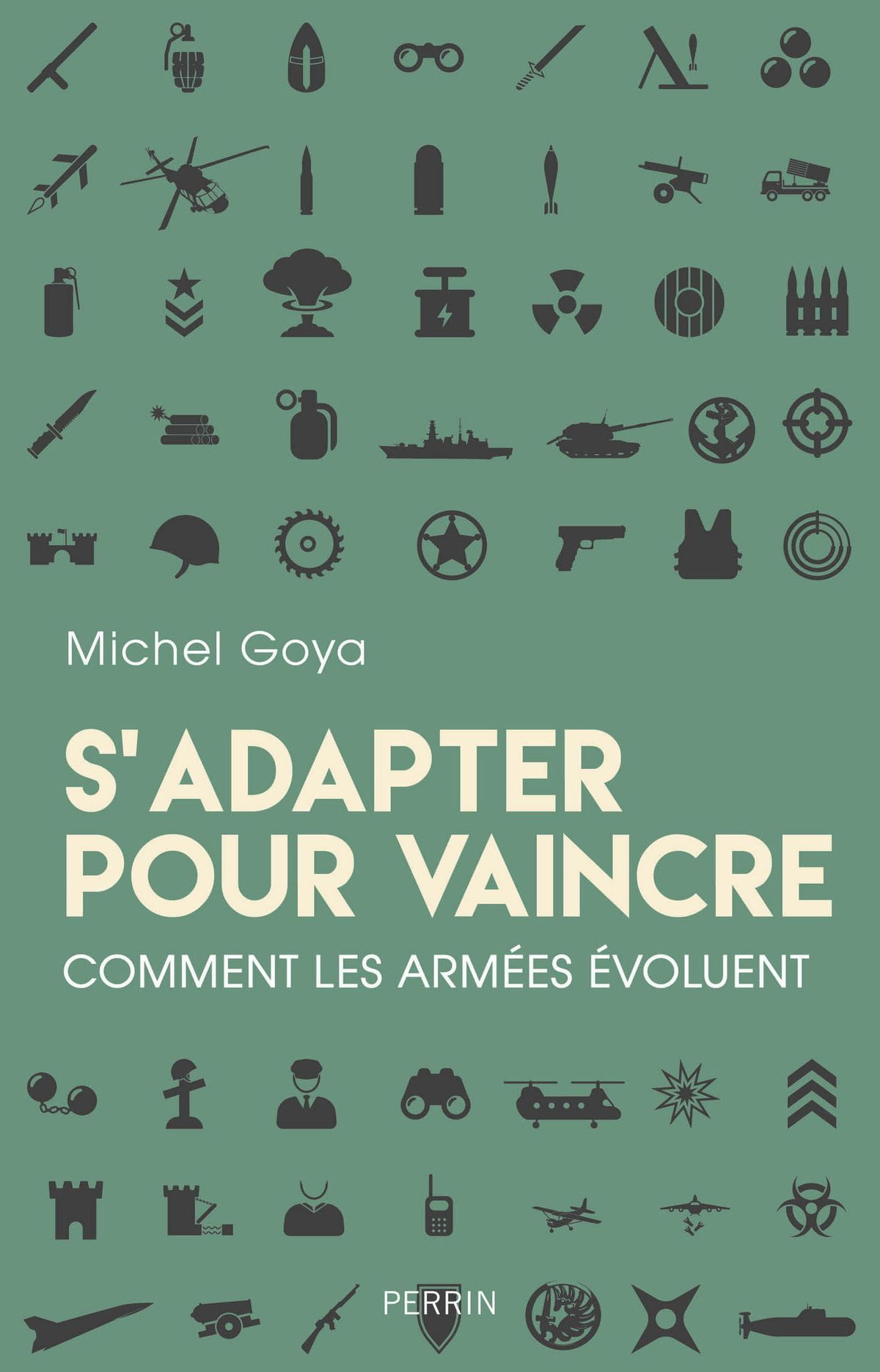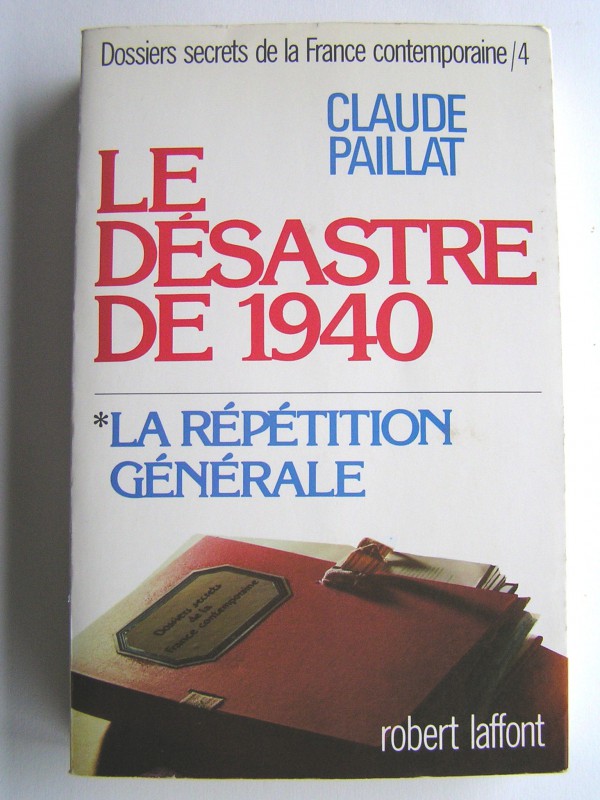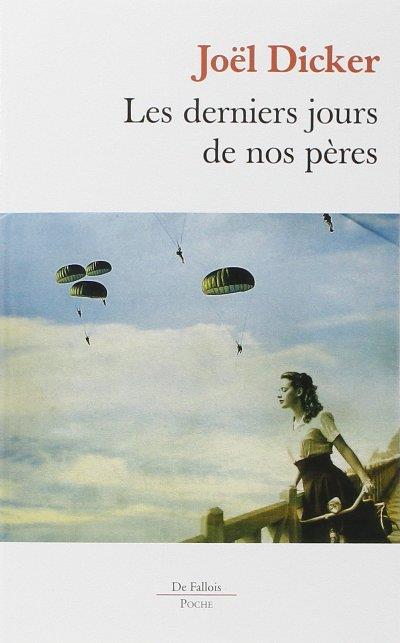Mémoires d’André Beaufre sur 1940.

La jeunesse n’a pas toutes les qualités, mais l’expérience est un fardeau dont il est difficile de se dégager pour raisonner vraiment juste. (p. 88)
André Beaufre est un cas à part parmi les quatre généraux qui ont le plus contribué à mettre au point la doctrine de dissuasion nucléaire française. Si en mai-juin 1940, les « Quatre généraux de l’Apocalypse », Lucien Poirier (à Saint-Cyr), Pierre-Marie Gallois (à l’état-major de la 5e région aérienne à Alger) et Charles Ailleret (officier dans l’artillerie) sont déjà militaires, A. Beaufre est le seul à être au Grand Quartier Général. Il est aux premières loges pour suivre ce qui est peut-être la plus grande surprise géostratégique du XXe siècle.
Mais avant de conter ce qu’il a vu au printemps 1940, l’auteur veut décrire son parcours. Ses jeunes années parisiennes, la fin de la Première Guerre Mondiale (Prologue), son passage à Saint-Cyr à partir de 1921 où tout transpire le dernier conflit. Il y croise pour la première fois un ancien combattant qui y est son professeur d’histoire, le capitaine De Gaulle. Il choisit ensuite comme affectation le 5e Régiment de Tirailleurs à Alger. Au cours d’une mission de routine au Maroc débute la Guerre du Rif. Son baptême du feu a lieu en mai 1925 (p. 68) et il est sérieusement blessé. A l’hôpital de Rabat, il rencontre Lyautey. C’est aussi l’occasion de réflexions sur ce que fut la dernière guerre coloniale et A. Beaufre ne voit clairement pas la colonisation comme un échec (p.80-86). « Des remords non, beaucoup de regrets … » (p. 86). En 1929, avec une croix de guerre et trois citations, on lui refuse la possibilité de présenter l’Ecole de Guerre. En 1930, il est admis. Il y trouve l’enseignement très conformiste, arrêté à 1918, même si en 1932 on lui parle (déjà) de la bombe atomique. Breveté, il est envoyé en Tunisie mais est bientôt muté à l’Etat-Major à Paris. Là il découvre une machine à la pensée libre, mais aux chefs décevants. La modernisation se fait à pas comptés et le chef d’Etat-Major interdit toute diffusion d’idées sur la mécanisation et la motorisation. Passent les années, l’auteur est en charge de la réorganisation de l’Armée d’Afrique. Arrive l’été 1939, quand on propose à A. Beaufre d’accompagner la mission militaire franco-britannique en URSS en qualité d’interprète. C’est l’occasion de dresser un état des lieux de la situation en 1939, pour mettre en relief le poids de la victoire de 1918 et les avantages de la défaite pour les Allemands : pas de généraux victorieux à contenter, pas de fossilisation de la doctrine, pas de matériel déjà dépassé à faire durer, mais surtout comme en France après 1871, un esprit de revanche.
La mission conjointe franco-britannique à Moscou a pour objectif de recréer une tenaille contre l’Allemagne comme en 1914. La Petite Entente a échoué avec l’abandon de la Tchécoslovaquie en 1938. Mais pour être efficace, un soutien soviétique doit pouvoir agir contre les Allemands, ce qui emporte d’avoir des troupes soviétiques traversant des territoires polonais. Refus catégorique de ces derniers, et la mission militaire franco-britannique qui ne s’était pas assuré de ce « détail » avant (c’est cependant de niveau gouvernemental) tente de gagner du temps. A. Beaufre fait le voyage vers Varsovie pour tenter un infléchissement. En passant par Riga et rendant visite au chef d’état-major letton, il dit : « J’avais l’impression de rendre visite à des condamnés à mort … » (p. 223). Ribbentrop allait arriver à Moscou … Le 23 août, le pacte est conclut, une semaine plus tard débute l’invasion de la Pologne depuis l’Ouest et quinze jours plus tard, les Soviétiques viennent prendre leur part du gâteau. Sitôt la signature du pacte connue, la mission était repartie aussi vite que possible, et l’on ne peut pas dire que le futur général ait gardé un souvenir enchanté de son séjour soviétique (p. 245). Quand il arrive à Paris, la mobilisation a commencé.
Puis il ne se passe rien. Une attaque pour soulager les Polonais ? Non. Tout au plus un petit mouvement vers Sarrebruck (comme en 1870 note Beaufre). La production de matériel de guerre n’augmente pas et chaque groupe de pression veut démobiliser qui les fils de veuves, qui ses ouvriers etc. En janvier 1940, A. Beaufre suit le général Doumenc, avec qui il était allé en URSS, au QG Nord-Est. Aide de camp du major général, il voit passer tout ce qui lui est adressé. Il ne peut que constater le déséquilibre des forces, l’absence de solidarité militaire avec la Belgique, une armée « démodée, engourdie et bureaucratique », un commandement non éprouvé, un moral moyen et des citoyens ignorant la gravité de l’heure (p. 297). L’auteur raconte le cauchemar, mais aussi ce qui aurait pu produire un ressaisissement. Ce qui est sûr, il ne l’attendait pas de Gamelin et Weygand arrive bien trop tard, mais avec énergie (p. 314). Dans le repli du QG, l’auteur assiste à la prise de contact entre Churchill et De Gaulle à Briare (p. 341). Dans l’épilogue, enfin, A. Beaufre condense sa pensée sur les évènements (l’inaction à l’extérieur dès 1936) et les hommes, dominés comme les pays par le Destin, s’ils n’ont pas pu prévoir les périls à temps et les conjurer.
Le livre fait évidemment penser à Marc Bloch. Les deux témoignages sont complémentaires, indéniablement, même si A. Beaufre rédige son texte bien plus tard. Il ne peut donc être exempt d’une certaine téléologie. Lui ne voit pas les conséquences du non armement du personnel du service des essences, mais il constate le divorce complet entre la politique extérieure et les armées. Et le réquisitoire final (p. 252), 25 années après les faits, est encore violent, avec un énervement bien palpable. Est-il trop dur avec le refus polonais de l’été 1939 (il y a louvoiement polonais dans les années 30, y compris prise de territoire tchécoslovaque en 1938) ? L’auteur ne dit pas qu’ils ont eu raison, comme les faits le démontrent ensuite. A. Beaufre a une vision très gaullienne (et sans doute teintée de ses observations des années 1960) de l’URSS, pour qui c’est toujours la Russie et ses objectifs impérialistes traditionnels, sous le masque du bolchevisme.
Du point de vue formel, c’est un peu moins bien. Les notes de l’éditeur (auteur reconnu lui-même, dans un autre registre, et dont la présentation remplit bien son œuvre) nous ont semblées mal calibrées pour le public visé, qui ne peut être que déjà informé. Beaucoup des notes infrapaginales nous sont apparues inutiles, d’autres nous paraissaient manquantes. Une même, à la p. 140, nous semble fausse (K. Haushofer comme inventeur du concept politique d’espace vital à la place de F. Ratzel, sur ce point voir Black Earth de T. Snyder). Les noms propres auraient pu être vérifiés (par exemple Trondheim p. 290) et les coulures noires dues à l’impression ne sont pas du plus bel effet … Le livre se dévore et le regard porté par le général sur le lieutenant est intéressant, entre nostalgie du Maroc et conscience que les guerres de décolonisation ont rendu la vie morale des jeunes officiers beaucoup moins simple que ne fut la sienne.
(ce chassé-croisé nationalistes/pacifistes de 1936 est très bien décrit p. 117 …7)