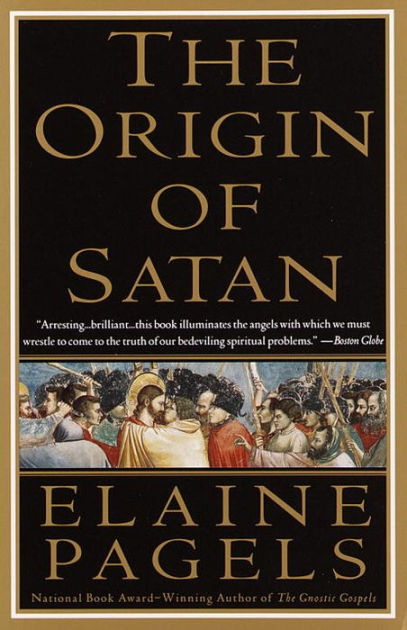Manuel d’écriture universitaire d’Umberto Eco.

Il pourrait vous arriver de remercier ou de reconnaître votre dette à l’égard d’un universitaire que votre directeur de thèse déteste ou méprise. Incident grave. Mais c’est de votre faute. Ou bien vous faites confiance à votre directeur, et s’il vous avait dit que cet individu est un imbécile, il ne fallait pas aller le consulter. Ou bien votre directeur est quelqu’un d’ouvert et accepte que son étudiant ait eu recours à des sources avec lesquelles il est en désaccord, ce dont il fera éventuellement le sujet d’une discussion courtoise lors de la soutenance. Ou bien votre directeur est un vieux mandarin lunatique, blafard et dogmatique, et il ne fallait pas choisir comme directeur un aussi triste sire. Et si vous vouliez faire à tout prix votre thèse avec lui parce que, malgré ses défauts, il vous semblait un protecteur utile, alors soyez cohérent dans votre malhonnêteté, ne citez pas l’autre parce que vous aurez choisi de prendre modèle sur votre mentor. p. 283
Umberto Eco n’est pas qu’un auteur de romans à succès mais a été un professeur respecté à Bologne. Il a donc dirigé des travaux de recherches, des doctorats bien entendu, mais surtout (quantitativement) des mémoires de laurea (l’équivalent de la maîtrise française d’avant la réforme européenne dite de … Bologne). Ne souhaitant pas se répéter chaque année avec chaque étudiant, il a couché par écrit ses conseils méthodologiques et de rédaction dans les années 70, avant de l’éditer en 1977. Le titre est donc un peu mensonger, puisque l’auteur s’adresse expressément à des étudiants écrivant leur tout premier travail de recherche, ce que n’es pas une thèse de doctorat.
Et donc, 39 ans après la première édition italienne, le livre paraît enfin en français.
La préface à l’édition italienne de 1985 pose la scène. Ce livre a connu une grande diffusion parmi les étudiants et conseillé par de nombreux professeurs, ce dont se félicite U. Eco, acceptant la responsabilité (p. 11) d’avoir donné à l’Italie de nombreux titulaires de la laurea. Il revient aussi sur certains développements personnels et universitaires entre 1977 et 1985. Suit le premier chapitre, consacré à la nature du mémoire/thèse et son utilité. La nature du mémoire est donc exposé, son utilité après les études, le public visé par ce livre et enfin quatre règles fondamentales quand on se lance dans ce genre de travail : que le sujet intéresse l’étudiant, que les sources soient matériellement accessibles, qu’elles soient utilisables et finalement, que l’étudiant soit méthodologiquement prêt.
Le second chapitre passe à la détermination du sujet (la première règle fondamentale), en distinguant les types de sujets : monographique ou panoramique, historique ou théorique et sujet ancien ou contemporain. La question du temps est aussi abordée dans ce chapitre (entre six mois et trois ans) avant que l’auteur considère l’utilité ou la nécessité des langues étrangères. La scientificité est explorée, surtout son rapport à la politique (nous sommes moins de dix ans après 1968). L’exemple d’un sujet sur les radios libres (oui, fin des années 70 …) permet de montrer qu’un sujet d’actualité peut être traité avec rigueur scientifique (p. 73-83). Le chapitre s’achève sur quelques conseils de bon sens sur comment ne pas se faire exploiter par son directeur de mémoire.
Le chapitre suivant avance dans le processus de fabrication du mémoire avec la recherche du matériau, et tout d’abord le repérage des sources. U. Eco distingue les sources de première main de celles de seconde main, avant d’expliquer comment faire une recherche bibliographique en bibliothèque (avec ses aspects pratiques de notation). Le point le plus intéressant de ce chapitre est son exemple de recherche à partir de la p. 141. L’auteur se met dans la peau d’un étudiant habitant à Montferrat (dans le Piémont, où justement il habite), travaillant pour financer ses études et qui consacre trois après-midis (neuf heures en tout) à sa recherche bibliographique sur le concept de métaphore dans les traités italiens de l’époque baroque. Il se rend donc à la bibliothèque d’Alexandrie (toujours dans le Piémont) pour démarrer sa recherche. U. Eco détaille ses actions et leurs résultats, pas à pas, entre usuels, monographies et revues. Les choses de ce côté-là ont beaucoup évolué depuis 1977 (catalogue unique, accès à distance) mais la méthode reste la même. La psychologie du chercheur est brièvement évoquée en fin de chapitre.
La quatrième chapitre est celui du plan de travail, intimement lié à la table des matières. L’auteur détaille aussi son système de fiches, s’il faut écrire ou souligner dans les livres, ou encore le danger des photocopies comme alibi. Le thème de l’humilité scientifique clôt cette partie, où l’auteur explique par l’exemple que les bonnes idées ne viennent pas toujours des grands auteurs : « n’importe qui peut nous enseigner quelque chose » (p. 226).
Puis, dans le cinquième chapitre, U. Eco s’attaque à la rédaction. La première question qu’il règle est à qui s’adresse le mémoire, ce qui a une influence directe sur les termes à définir ou pas. Il insiste aussi sur les conventions d’écriture (ne pas écrire de la poésie d’avant-garde dans un mémoire sur ce sujet, p. 236), accentuant sur le fait que si c’est pour briser les conventions, autant ne pas faire de mémoire et de jouer de la guitare (p. 236). Utiliser le « je » ou le « nous » est une question résolue avec beaucoup de pertinence (p. 244). L’art de la citation est aussi défini par l’auteur, comme les différences entre citation, paraphrase et plagiat et l’utilisation des notes. Avant de conclure avec la fierté scientifique (avoir le courage d’affirmer), l’auteur donne encore quelques conseils et définit quelques pièges à éviter.
Le dernier chapitre, enfin, est centré sur la rédaction définitive du mémoire. Il y est évidemment question de typographie, de translittération (où le peut ne pas toujours être d’accord), de soulignages, de guillemets, de ponctuation, d’abréviations, la bibliographie finale, la table des matières ou encore les appendices. Une petite conclusion achève ce volume de 340 pages en insistant sur l’expérience que représente la rédaction d’un mémoire avant que le traducteur n’offre au lecteur une petite analyse contextualisante du livre (sur l’informatique p. 333, sur l’importance pour U. Eco de faire partie du club des chercheurs p. 335).
Pour toute personne passé par cette étape du mémoire de recherche, ce livre c’est pas mal de souvenirs qui remontent, avec certaines prises de conscience aussi. Ce livre est une mine de bons conseils, certains évidents, d’autres moins. Il est bien sûr un peu daté (les machines à écrire, comme par exemple p. 277 et p. 287, mais aussi sur le peu d’importance des morts sur la route p. 324) mais sait aussi être drôle, voir même abrupt : il n’exclut pas que l’étudiant puisse faire fausse route en écrivant un mémoire (p. 242). De plus, U. Eco cite de véritables mémoires, ce qui peut être parfois gênant pour leurs auteurs (p. 231).
Mais ce livre est bien plus qu’un manuel, il est aussi une plongée dans l’univers mental d’U. Eco. Les pages 236 et 237 sont sur ce point exemplaire : on passe du style du Manifeste du parti communiste au style du Capital au style des poètes E. Montale et C.E. Gaddia. Ses connaissances en philosophie médiévale n’étonneront personne et il fait appel dans la rédaction de ce manuel non seulement à sa pratique professorale mais aussi à ses souvenirs d’étudiant.
La traduction est hélas assez oscillante. Les exemples typiquement italiens sont parfois remplacés par des exemples français, au lieu d’expliquer les exemples d’origine en note. On obtient ainsi pour un livre paru en 1977 un exemple avec Z. Zidane (le texte de l’édition italienne de 2001, p. 197, ressemble peu à ce que l’on a lu p. 281) et on parle d’email comme mot du langage courant d’origine étrangère qu’il n’est pas besoin de traduire (p. 291) avec bar, sport et boom. Il y avait sans doute d’autres choix à faire pour ne pas rendre ce texte incohérent et en partie anachronique. Pourquoi parle-t-on de Ligue 1 au lieu de Série A (p. 29) alors que tout le reste du livre ne parle presque que de littérature italienne ?
Mais ce point noir n’affecte que très peu les justes et précis conseils que donne ce livre pour la rédaction d’un travail universitaire, voir pour un texte tout court. Il est enfin à la disposition des étudiants français qui pourront ainsi se référer à une méthode éprouvée. L’université de masse, déjà décrite en 1985 par U. Eco dans l’introduction (p. 13) s’étant encore massifiée, bénéficier de l’aide d’un tel professeur en plus de son directeur de mémoire, souvent sollicité par ailleurs, ne se refuse pas.
(un professeur ayant conscience que l’université d’avant 1960 n’existait plus …8)