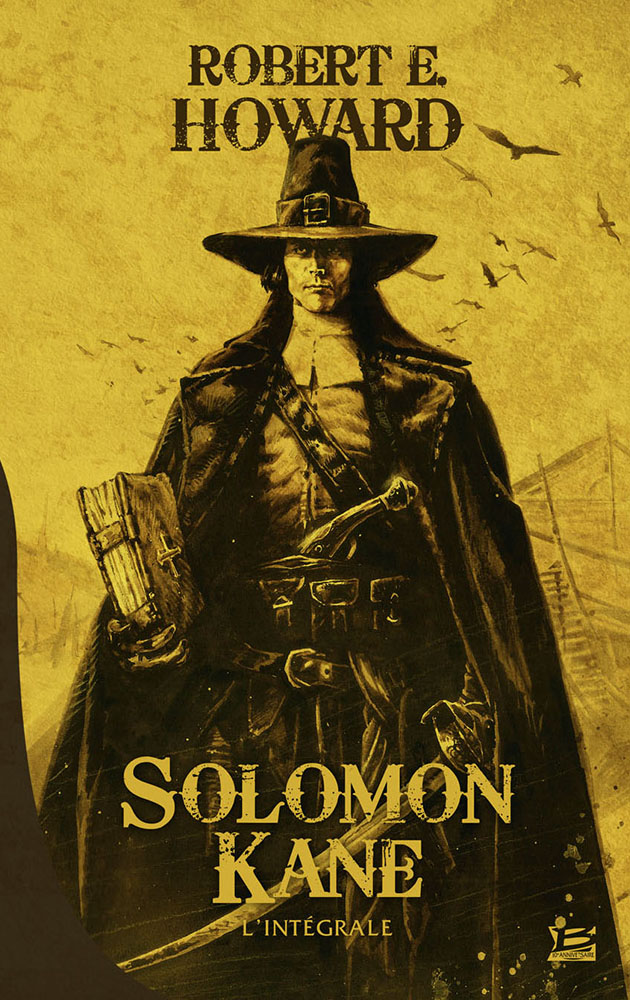From Kapital to Capital
An event of the final decade of Yugoslavia

Recueil d’articles et de photos sur la première décennie du collectif artistique slovène Neue Slowenische Kunst, dirigé par Zdenka Badovinac, Eda Čufer et Anthony Gardner.
Fondé en 1984, le collectif Neue Slowenische Kunst (NSK) est l’union des groupes Laibach (musique et arts plastiques), IRWIN (peinture) et Gledališče sester Scipion Nasice (Théâtre des sœurs de Scipion Nasica, théâtre). Ces groupes ont pour principe directeur le rétro-avant-gardisme, principe expliqué dans ce livre qui accompagne l’exposition qui a été consacrée au collectif NSK à la Moderna Galerija de Ljubljana en 2015.
Menant des actions conjointes ou agissant séparément, les groupes formant NSK existent toujours (le groupe de théâtre a cependant changé plusieurs fois de nom, selon les projets), donnant naissance à plusieurs sous-groupes, parmi lesquels : Novi Kollektivizem (design), Retrovision ( films et vidéos), Builders (architecture) ou encore le Département de philosophie pure et appliquée (philosophie).
Très richement illustré, ce livre de 500 pages rassemble des articles écrits entre 1980 et 2015 ayant attrait à la période 1980-1992, soit entre la fondation de Laibach à Trbovlje et le tournant de l’année 1992, un an après l’indépendance de la Slovénie et l’année du début du projet « NSK State in Time ». Le livre se décompose en plusieurs parties. La première parle des années 1980 à 1984, qui voit l’émergence des trois groupes fondateurs. Il y est question du scandale des posters à Terbovlje, de la répétition en Histoire, de la Rétrogarde comme une avant-garde alternative (sans y appartenir, à cette alternative, pour Scipion Nasica, p. 16) ou du graffiti dans l’espace culturel slovène. La seconde partie se concentre sur les années 1984-1992 avec des articles sur le post-modernisme, les différents projets des groupes, une approche psychanalytique du scandale provoqué en 1987 par le projet de poster accepté par la Ligue yougoslave socialiste pour la jeunesse (reprenant un poster nazi), ou encore un échange entre les philosophes Tomaž Mastnak et Slavoj Žižek (qui ne signe rien moins de cinq articles du recueil).
La troisième partie est une série d’articles critiques sur NSK, parfois écrits par des membres même (Eda Čufer par exemple), analysant par exemple la pièce de théâtre Baptême à l’ombre du Triglav (les deux articles, p. 147-152), la mimésis comme stratégie de résistance ou les Lumières chez Laibach. Le chapitre suivant contextualise, avec un point de vue qui est celui du XXIe siècle, l’apparition de NSK. Y sont étudiés les manifestes et les programmes du collectif, l’esthétique de la parodie dans l’URSS finissante, la sur-identification en Amérique latine ou bien sûr la scène culturelle slovène dans les années 80.
La partie suivante présente une grande quantité de sources primaires : des manifestes, un règlement intérieur, la transcription d’un entretien télévisuel, entre autres. Puis le volume s’achève sur une chronologie, un glossaire, une présentation succincte des groupes formant NSK, des appendices (sur la liste des expositions et un texte de Tomaž Mastnak), un index, la liste des traducteurs et une bibliographie.
Sur la forme, le livre est beau mais sa lecture n’est pas aisée : les pavés sans aération que sont les différents articles n’aident pas le lecteur à comprendre des textes qui sont parfois ardus et nécessitent une très grande concentration. Cette complexité rencontrée parfois dans les textes, elle n’est pas annoncée dès l’introduction, où les auteurs simplifient trop la Seconde Guerre Mondiale dans les Balkans et la situation en Bosnie en 1992 (p. 9). De même, dire que tous les théâtres d’Etat en Europe sont nationalistes, c’est aller très vite en besogne (p. 14). Nous ne suivrons pas plus en ce qui concerne la fin du rock et de l’opéra (p. 380). Mais une fois dans le corps du livre, le lecteur intéressé en aura pour son argent, avec une très belle diversité d’informateurs et un déluge d’information : le lien Laibach-Đorđević-Ulay/Abramović (p. 34), comment fonctionne l’autogestion yougoslave et en quoi le mouvement punk révèle le cynisme quotidien de ce système (p. 110-112), comment la présence du régime en Yougoslavie est acceptée comme l’est un handicap (p. 127), que le turbo-folk est un style musical déjà ancien (p. 166), comment Baptême à l’ombre du Triglav se place dans son époque et comment est né le projet (p. 238, avec son rapport avec F. Prešeren, le poète national, et p. 363).
Le contexte, tant slovène que yougoslave, a bien sûr une grande importance. Depuis 1974, la Yougoslavie est une fédération (p. 359). Le pays est en quarante ans passé de l’autogestion planifiée à un retour du capitalisme (à partir de 1971, p. 360), tandis que le front n’est pas non plus uni contre le socialisme. Une société civile se fait jour pendant les années 80 en Slovénie, dans laquelle NSK trouve une place. Mais parallèlement, la fédéralisation n’a pas arrêté la montée des nationalismes en Yougoslavie et la mort de Tito en 1980 va même permettre leur accélération. Mais les différents auteurs nient que NSK ait pu jouer un rôle dans l’indépendance slovène (p. 365 et 450). Pour les auteurs, NSK est beaucoup de choses, comme par exemple une réponse au présent perpétuel (déjà, en 1988, p. 183) ou une interrogation par l’imitation de ce qu’est la Slovénie, mais ne préfigure en rien la Slovénie indépendante.
C’est donc un livre pour un lecteur déjà averti, et qui veut l’être encore plus. Il lui faudra coller ensemble les éléments qui lui parviendront par différents canaux à la lecture de ce livre à la lecture peu aisée, nécessitant même une certaine endurance. Mais le tableau ainsi obtenu vaut le coup, et le lecteur voit se déployer devant lui un vaste panorama allant de l’industrielle Trbovlje à l’Académie des Beaux-Arts de Ljubljana en passant par la Place Rouge à Moscou, lieu de l’action hommage à K. Malevitch Black Square on Red Square (p. 405). Un mouvement artistique particulier dans un pays qui ne l’était pas moins, avant de n’être plus du tout, en 2003 (ou en 1992, selon le point de vue).
(« Qu’est-ce que cela signifie ? » est donc une question taboue depuis les années 60, p.164 … 7,5)