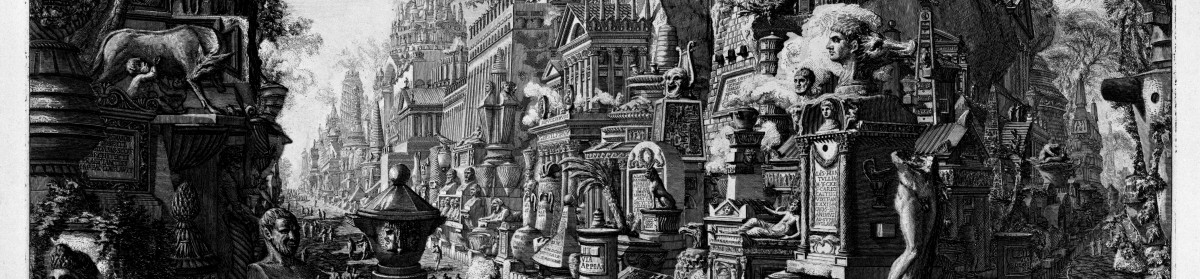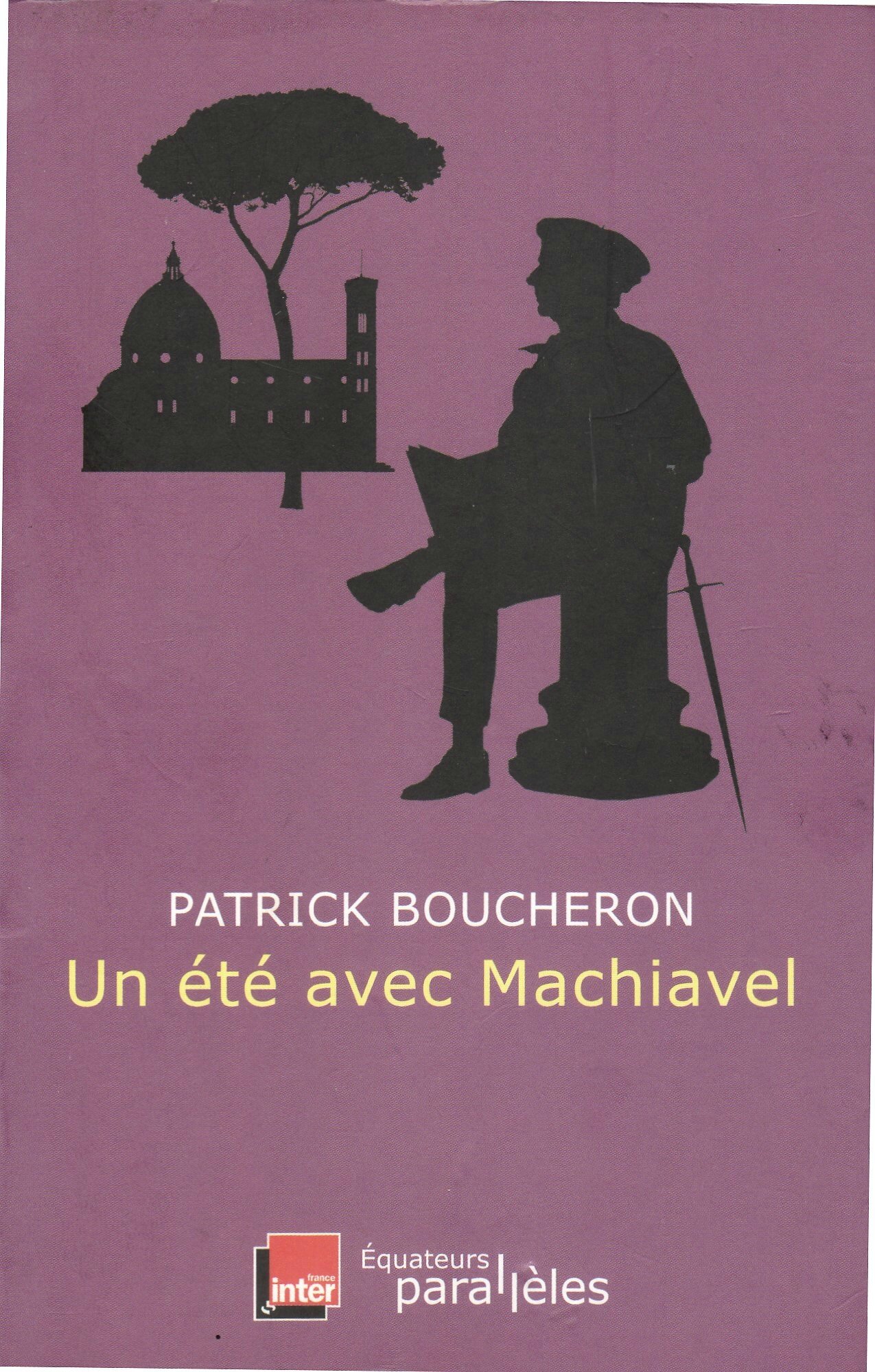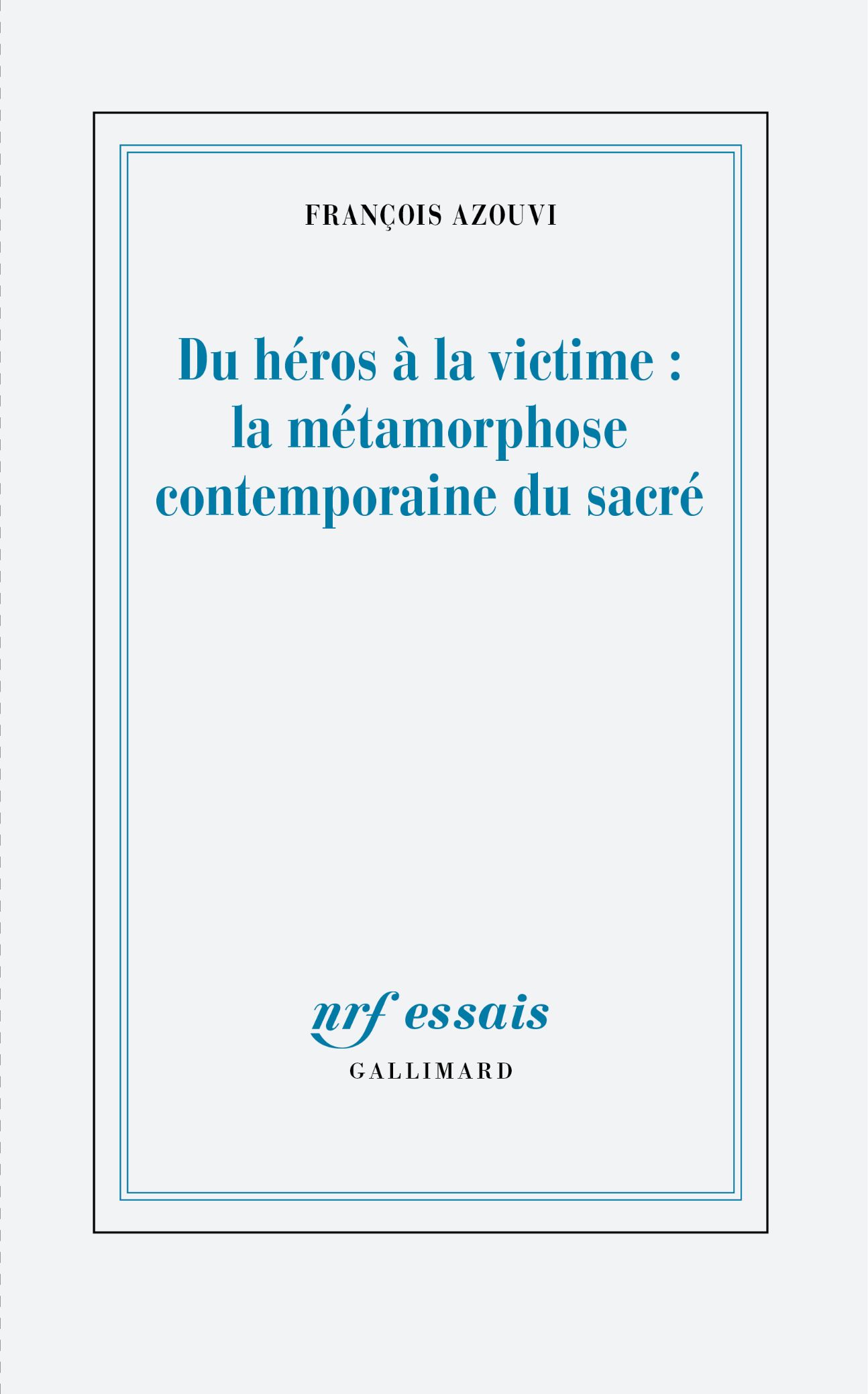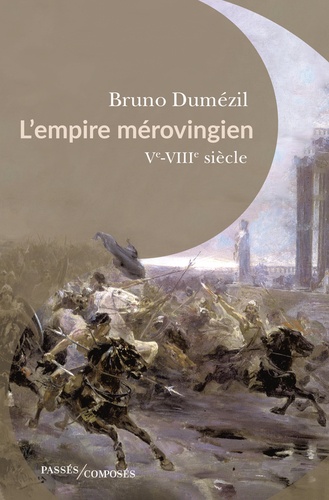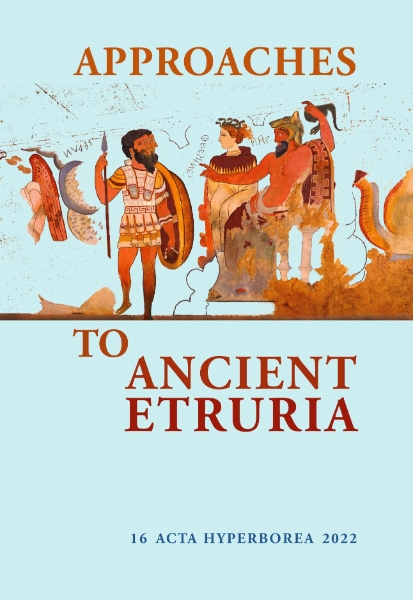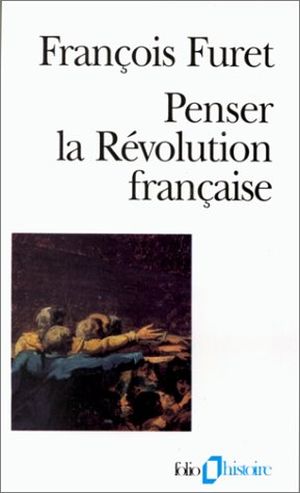DDR-Auslandsspionage und der Verfassungsschutz
Essai sur le contre-espionnage ouest-allemand face aux opérations est-allemandes par Michael Wala.

L’espionnage est-allemand était le meilleur du monde nous disent ses anciens employés à partir de 1990, son ancien chef Markus Wolf en tête. Mais à l’appui de ces affirmations, ils ne peuvent livrer aucune preuve … Le service s’est sabordé tout en détruisant en parallèle ses archives, voire en les transférant à son service frère le KGB. Seuls quelques documents épars ont réapparu en trois décennies, mais trop peu pour permettre aux historiens d’évaluer les méthodes, les réseaux, les succès ou les échecs du HVA (Hauptverwaltung A, ou Directorat A). Reste le portrait en creux, celui que tente Michael Wala, historien spécialiste du renseignement, à l’aide des archives de la section de contre-espionnage du Bundesverfassungsschutz, l’Office fédéral ouest-allemand de protection de la Constitution, entre sa création en 1950 et les lendemains de la réunification allemande.
L’Office fédéral ouest-allemand de protection de la Constitution, abrégé en allemand BfV, est en charge de la protection du caractère démocratique de l’Allemagne fédérale. Son activité se partage entre surveillance des activités préjudiciable à l’ordre constitutionnel au niveau fédéral comme au niveau des états fédérés (extrême gauche, extrême droite etc), la protection du secret industriel et le contre-espionnage. Pour ne pas devenir une nouvelle Gestapo, le BfV n’a aucun pouvoir de police. Cet aspect est bien évidemment de première importance à sa création : il a interdiction d’employer de manière officielle et pérenne d’anciens membres du renseignement nazi. Pour les mêmes raisons et comme la DST à sa naissance en 1944, le BfV ne bénéficie pas d’archives de police.
Si la RFA est la cible de tous les services de renseignement de l’Est, elle est particulièrement ciblée par les différents services de la RDA (75 % des opérations détectées selon l’auteur), les civils du HVA en tête. Minoritairement intéressé par les forces armées tant allemandes qu’otaniennes présentes sur le sol ouest-allemand, le HVA a pour cible première les différents ministères fédéraux, la chancellerie, les partis politiques et les médias, mais l’espionnage technologique prend une importance grandissante avec les années, tant dans les entreprises que lors des foires organisées en RDA.
Le HVA peut agir tant en RDA (par l’intermédiaire d’antennes locales) qu’en RFA, où il constitue dès la fin des années 1940 des réseaux avec des résidents illégaux qui gèrent agents et sources. La porosité de la frontière inter-allemande avant l’érection du Mur en 1961 est bien évidemment un atout de taille pour le HVA, en plus de la proximité culturelle, du moins dans les années 1950. Les premières opérations de contre-espionnage sont le fruit de prises sur le fait ou de remontées d’informations par ceux qui sont approchés. Mais avec le Mur, les agents du HVA sont obligés de passer par des points de contrôles du fait de la diminution drastique du nombre de points de passages entre l’Est et l’Ouest. Des avancées méthodologiques permettent un meilleur tamisage de la part du BfV. Premièrement, ceux des Allemands de l’Est qui se relocalisent à l’Ouest (parce que cela reste possible) sont interrogés et fichés. Puis l’accent est mis sur la surveillance des enregistrements des nouveaux résidents dans les communes (une obligation légale en RFA), leur provenance mais surtout s’ils se sont mariés peu de temps après leur arrivée, que ce soit au Danemark, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne (où le mariage sans délai de publication des bans et sans vérification préalable de bigamie est possible), qui est une manière classique au HVA pour solidifier une légende. Cette surveillance des fichiers de résidents (Opération Anmeldung) bénéficie des avancées de l’informatique dans les années 1970 mais est freinée par les considérations sur la protection de la vie privée qui montent en parallèle de ces mêmes avancées (première loi fédérale de protection des données en 1977). Le BfV veut aussi agir contre le recrutement de secrétaires par les agents des services ennemis, appelés Roméo, dont certains premiers contacts ont lieu lors de vacances dans les démocraties populaires, mais qui agissent aussi sur le territoire de la RFA. La publication de fausses annonces matrimoniales dans le but de débusquer ce genre d’agents ne donne cependant pas beaucoup de résultats.
Le contrôle des voies d’accès au territoire ouest-allemand comprend aussi la surveillance des ondes au travers d’un département dédié. C’est ce qui permet notamment en 1974 d’arrêter Günter Guillaume, très proche conseiller du chancelier W. Brandt et officier du HVA. S’ensuit une grave crise politique et la démission du chancelier Brandt, alors que le BfV alertait l’échelon politique depuis un an. Le BfV ne fait pas que débusquer des agents, il tente aussi d’en retourner (c’est l’objet du huitième chapitre). Il poursuit ainsi deux objectifs : le premier est de plus facilement repérer des opérations du HVA, mais à plus long terme, d’alourdir les coûts de formation et d’insertion des agents hostiles pour assécher les finances du HVA. M. Wala a compté 2500 tentatives de retournement d’agents entre 1950 et 1990, les trois quarts concernant des services de la RDA. Plusieurs centaines de ces opérations ont duré pendant plus de vingt ans (20 % des agents du HVA en RFA ont été actifs plus de vingt ans, une proportion sensiblement égale). Un changement d’allégeance qui pouvait avoir des conséquences, surtout que le contre-espionnage du BfV a aussi connu des taupes qui de là purent avertir Berlin-Est (l’une d’elles avait connaissance de 816 opérations et avait pris part à 346, laissant le service en ruine en 1985 à sa défection). D’autres se transportent en RDA et monnaient là-bas leurs connaissances.
Quand en 1990 la RDA se dissout et avec elle ses services de sécurité, les agents du HVA sont accueillis à bras ouverts au BfV s’ils aident à démasquer le millier d’agents restants (lesquels pourraient proposer leurs services à d’autres et en premier lieu le KGB) mais ont aussi permis au BfV, souvent contre rémunération, de mesurer à quel point certaines de ses faiblesses étaient exploitées. Et le 3 novembre 1990, le BfV peut agir dans l’ancienne RDA et prendre contact avec d’anciens chefs de département du HVA. Cela conduit à la transmission de 1558 dossiers à la procurature fédérale jusqu’en 1998 (une bonne partie grâce à une liste d’agents donnée par la CIA, liste dite « Rosenholz »), conduisant à 189 condamnations. Certaines taupes du BfV qui habitaient en RDA à ce moment là avaient depuis bien longtemps été exfiltrées par le KGB.
L’ouvrage parvient à faire un mélange équilibré entre approches générales (y compris les luttes d’appareils entre les différents services ouest-allemands) et cas particuliers dont certains sont décrits très en profondeur, dans un développement mariant avec doigté le chronologique et le thématique. Les statistiques en fin d’ouvrage sont une sorte de couronnement, démontrant la grande liberté qu’a eu M. Wala dans les archives du contre-espionnage. Une liberté qui se confirme quand l’auteur dit que la relecture de sécurité par le BfV n’a conduit qu’à deux modifications, alors que les noms en clair ou les sommes d’argent données aux informateurs sont très nombreux. L’ouvrage est d’une lecture assez commode pour un bon germanophone, même avec le jargon et les acronymes sans lesquels il aurait été difficile de faire. Si les illustrations dans le texte ne comportent pas d’organigramme qui aurait été fort utile pour comprendre la répartition entre le fédéral et les régions, elles montrent toutefois à voir, entre autres choses, des statistiques internes ou des fiches avec des photographies d’agents du HVA. D’abondantes notes, une bibliographie et un index complètent un texte de 280 pages. On pourra seulement regretter une parcimonie trop grande des dates qui demandent souvent au lecteur de revenir sur ses pas pour retrouver l’année considérée. En définitive, un très bon ouvrage ne puisant pas seulement aux sources classifiées, écrit par un historien qui n’a pas de bilan à défendre et qui a très visiblement rempli le cahier des charges.