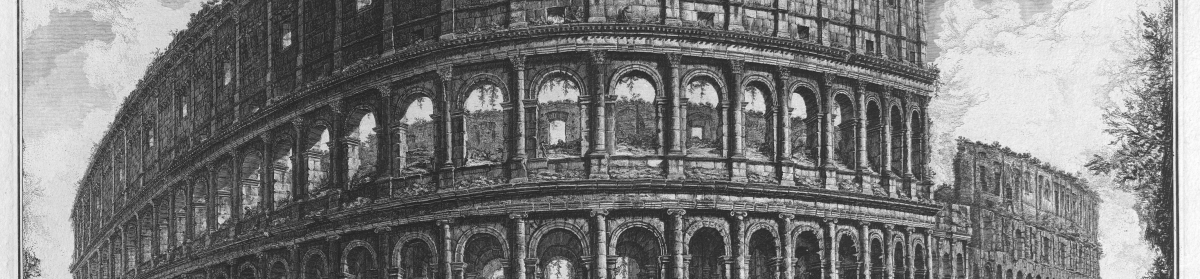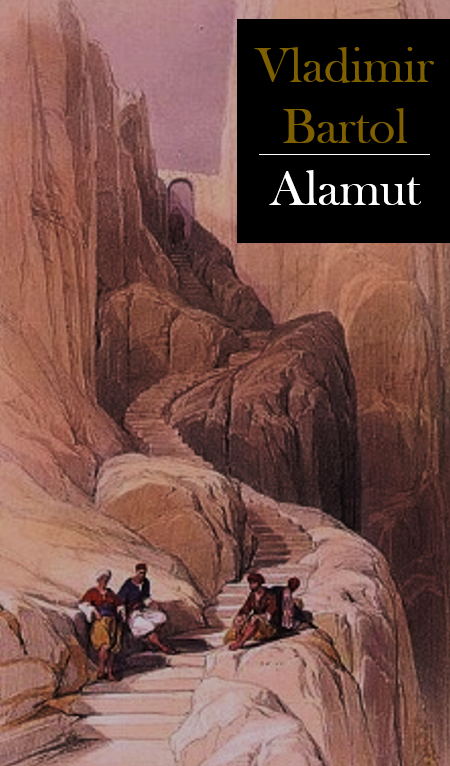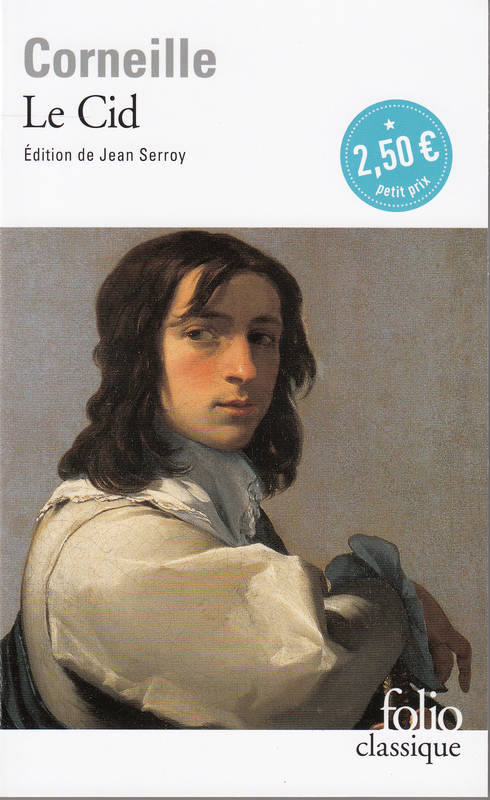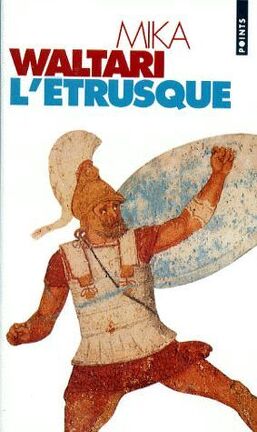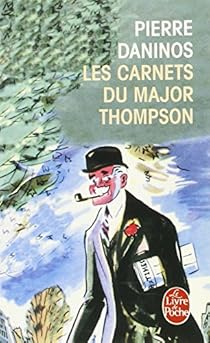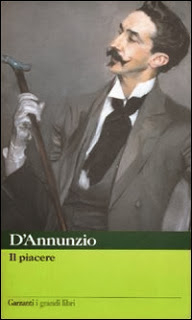Auschwitz, les Français, la mémoire
Essai d’histoire culturelle de François Azouvi.

Jamais l’Histoire n’avait tant ressemblé à l’Ancien Testament ! Albert Béguin, le 24 août 1945 dans Témoignage Chrétien, cité p. 54
Nous avons, il semble, pris la trilogie par le milieu en lisant Français, on ne vous a rien caché. La Résistance, Vichy, notre mémoire de F. Azouvi. Si rien ne manquait à la lecture de ce livre pour permettre sa compréhension, l’auteur avait changé d’avis sur le « Syndrome de Vichy » après l’écriture du Mythe du Grand Silence. Il reste que les deux sujets ne sont pas liés que chronologiquement, ils sont aussi liés dans la manière dont ils sont perçus à partir des années 1970 : la « découverte » de ce qui était connu de quasi tous mais où ces mêmes personnes veulent se persuader que c’est un scandale nouveau. Ce nouveau paradigme, français et occidental, qui voit la victime supplanter le héros entre 1945 et les années 1970, se met en place de manière très progressive et, bien sûr, avec de multiples facteurs.
F. Azouvi commence donc son analyse en 1944 avec la manière dont l’opinion publique apprend de manière libre, avec la reparution des journaux, la génocide des Juifs. Entre l’été 1944 et le début de l’année 1945, de nombreux articles parlent du sujet dans des journaux tant nationaux que locaux, confessionnels ou militants. Les déportés font clairement partie des « catégories d’absents » (W. d’Ormesson cité p. 25) et les photos de charnier ne sont pas absentes. Assez rapidement, une production littéraire apparaît, basée sur ce qui est su à la fin de la guerre. La souffrance spécifique des Juifs est donc connue des Français, mais elle prend place au sein d’un paysage de résistants fusillés et déportés et de victimes des combats. Il y a la volonté chez certains auteurs (y compris le grand rabbin de France p. 69) d’héroïser le déporté juif pour le placer au même niveau que le résistant déporté pour ses actes et pas pour ce qu’il est. Cette approche « franco-judaïque », être victime parce que Français, est aussi une manière de ne pas donner rétrospectivement raison aux Nazis (p. 41). D’autres enfin, plutôt catholiques, tentent de christologiser les victimes de l’Holocauste (le terme qui justement marque cette « annexion » chrétienne). Au sortir de la guerre, les élites intellectuelles françaises ne peuvent ignorer le sort des Juifs français et européens, un événement qui intègre les manuels scolaires dès la fin des années 40 (p. 64).
Le second chapitre explore l’entrée du génocide dans le monde de la fiction, tant romanesque que filmée. Les témoignages, nombreux dans les années 40, se raréfient dans les années 1950. De nombreux romans paraissent en France, essayant de rendre l’expérience concentrationnaire, vécue ou nom. Le Prix Goncourt récompense des romans qui abordent le génocide de près ou de loin en 1953, 1955, 1956, 1957 et 1959 (p. 121) ! Déjà en 1952 était publié un roman se plaçant du côté du bourreau avec Robert Merle: La mort est mon métier. Paru en 1950, le Journal d’Anne Frank est adapté au théâtre en 1957 et au cinéma en 1960. Les chiffres de vente du livre sont très important. Dès décembre 1945, le cinéma s’empare du sujet et une étape de plus est franchie en 1948, quand sort le film polonais La Dernière Etape, filmé à Auschwitz même. La décennie 1950 ne voit pas cette production s’assécher, tout comme la suivante.
La seconde partie du livre est consacrée par F. Azouvi à la place du génocide dans l’espace public. Au début des années 60 , deux évènements occupent l’espace public : le procès d’A. Eichmann à Jérusalem en 1961 (un consensus) et le succès polémique de la pièce de théâtre Le Vicaire (de R. Hochhuth) à partir de 1963. Le scandale du Vicaire, qui attaque frontalement Pie XII et son action durant la Deuxième Guerre Mondiale, prend justement place pendant le Concile Vatican II, moment de redéfinition des liens entre le catholicisme et le judaïsme. En fin de processus (en 1965), l’accusation de déicide à l’encontre des Juifs est retiré du Canon et disparaît de la liturgie pascale. Le lien entre le projet de réforme et le génocide est clairement fait par le cardinal Béa en 1963 (p. 196). En 1963 aussi, en même temps que sous l’influence de H. Arendt se trouve interrogée la « passivité » et la « collaboration »des Juifs, le génocide se trouve une métonymie : Auschwitz (p. 209).
Enfin, dans une dernière partie, F. Azouvi détaille à partir des années 1970 le changement de pied gouvernemental vis à vis du génocide, en même temps que s’impose la thèse du refoulé psychanalytique (p. 377, en France comme aux Etats-Unis) et que le génocide perd son horizon d’universalité (p. 329). En 1972 est révélé que le président Pompidou (en total décalage avec l’opinion publique p. 296) a gracié Paul Touvier, ancien milicien, en même temps qu’il demandait l’extradition de Klaus Barbie (ancien chef de la Gestapo à Lyon) à la Bolivie. Ce changement de pied se matérialise dans une politique judiciaire, bien dynamisée (souvent contre son gré) par S. Wiesenthal et les époux Klarsfeld. Le « consensus antitotalitaire » est fort, il y a une demande de compte générationnelle (pour qui sont-ils morts ? Pour Dieu, la France, rien ? p. 220), mais la libéralisation des médias permet aussi l’arrivée à lumière non seulement du révisionnisme mais aussi du négationnisme (p.317).
En 1987 a enfin lieu le procès Barbie. Celui qui a torturé J. Moulin est jugé pour la déportation des enfants d’Izieux. Pour l’auteur c’est la fin d’un processus de reconnaissance et de mémorisation du génocide en France (p. 382). L’Église catholique a fait acte de repentance en 1986, la même année où le maire de Paris J. Chrirac parle déjà de la responsabilité de la France au Vél d’Hiv’, annonçant le discours de 1995. En 1989, une plainte est déposée contre René Bousquet (ancien secrétaire général de la police de Vichy), un intime du président F. Mitterrand, que ce dernier ne peut plus protéger.
L’épilogue, enfin, aborde le devoir de mémoire et ses difficultés (Ricoeur et Todorov, Auschwitz comme tentation d’innocence p. 333) mais aussi l’attraction victimaire, chez les descendants ou d’autres groupes, mais également suscitant la mythomanie (fausse confession parue en 1995, p. 400).
Ouvrage très dense, documenté de manière très large, ce livre bénéficie en plus de l’usage d’une langue claire et légère. Ne s’interdisant pas des structures de chapitres complexes, il se lit avec un grand plaisir de lecture qui touche quand même à la dévoration. Mais sans se départir de sa scientificité, l’auteur laisse paraître un agacement face au phénomène de redécouverte, alors qu’à tout moment les informations sont là, distillées d’une infinie de façons, pour qui les cherche et enseignées de manière très précoce. Il y a bien sûr certains faits saillants, que nous ne pouvons tous citer ici, qui montrent que la réinvention de l’eau tiède est assez répandue. En 1947 par exemple est publié le premier livre consacré à la Résistance juive, distinguant ainsi héros et victimes, dans une claire échelle de valeurs (p. 69). Mais aussi qu’en 1953 est construit le premier monument commémoratif à Paris, avant Yad Vashem à Jérusalem. Un livre d’histoire des mentalités comme il y en a peu, un indispensable pour ceux qui veulent interroger les liens entre Histoire et Mémoire.
(les années 1970, c’est la mémoire chacun chez soi p. 329 … 8,5)