Manuel d’histoire de l’Egypte ancienne par John Romer.
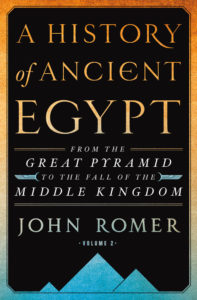
Le premier volume nous avait enthousiasmé en 2013 (ici), aussi c’est avec une joie anticipée que nous avons lu le second volume (initialement prévu en deux tomes, le série en contiendra finalement trois). La première partie concernait la période allant des premiers agriculteurs de la vallée du Nil à la construction de la pyramide de Khéops (IVe dynastie, environ 2600 a.C.) et cette partie permet un grand bond jusque vers 1780 a.C., à la fin du Moyen Empire (XIIe dynastie) et au début de la seconde Période Intermédiaire. La particularité de ce volume, et qui a nous a semblé plus forte que dans le premier volume, est qu’il mêle très intimement l’histoire et l’historiographie. J. Romer est par exemple très critique de ceux qui voient l’histoire comme une science, en étant très négatif sur le positivisme du XIXe siècle qu’il voit comme un précurseur direct du nazisme (p. xiv, p. 49, p. 56 par exemple). Mais cette méthode permet aussi de comprendre comment se sont dégagées progressivement nos connaissances sur l’Egypte ancienne, et c’est d’un très grand intérêt parce que c’est très bien fait (malgré quelques très rares longs détours).
La préface présente le livre et sert à mettre les choses au point concernant les noms propres (pas de grécisation, Khufu et pas Khéops) et comment on fait de l’histoire dans ces temps à l’écrit très rare et aux représentations graphiques pas toujours évidentes et d’évidence pas encore canoniques.
L’ouvrage est ensuite divisé en huit parties. La première décrit la transformation de la cour royale sous l’influence de l’écriture. Ainsi, aucune des grandes pyramides royales de Gizeh ne contient de texte. On ne peut pourtant pas dire qu’elles n’ont pas bénéficiées d’une attention soutenue de la part de la cour royale : sur le siècle qui sépare la première pyramide de Snefrou de celle de Kephren, il a fallu poser en moyenne 240 blocs de roche par jour (p. 3) ! Mais après la IV dynastie, en même temps que les pyramides baissent en taille, les tombes des courtisans se complexifient et s’embellissent. C’est là qu’apparaissent les premiers textes de ce qui deviendra le fameux Livre des Morts, que l’on retrouve sept décennies plus tard dans les pyramides (vers 2380 a.C.).
La seconde partie raconte comment et dans quel contexte J.-F. Champollion a réussi à proposer une lecture phonétique des hiéroglyphes. Influencé par quelques prédécesseurs et aidé par les travaux de l’Expédition d’Egypte, les propositions de Champollion n’ont pas rencontré que de l’enthousiasme et de la reconnaissance (p. 27-28). En premier lieu, par sa lecture, il remettait en cause les chronologies établies, et en premier lieu celle de l’Eglise (p. 42). Professionnellement grillé, Champollion part pour Turin où il peut traduire la liste des pharaons de Manetho, une avancée utilisée encore aujourd’hui en égyptologie avec son concept de dynasties. Deux décennies plus tard, les concepts d’Ancien, Moyen et Nouvel Empire sont forgés par C. Bunsen (qui avait assisté au déchiffrement à haute voix des obélisques de Rome par Champollion), avec les deux périodes de latence qui seront dénommées « périodes intermédiaires » dans les années 1920. Une troisième période intermédiaire Entre la fin du Nouvel Empire et la domination perse fait consensus dans les années 1960 (p. 48-50).
La troisième partie revient à la IVe dynastie en s’intéressant en particulier aux statues du sphinx et de Kephren et le faucon, avant de passer aux temples funéraires de Mykérinos, la place des reines dans le système de pouvoir, et l’introduction d’une notion différente du temps une fois que le plateau de Gizeh ne sert plus de nécropole royale à la fin de l’Ancien Empire. La quatrième partie continue donc la description de cet Empire qui maintenant sa résidence à Abousir. On y construit là encore des pyramides et des temples pour les pharaons de la Ve dynastie, ainsi que de nouveau à Saqqarah. J : Romer détaille aussi l’économie de l’offrande qui caractérise l’Egypte pharaonique, avec des surplus agricoles qui servent aux offrandes au roi, aux dieux et aux morts. Lieux importants pour le fonctionnement de ce système (p. 128), les temples solaires abritent des magasins mais surtout des abattoirs (deux temples de ce type ont été étudiés p. 123) devant alimenter les différentes parties de l’Etat (plus d’administration = moins de pyramide p. 146). Pour l’auteur, il n’y a pas d’impôts mais plutôt un système de dîme, sans pour autant qu’il faille voir cette dernière comme mesurée avec précision ni susceptible d’être complétée par des prélèvements supplémentaires locaux en cas de voyage du pharaon (comme il peut y avoir des levées pour les projets royaux, dont les 40 à 50 000 travailleurs mobilisés les premières années pour la pyramide de Kheops, p. 135). Cette parie aborde aussi le thème de la cour royale et du palais (en briques crues, ce qui facilite son itinérance) dans un pays qui ne compte pas de villes (p. 144). Memphis n’est pas une ville à cette période (en plus de ne pas être sur l’emplacement de l’actuelle commune qui porte ce nom), c’est une région en lien étroit avec tout le pays (chapitre 14) et les ressources qu’il contient, dont le cuivre indispensable à la construction en dur et à la production plastique, de plus en plus utilisé (p. 152). Ce chapitre conduit inévitablement à considérer les cultes royaux, dans un royaume considéré comme constitué par les choses visibles et les choses invisibles (p. 175 et p. 420).
La diffusion de plus en plus importante de l’écriture (tout en restant limitée à quelques milliers de personnes) permet de pouvoir retracer quelques parcours de vie de courtisans de l’Ancien Empire (cinquième partie), au travers de lettres royales recopiées dans les tombes de vizirs (chargés de missions royales localement ou pour tout le royaume) ou sur des papyrus recouvrés lors de fouilles. Les missions de ces vizirs sont discutées par l’auteur, surtout en tant qu’envoyés vers le Sud, à travers le Sahara, le Sinaï, le Levant ou le pays de Punt. Les côtes de la Mer Rouge voient la création de plusieurs ports (l’un l’est pour acheminer le cuivre sinaïte nécessaire à la construction de la pyramide de Kheops p. 269) où sont transportés des bateaux construit sur les bords du Nil avec du bois importé du Levant (les bateaux sont même dits de Byblos). J. Romer revient aussi dans cette partie sur les traces écrites dans pyramides les plus récentes de Saqqarah (avec une très grande place laissée à l’historiographie, très éclairant, formant presque un second récit).
Puis tout cesse. Plus aucune pyramide n’est construite. Certains temples et même des pyramides sont mis à sac. Commence la Première période Intermédiaire, entre environ 2200 et 2140 a.C. (sixième partie). Il semble qu’une baisse des crues du Nil ait déréglé toute l’organisation économique centralisée du royaume, avec un fort raccourcissement des circuits économiques et l’apparition de nouveaux villages sur des emplacements encore vierges. Des aristocrates se maintiennent cependant dans leurs terres, sans pour autant que l’on puisse dire qu’il y ait eu une concurrence féroce et violente entre eux (p. 307). Mais la fin de l’Ancien Empire accélère le développement de pratiques funéraires nouvelles (p. 310-311) avec l’apparition de statues en bois dans les tombes et des premiers masques mortuaires peints.
Puis, vers 2140, sortie de nulle part, une nouvelle dynastie (la XIe) apparaît qui parvient assez vite à réunifier le pays et à relancer une cour royale avec tout ce qui faisait sa fonction pendant l’Ancien Empire (septième partie). Ce dernier est une référence culturelle permanente. Thebes devient la résidence royale et le culte de Osiris est réformé tandis qu’est institué celui d’Amon-Rê (p. 339-344). Les tombes royales prennent la forme de longs temples, à l’entrée de ce qui va être la Vallée des Rois. La nouvelle cour thébaine (tout comme leurs successeurs de la XIIe Dynastie à Itj-towy) entreprend des expéditions pour s’approvisionner en matériaux nécessaires au culte : cuivre du Sinaï, encens du Sahara, merveilles de Punt, pierres précieuses du désert et alabastre de Moyenne Egypte. Le coût de ces expéditions est aussi élevé que la construction de grands monuments (p. 397-406). On peut aussi grâce aux inscriptions des tombes mieux définir les relations avec les voisins de Nubie et du Levant. Pour stabiliser le commerce avec la Nubie, une série de dix-sept forteresses est construite (p. 438).
La huitième partie explore l’établissement royal de Itj-towy (pas flamboyant p. 457) et ceux qui travaillent pour l’Etat au sein de différents établissements, tous dépourvus de place publique (p. 488). Un épilogue livre enfin quelques réflexions sur la culture de ce que l’auteur qualifie d’âge d’or tout en conseillant de ne pas se baser sur les histoires parfois fantastiques que la littérature égyptienne nous a transmis pour en tirer des enseignements d’histoire politique (p. 515-520) et à ne pas encore une fois transposer le XIXe siècle européen sur les antiques rives du Nil. La fin du Moyen Empire est-elle pleine de mystères, et la cause de la baisse de la hauteur des crues semble être exclue. Une chronologie royale, des indications bibliographiques rangées par chapitres et un index complètent ce livre.
Notre attente n’a pas été déçue, et si le l’ouvrage peut paraître gros (535 pages de texte), il se lit avec délectation. L’auteur s’y connaît en superbes descriptions (exemple p. 281) et le lecteur sent bien qu’il en a encore sous le pied en termes de renseignements mais qu’il ne veut pas trop charger la barque (solaire ?) et ainsi garder la très grande lisibilité qui caractérise cette série. Le livre est de plus très richement illustré à l’aide de cartes, de dessins, de croquis et de photographies (en couleur dans les deux cahiers centraux). C’est, comme le premier volume, l’aboutissement d’une vie de recherche et J. Romer a l’extrême bonté d’en faire profiter le lecteur (qui n’a pas besoin d’être un spécialiste).
Une synthèse d’une grande pertinence et puisant aux avancées les plus récentes, écrite avec une passion communicative.
(Pharaon, c’est un rural p. 162 …8 ,5)
