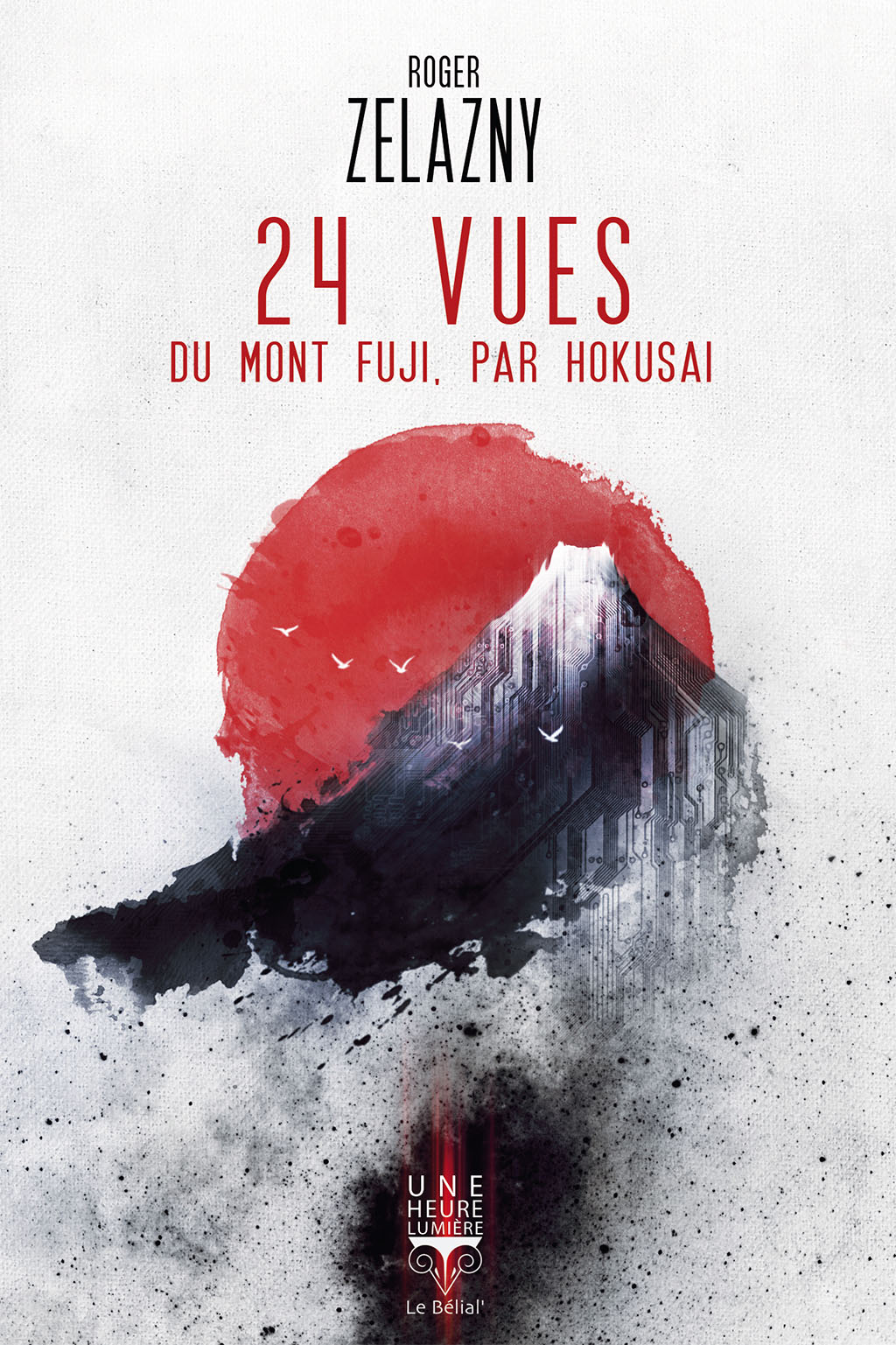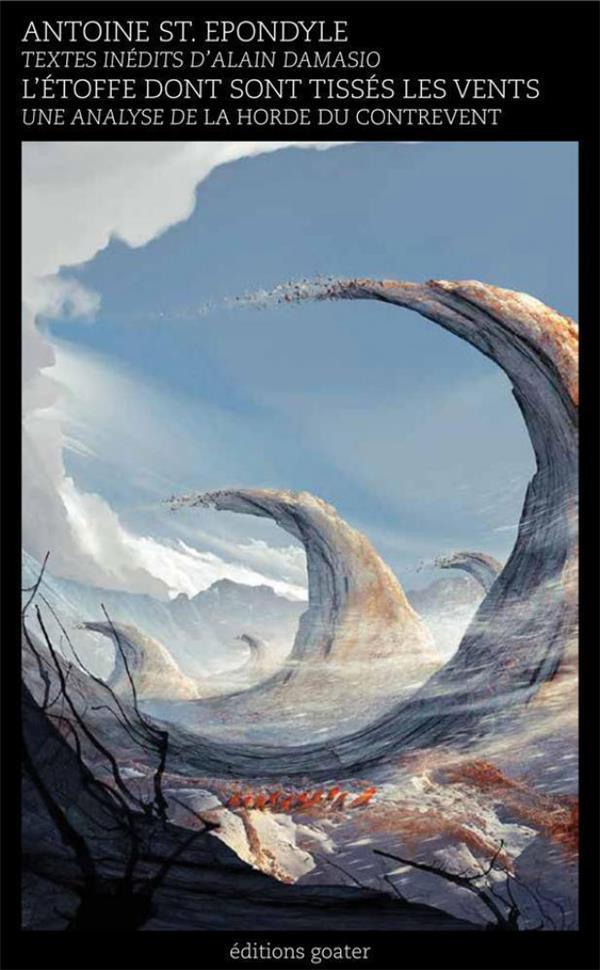Roman de science-fiction de René Barjavel.
Elle avait ces traits reposés et cet âge indéfini des femmes à qui les satisfactions de l’amour conservent longtemps la trentaine. p. 12
Paris, 2052. La ville a d’une certaine manière appliqué le plan Voisin (p. 23). Entourée d’autoroutes, desservie par des bus aériens, munie de lignes de métro sur cinq niveaux, d’énormes tours ont été de plus construites, sur le modèle corbuséen. La ville a absorbé tout son environnement, les cimetières ont été remplacés par des conservatoires domestiques des morts. Elle est ceinturée de jardins et de fermes, mais au-delà, c’est le désert, ou plus exactement une savane jaunie par une température caniculaire. De l’autre côté de cette savane, une autre ville et ainsi de suite. Il n’y a quasiment plus de campagne, rien que des villes, congestionnées de voitures, minérales et étouffantes.
François Deschamps et Blanche Rouget, deux amis d’enfance, viennent d’un de ces endroits reculés en Provence, éloignés de tout, où l’on cultive encore à l’ancienne, dans la terre et pas dans ces usines agroalimentaires qui pourvoient à tous les besoins des villes. François étudie à Paris pour devenir ingénieur agronome (et est peintre amateur) et Blanche y poursuit aussi sa scolarité (ménagère). Mais Blanche a été sélectionnée pour devenir la prochaine vedette de la station de télévision Radio-300, tout en éveillant l’intérêt du directeur Jérôme Seita, un homme richissime et influent. Ce dernier, sentant que François est un danger pour ses plans concernant Blanche, fait capoter l’admission de François et couper l’eau et l’électricité de son logement déjà spartiate (très bohême par ailleurs).
Au moment où doit débuter la soirée qui doit lancer la nouvelle vedette, une panne d’électricité générale arrête l’activité citadine, démagnétise les aimants (qui garnissent aussi de nombreux habits) et rend inutilisables les objets ferreux … Plus rien ne fonctionne et plus rien ne se remet en marche. Plus de locomotion, plus de télécommunication, plus d’eau courante, plus d’usine d’alimentation … La catabase commence.
François part retrouver Blanche pour la sauver du cataclysme qui engloutit inexorablement la civilisation quand les besoins primaires ne peuvent plus être assouvis dans une ville moloch.
Le thème de ce livre est maintenant à la mode et il est assez étonnant que personne n’ait déjà fait un film avec un tel scénario, alliant la science-fiction à quelques éléments fantastiques. La classification de l’œuvre elle-même peut varier dans le temps : en 1943, c’est clairement de la science-fiction mais en 2021, on peut voir un glissement vers l’anticipation (liseuses dans les trains p. 20, parmi d’innombrables exemples). Plein d’inventions de 2052, sans doute étonnantes au moment de l’écriture, nous sont déjà connues mais surtout l’aspect climatique est aujourd’hui moins rocambolesque.
Au niveau de l’écriture, on est dans un récit cru, un peu manichéen dans certaines oppositions (François et Jérôme), parfois sans trop d’épaisseur dans les personnages (Blanche perd beaucoup de temps d’action au cours du livre par exemple, disparaît presque une fois partie de Paris) et avec un héros qui se révèle du jour au lendemain, passant du gentil garçon provincial (et vieux moraliste p. 70) au survivant parfait logisticien et prêt à tout, jusqu’au meurtre de sang-froid, pour parvenir en Provence (et s’échapper de Sodome et Gomorrhe, p. 175-176 ?).
Le texte est parsemé de références plaisantes, tout en ironie. Les artistes et les médecins n’évitent pas les piques (p. 25-26 par exemple) et quand on parle de vivre dans « l’ère de Raison » (p. 16), on sait que cela va mal tourner ! On a quelques petits moments absurdes (une photographie du cuirassé Strasbourg dans la chambre de Blanche p. 37, même si au vu du contexte on peut aussi interpréter différemment ce motif). L’expression est poétique, mais beaucoup moins que dans L’Aube des temps (voire ici), mais c’est aussi 25 ans d’expérience qui entrent en jeu chez l’auteur. Des « défauts » de jeunesse que l’on peut aussi voir à notre sens dans quelques trous d’air du récit, qui ne font pas tourner les pages aussi vite que l’on pourrait le vouloir.
L’influence de mai-juin 1940 semble immense dans ce roman, avec par réfraction, celle de 1918. La fin d’un monde, c’est clairement ce qui est vécu en France et à Paris à l’été 1940. L’exode, la privation, l’abandon, l’ensauvagement, tous sont d’actualité à des degrés divers trois ans avant la parution de ce livre, avec son corolaire du retour à la campagne, voire à la terre. Est-ce pour autant un livre pétainiste ? Certes, l’auteur est très féroce avec le gouvernement (ses ministres baroques, son chaos, son incompétence, ses militaires archaïques p. 186) dans lequel on pourrait reconnaître une Troisième République (vue par les collaborationnistes ?). Mais l’alternative proposée, une fois la cendre retombée, n’est pas non plus une Arcadie hors du temps. Si l’on pousse un peu et que l’on met de côté l’antimachinisme, on pourrait presque y voir quelques bouts de Führerprinzip (p. 299-300) … On ne peut pas dire que la réapparition d’un roi-prêtre à la mode mésopotamienne après la tabula rasa soit auréolée de la préférence de l’auteur (dans le traitement ironique de la nouvelle organisation sociale, dans ce retour à l’Age de Bronze p. 298-299). A lui aussi, son pouvoir est limité et la fin de l’histoire n’est qu’une illusion. Mais nous racontons déjà bien trop de la fin du roman, tout en désirant en dire beaucoup plus sur ce roman plein de pépites (le bon temps de 1939, p.86).
Ce que R. Heinlein craint dans Waldo en 1942 se réalise la même année dans Ravage.
(l’auteur fait détruire sa propre ville de naissance p. 296 … 6,5)