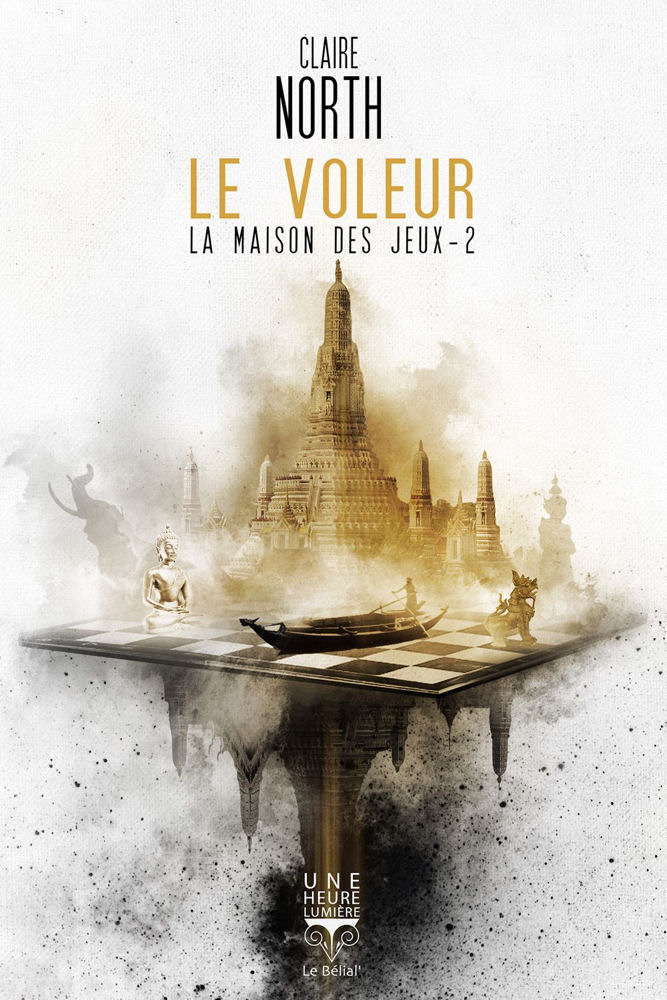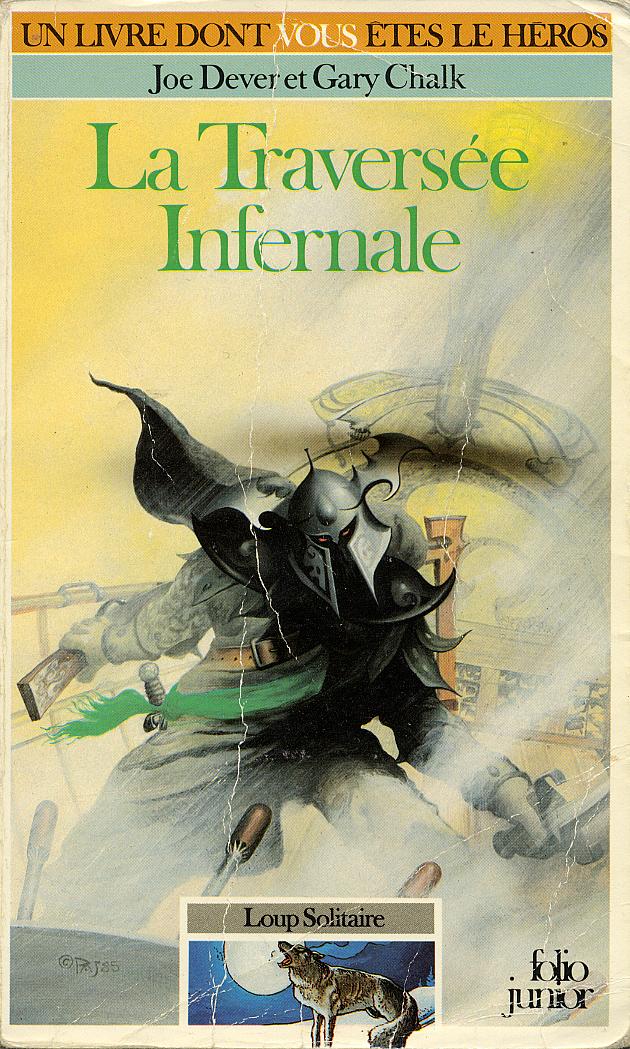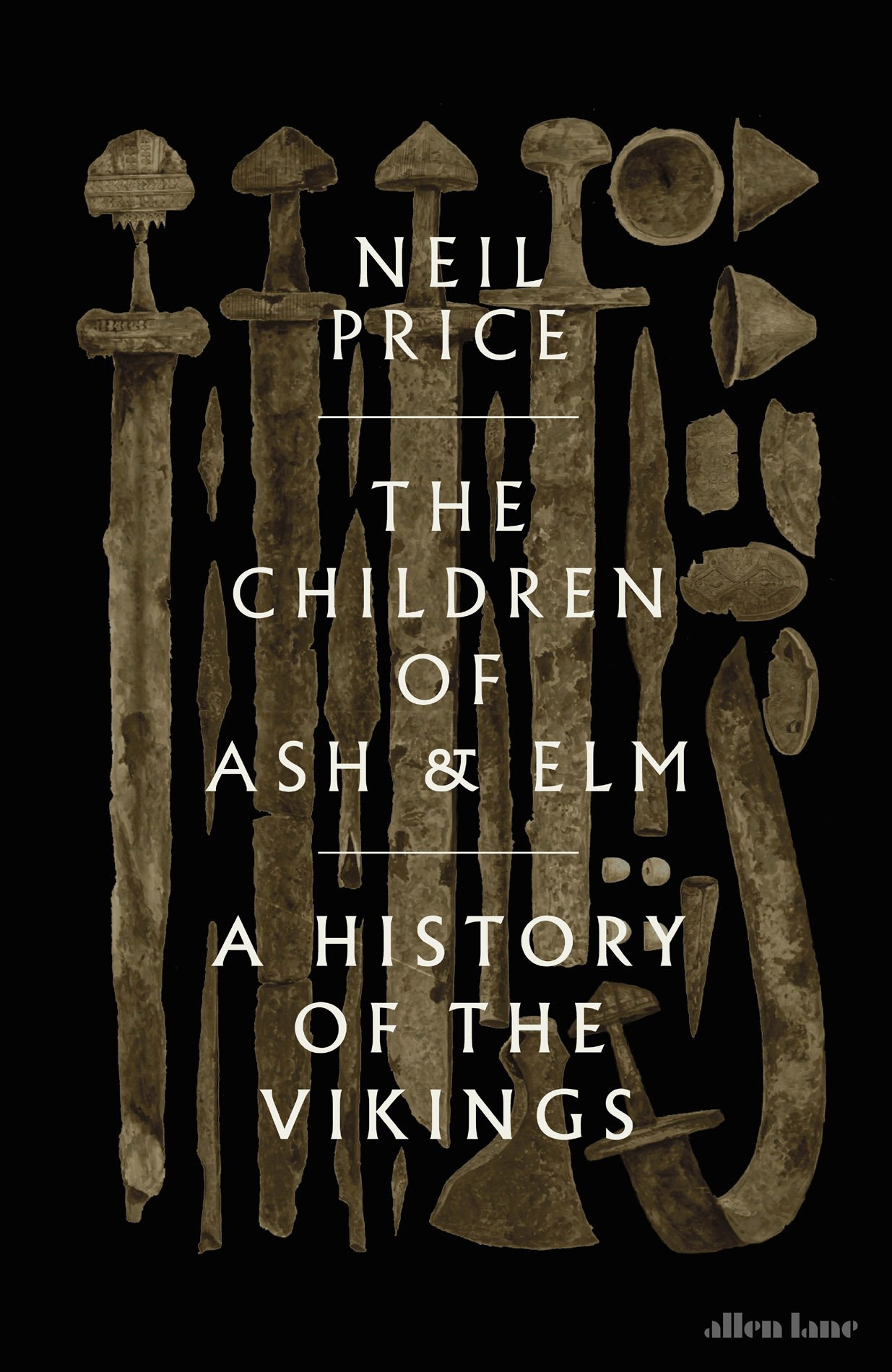Comment les armées évoluent
Essai historique sur l’innovation et les armées par Michel Goya.
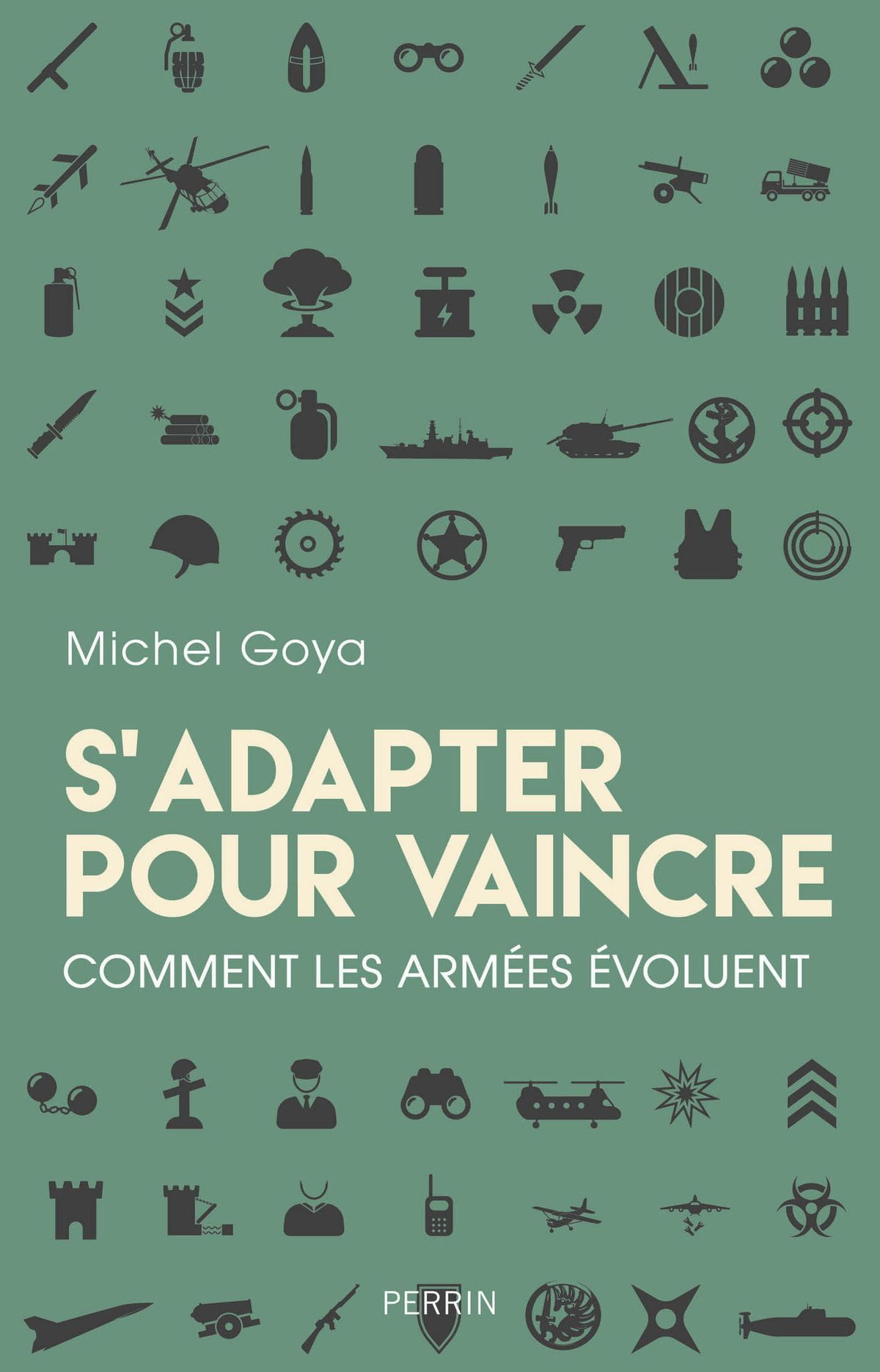
Dans la dialectique de l’affrontement, les acteurs peuvent prendre conscience de défauts, de manques qu’ils ont, tant au niveau matériel qu’au niveau de leurs pratiques (doctrines, tactiques, etc). Ils ont alors parfois l’idée de s’améliorer, de s’adapter à la situation, ce qui peut en retour déclencher un processus d’adaptation chez l’adversaire et ainsi de suite. C’est ce processus que veut distinguer M. Goya dans ce livre en prenant appuis sur sept cas concrets, étalés sur deux siècles.
Le premier de ces cas est l’armée prussienne, cueillie à froid par la rencontre avec les armées de la Révolution et de l’Empire. Pour remédier à son problème de nombre, elle met en place un système de réserves qui lui permettent d’aligner beaucoup plus de régiments quand elle reprend le combat et participe à la bataille de Leipzig (1813) ou lors des Cent Jours. Son effort organisationnel se double de la mise en place d’un état-major suprême permanent, une première mondiale (alors que les autres puissances montent une structure de commandement à chaque nouveau conflit), associé à un institut de formation supérieur, la Kriegsakademie. L’effet se voit entre 1864 et 1870, entre la guerre du Schleswig, la guerre contre les Habsbourg et la guerre contre la France, où la Prusse établit sa domination dans l’espace germanique puis en Europe, appuyé sur un matériel qui fait changer du tout au tout les tactiques héritées du XVIIIe siècle. Pour la IIIe République, la défaite n’est pas encore étrange, mais bien intellectuelle.
La France est justement le cas suivant de l’auteur, avec un chapitre sur ce qui est sa grande spécialité : l’innovation lors de la Grande Guerre. Passé la redécouverte que la puissance de feu annihile toute idée de manœuvre en terrain découvert, l’armée française doit gérer la stagnation du front, conséquence de l’enterrement. S’ensuivent de très nombreux processus d’apprentissage (la guerre de tranchée, ou plutôt son retour) mais aussi d’innovations techniques, tactiques et doctrinales qui doivent permettre de dépasser le blocage. Faire plus n’a pas marché (un plus gros assaut), il faut donc faire différemment : le tank, l’avion, le camion mais aussi l’équipement de l’infanterie en armes collectives, une logistique repensée avec les besoins fous en munitions et la nécessité de pouvoir déplacer des troupes en quantité et rapidement là où il n’y a pas de voies de chemin de fer.
Dans le troisième chapitre, on assiste au premier changement de milieu du livre avec les évolutions de la Royale Navy entre 1880 et 1945, entre le premiers cuirassés à propulsion motorisée, les Dreadnoughts et le lent déclin qui fait suite à la Première Guerre Mondiale, entre concurrence internationale à peine masquée par les accords de limitation de flotte et ratage du tournant de l’aéronavale dans les années 1930. En réalité, la Grande-Bretagne combat en 1940 avec la flotte de 1920 et tout ce qui a été construit pendant la Deuxième Guerre Mondiale n’existe plus en 1962, parce qu’économiquement insoutenable (p. 146).
Parallèlement, la Grande Bretagne devait aussi équiper sa nouvelle armée née en 1918, la Royal Air Force. Cette dernière, dans un grand élan douhetiste, devait bombarder l’Allemagne pour forcer sa population à demander l’arrêt des hostilités. La tâche est confiée au Bomber Command, tandis que les Etats-Unis déploient la 8e et la 15e Air Force avec le même objectif. De jour (les étatsuniens) comme de nuit (les britanniques), deux millions et demi de tonnes de bombes sont lancées sur l’Allemagne entre 1939 et 1945. C’est l’équivalent de 300 bombes A. Les dégâts de tous ordres sont considérables, mais les assaillants eux-mêmes perdent 40 000 bombardiers et 100 000 aviateurs.
Le chapitre suivant détaille les changements qu’induit l’arrivée de la bombe atomique, créée dans un contexte de guerre et dont l’utilisation se fait dans un contexte de grands bombardements meurtriers au Japon. Mais sitôt après la première utilisation, la théorie rattrape la pratique. Cinq ans après, elle n’est pas utilisée en Corée et le niveau gouvernemental ne laisse pas le militaire libre de faire ce qu’il veut. Il y a un peu l’inverse dans le sixième chapitre ou le gouvernement laisse faire le militaire, voire même l’abandonne : en Algérie. Mais ici, pas question d’usage d’armes atomiques. Il faut revenir à la guerre au milieu des populations, alors que presque tout l’entraînement tourne autour du futur choc avec les troupes soviétiques. Il faut donc s’adapter, comme prendre acte que les hors-la-loi attaquent les militaires, que l’aviation à réaction ne sert à rien et que l’hélicoptère a autant de noblesse que le saut opérationnel.
M. Goya s’attaque ensuite aux évolutions de l’US Army entre 1945 et 2003, entre une réduction de 90 % une fois la guerre finie et l’apparition d’un nouvel ennemi stratégique et la guerre en Iraq. Une fois l’emballement nucléaire dépassé, la confrontation avec la guerre insurrectionnelle est traumatisant, d’autant plus qu’il n’y a finalement très peu de combattants, trop de services de soutien et d’état-majors (un colonel pour 163 personnels en 1968 au Viêt-Nam p. 329) et trop de rotations pour accumuler de l’expérience. Préparée pour l’AirLandBattle contre le Pacte de Varsovie, l’US Army se retrouve à devoir négocier avec des chefs de villages afghans …
Comme à chaque fois, avec M. Goya, on en a plus que pour son argent. Voilà 370 pages de texte bien dense, mais toujours agréable à lire. L’appareil critique a été réduit mais les lecteurs intéressés trouveront néanmoins plein de choses dans les notes. Sur la forme, un bon mélange entre l’érudition et la volonté de chercher un public large mais un minimum informé. Une relecture plus attentive encore de l’éditeur aurait pu éviter quelques maladresses résiduelles. Pour ce qui est du contenu, la partie sur la Première Guerre Mondiale sort du lot, parce qu’elle est clairement la spécialité de l’auteur (comme on a déjà pu le voir dans ses autres ouvrages chroniqués dans ces lignes). Nous pourrions discuter de la biographie de von Moltke (p. 32) ou de l’éventuelle surestimation de la Gestapo (p. 193), mais ce ne sont là que des vétilles, surtout s’il l’on met en regard la réflexion sur ce qu’aurait apporté la bombe atomique à la France en 1939 (p. 198), les équivalences de coût du V2 (p. 179) ou l’excellent résumé des contraires tactiques à réconcilier à la fin du XIXe siècle (p. 40) ou encore le passage sur la terrible erreur de diagnostic civil et militaire faite en 1954 en Algérie (p. 262).
Dans l’attente de l’analyse du conflit russo-ukrainien par M. Goya une fois ce dernier fini …
(au Viêt-Nam les combats sont trop rapides pour que les appuis puissent intervenir p. 330 … 8)