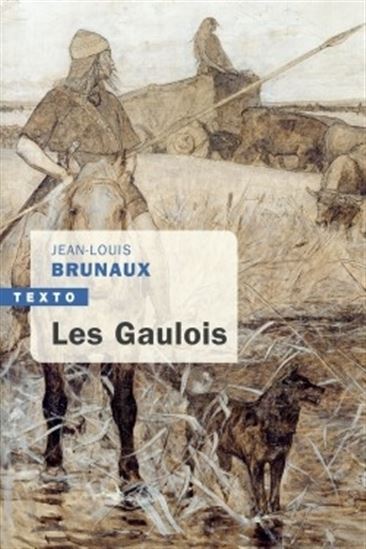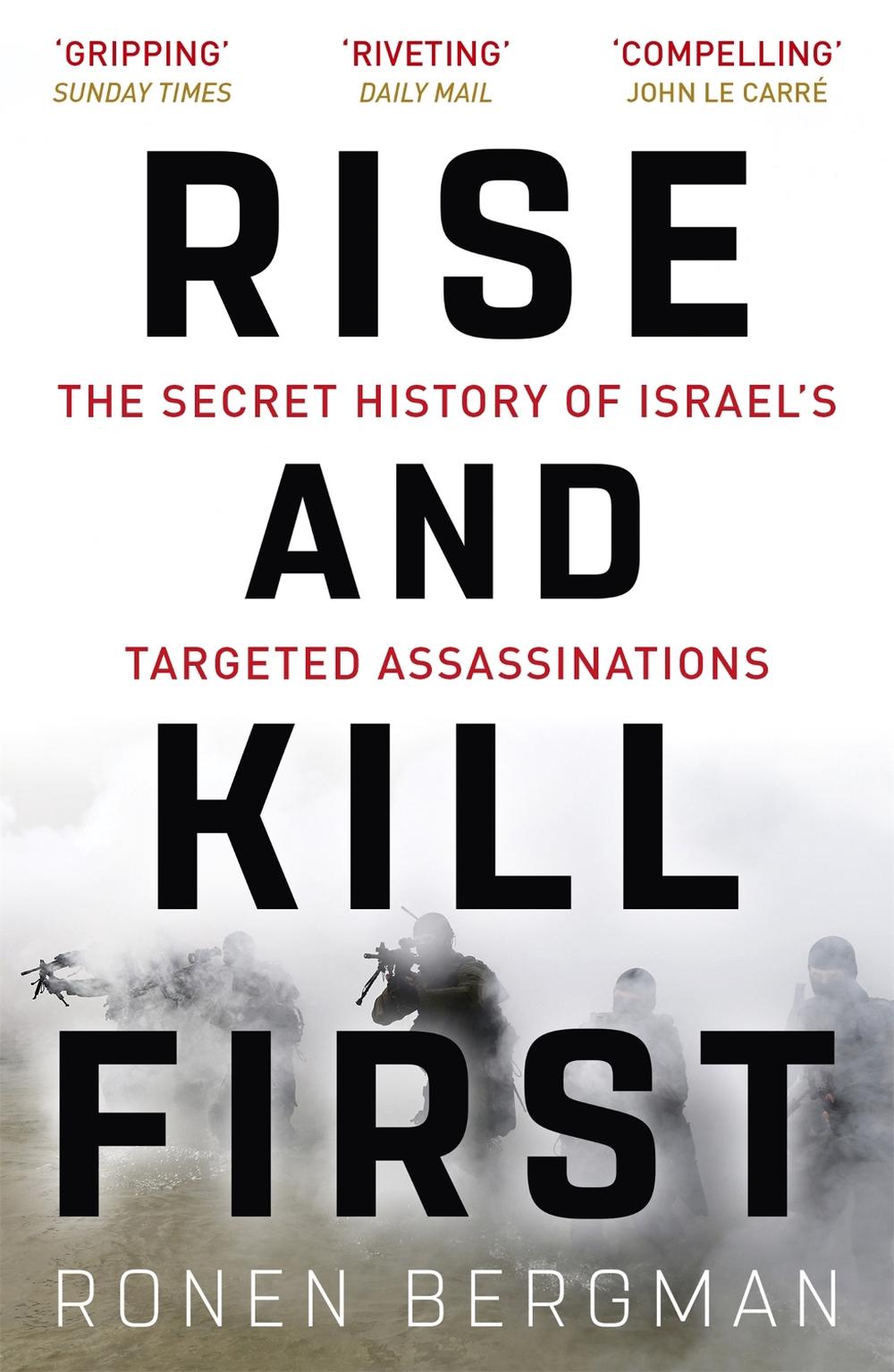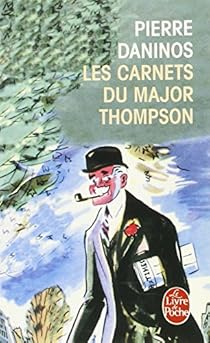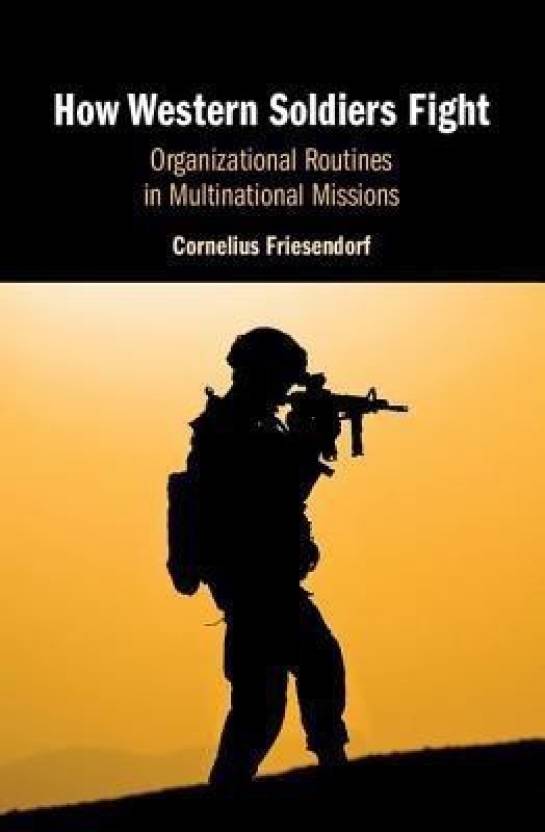Roman de science-fiction de Robert Silverberg.
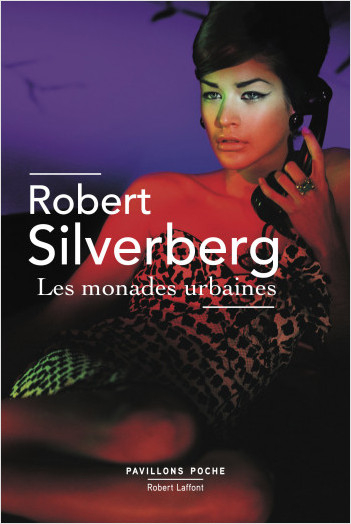
Mille étages, 3 000 m de hauteur, 885 000 habitants. Après l’effondrement, l’essentiel des habitants de la Terre s’est rassemblé dans ce type de bâtiments imposants appelés monades, laissant l’agriculture à quelques petites communes fortement robotisées qui alimentent ces mêmes monades. Des points de civilisation dans des déserts entretenus par des robots jardiniers, où personne ne va n’y ne désire aller. Grace à cette organisation, l’Humanité compte 75 milliards d’habitants sur Terre au XXIVe siècle. Pour faire tenir autant de personnes en un espace restreint, une organisation socio-spatiale est impérative. Chaque tour est donc divisée en plusieurs villes de manière verticale, peuplées selon les occupations des habitants. Au sommet, dans Louisville pour ce qui concerne la monade 116 qui est le cadre du roman, vit l’élite dirigeante de la tour.
Soi-disant débarrassée des tabous d’avant l’ère urbmonadale, la monade est dominée par la religion de la reproduction, entre liberté sexuelle obligatoire et drogues. Etrangement, le mariage existe toujours. Et quand la population devient trop importante, une partie de cette dernière est envoyée peupler une nouvelle monade.
C’est dans cet environnement que prennent place plusieurs arcs narratifs, avec des personnages liés entre eux d’une manière ou de l’autre. On suit ainsi (dans de nombreuses saynètes) Charles Mattern le socio-computeur, le musicien Dillon Chrimes, l’ambitieux administrateur Siegmund Kluver et sa magnifique femme Mamelon, les jumeaux Micael et Micaela Statler ou encore l’historien Jason Quevedo. La fiction d’un bonheur intemporel qui serait celui de la monade ne survit pas aux toutes premières pages du roman, quand Charles Mattern reçoit un visiteur venu de Vénus pour étudier la société urbmonadale. Déjà le doute s’insinue dans l’esprit du socio-computeur. Mais qui fait acte de rébellion dans un espace fermé (sans extériorité, c’est à dire une monade au sens de Leibniz) est éliminé séance tenante …
Ce roman est à juste titre un grand classique de la science-fiction urbaine. Il doit beaucoup à son époque de production (première publication en 1971), avec son approche littéralement très « sex, drugs and rock n’roll ». R. Silverberg accole même Mick Jagger à Bach et Wagner (p. 104). Il est critique à la fois de la surpopulation (explicite p. 267 et son corollaire la sururbanisation) qui ne peut que déboucher sur un système au mieux dirigiste, au pire totalitaire (p. 137, reconditionnement mental p. 80) couplé à un certain jeunisme (les soixante-huitards ?) que voit peut-être poindre l’auteur. A la page 182, il est même question de parler politique dans un monde qui en semble dépourvu, parce qu’il s’est privé de temps (un contre-exemple p. 187 ?). R. Silverberg intègre aussi dans son monde le problème de la gestion des sols arables, à un moment où le Club de Rome n’a même pas encore publié son rapport sur les limites de la croissance (1972). En allant plus loin dans cette direction, faut-il voir aussi dans ce roman une aversion pour le littéralisme évangélique (croissez et multipliez) ?
La critique antitotalitaire nous semble cependant rester au premier plan. Malgré la monade, malgré la pression sociale de tous les instants, le bonheur est lui-même obligatoire et l’Homme reste l’Homme : il n’y a pas eu de modification génétique après l’effondrement et la construction des monades, comme le montrent aussi les habitants des communes agricoles. La part animale de l’Homme, tout comme sa curiosité, n’ont pas été effacés par la satisfaction assurée de tous les besoins primaires. Les habitants doivent donc survivre, « se déguiser un peu mieux » (p. 177).
Ces thèmes, que l’on peut estimer trop nombreux pour un seul roman, sont admirablement agencés par R. Silverberg pour donner naissance à cette dystopie. Avec très peu de temps morts, une très belle économie de moyens, des articulations fines et des dialogues efficaces, l’auteur est parvenu à donner naissance à un monde où affleure l’explosion.
Ce roman est resté le classique qu’il était déjà au moment de la première publication française en 1974.
(mais pourquoi s’appelle-t-il Siegmund ? …8,5)