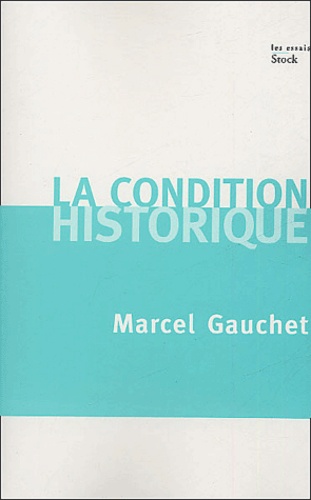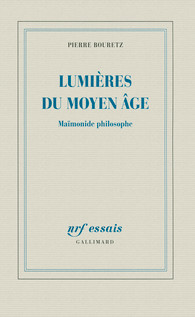Entführungen von Westberlinern und Bundesbürgern durch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR
Thèse en histoire contemporaine allemande de Susanne Muhle.

En 1949, prenant acte de la distance installée entre les alliés occidentaux et l’allié soviétique, se constituent deux Etats allemands : la République Fédérale d’Allemagne et la République Démocratique d’Allemagne. La première regroupe ainsi sans les fusionner les trois zones d’occupation française, britannique et étatsunienne et la seconde s’établit dans la seule zone soviétique. Il va sans dire que leurs accointances politiques reflètent ces relations. Le cas de Berlin, ville divisée elle aussi en quatre zones, est particulier. En 1949, la ville n’est officiellement rattachée à aucun Etat, aussi Berlin-Ouest ne fait pas partie de la RFA et des lois différentes s’y appliquent. Deux administrations s’y font, dès l’arrivée des troupes d’occupation, concurrence. La volonté soviétique d’obtenir une Allemagne unifiée dans son orbite et une capitale totalement intégrée à sa zone d’occupation est mise en échec (après blocus). Pire, le manque de légitimité de la RDA, qui se matérialise par la fuite ininterrompue de ses habitants vers Berlin-Ouest, conduit la dictature du SED (Parti Socialiste Unifié, le parti unique) à s’en prendre à des organisations et des personnes considérées comme non comme dangereuses mais comme ennemies. Tombent dans cette catégorie sans nuance et toute stalinienne non seulement les agents de services de renseignement occidentaux (en grand nombre à Berlin-Ouest), mais aussi les bureaux en charge de la RDA dans les partis politiques de RFA, les organisations d’émigrés russes, les opposants ouest-allemands à la dictature, les démocrates est-allemands réfugiés, ceux qui aident à fuir mais aussi les anciens membres de l’appareil du SED, les anciens policiers ou douaniers et les anciens de la Stasi (il y 456 transfuge travaillant à la Stasi ou en étant retraité, p. 91, dont 108 reviennent bon gré mal gré en RDA p. 151-152).
Pour empêcher ces ennemis de nuire, le Ministère pour la Sécurité de l’Etat (Ministerium für Staatssicherheit, abrégé en MfS ou Stasi) est chargé de les amener sur le territoire de la RDA, que ce soit à partir de la RFA ou de Berlin-Ouest. Ils peuvent y être conduits de manière violente ou y être appréhendés « par hasard », en les y attirant ou en leur faisant changer de secteur de manière subreptice ou involontaire. Ensuite, ils peuvent être jugés, secrètement, de manière normale ou lors de procès-spectacles. Ou, souvent pire, envoyés à Moscou chez le donneur d’ordre premier (et qui longtemps conseillé et formé la Stasi). Il y aurait eu entre 1949 et la fin des années 1960 plus de 590 enlèvements ou passage de frontière par la ruse (parfois sous la menace d’armes). Les kidnappeurs étaient autour de 500, tous collaborateurs occasionnels de la Stasi et constitués en groupes de circonstance ou constitués (p. 16). Ils sont le thème central de l’étude Susanne Muhle au long des 600 pages de ce livre.
L’introduction commence bien évidemment par délimiter le sujet, avant de décrire les sources utilisées, son positionnement historiographique (dans la ligne de la « nouvelle criminologie » p. 15 et de C. Brown et son 110e bataillon de police de réserve p. 27) et d’annoncer le plan. Le prologue qui suit est en fait la contextualisation du travail, en ce début de Guerre Froide où en Allemagne, chacun cherche la déstabilisation de l’autre. Il présente les forces en présence, étatiques comme non-étatiques (et ceux qui changent de statut, comme l’organisation Gehlen qui passe sous le contrôle du gouvernement Adenauer en 1955 pour devenir le BND, p. 49). La Stasi y est longuement portraiturée, rassemblant des compétences de police secrète, de police judiciaire et de contre-espionnage (p. 54). Elle rassemble en 1953 sur le territoire de la RDA plus de personnel que n’en avait la Gestapo en 1938 sur tout le territoire du Reich (mais renseignant surtout sur le parti unique, p. 55-56), dont beaucoup d’anciens soldats ou d’Hitlerjugend.
Mais déjà le lecteur est confronté au cœur du sujet dans le premier chapitre, avec une exploration en profondeur de la pratique de l’enlèvement par la Stasi (et dans quelque cas la police aux frontières) p. 59-60). C’est entre 1950 et 1955 qu’eurent lieu 75% des enlèvements (p. 76). Si il y a de claires évolutions dans le temps et des techniques (notamment en lien avec les conflits au sein du SED p. 76-80), S. Muhle rappelle que les donneurs et les responsables sont très longtemps les mêmes : E. Mielke a tout de même été n° 1 ou n° 2 de la Stasi pendant toute la durée de la RDA ! La branche espionnage de la Stasi (HVA) participe aux actions décidées par les différentes directions mais jamais en première ligne (p. 87).
Le second chapitre passe de l’autre côté de la violence en étudiant les victimes des enlèvements. L’auteur nous présente plusieurs cas, appartenant aux catégories ennemies déjà mentionnées et démontre comment la Stasi était profondément et durablement staliniste dans sa vision du monde, sa culture transmise par le KGB (p. 169-180) et son personnel dirigeant (troisième chapitre). La mort de Staline n’est que l’occasion d’un ralentissement dans les enlèvements avant que les stalinistes ne soient à nouveau aux commandes (p. 185) et que le nombre de kidnappings reparte à la hausse entre 1958 et 1960.
Le chapitre suivant décrit le parcours des kidnappés, avec les premiers interrogatoires et la prison préventive, le procès, puis la détention et le retour en Allemagne de l’Ouest (pour ceux qui ne sont pas morts en détention ou parmi les 26 qui ont été condamnés à mort p. 239), à échéance de la peine, grâce, échange d’agents ou rachat par le gouvernement ouest-allemand (p. 258). L’isolement est souvent le lot des condamnés et le suicide ou les automutilations ne sont pas rares (p. 254). Etrangement, treize personnes restèrent en RDA une fois libérés (p. 261). La grâce était parfois le fruit d’une mobilisation des opinions publiques de par le monde, un monde qui n’était pas ignorant des enlèvements (cinquième chapitre). Les journaux ouest-allemands racontent sans fard les enlèvements. L’auteur met au clair ce que savait le monde des enlèvements de la Stasi, avec comme première difficulté le fait de savoir si c’était un enlèvement ou, comme souvent affirmé par la RDA, une fuite vers une terre de « démocratie réelle » (p. 226, p. 322). Des associations recueillaient des témoignages d’anciens détenus pour bâtir des fichiers de disparus, comme elles l’avaient fait avec les camps du NKVD entre 1945 et 1950, où passèrent 189 000 internés, tous civils, et où y moururent un tiers (p. 305) !
Puis S. Muhle revient du côté des kidnappeurs avec l’étude d’une cohorte de cinquante collaborateurs officieux de la Stasi (dont cinq femmes) qui ont participé à un ou plusieurs enlèvements, et qui sont une toute petite minorité (peut-être 3% furent recrutés pour ce type d’action, p. 369) parmi les collaborateurs occasionnels (plusieurs centaines de milliers de personnes à la fin des années 1980). Elle les répartit en trois types : le premier est caractérisé par son absence de lien avec la cible, le second est chargé de gagner la confiance de la cible et le denier type est déjà un familier de la cible (p. 408). L’auteur détaille leurs biographies et leur milieu d’origine (la moitié sont des Allemands de l’Ouest), leur âge et les effets de génération (la Stasi n’est pas très intéressée par le passé de soldat ou de SS de ses collaborateurs officieux p. 375), leur orientation politique (en général ils ont des affinités avec la gauche p. 378, et n’ont pas été membre du NSDAP et ne sont pas membres du SED), leur éducation et leur milieu professionnel et comment ils ont été recrutés par le Ministère pour la Sécurité de l’Etat (certains sont sortis de prison quelques jours avant l’action prévue p. 395-396). La description se poursuit dans le chapitre suivant avec le questionnement des motivations des gens perpétrant les enlèvements (par conscience politique, sous la contrainte ou pour se racheter, par intérêt matériel, par goût de la violence et du délit, par revanche, par goût de l’aventure ou sensation de puissance). Seule une petite minorité des collaborateurs de l’Ouest ont effectué leur tâche gratuitement (p. 418) et la conviction communiste était préférée par les officiers traitants (p. 420-436, plus chez les types 2 que les type 1 et plus chez les type 3 que les type 2). La pression est inhérente au processus de recrutement de la Stasi même si un refus à très rarement des conséquences. Mais la pression ne fait pas tout, car 16 500 collaborateurs de services de renseignement du Bloc de l’Est fuient pour l’Ouest entre 1950 et 1959 (p. 440).
Devant un tel éventail de motivations possibles, l’auteur se pose naturellement la question de la distance entre la norme voulue par le donneur d’ordre et la pratique (chapitre huit). Comment était reçues les initiatives des « employés » ? Comment étaient gérées les conséquences des activités criminelles des kidnappeurs (dont le fait d’être pris par les polices de l’Est comme de l’Ouest) avec le risque de la fin du secret ? Les collaborateurs pouvaient monter des coups seuls (p. 487) et la source première de conflit, augmentant de plus avec le temps, avec leurs officiers traitant était d’obtenir plus de contrats pour gagner encore plus d’argent. Certains collaborateurs furent tout même employés pendant plus de 25 ans (p. 516) …
Le neuvième chapitre continue d’exposer le parcours des abducteurs, une fois que ceux-ci ne sont plus utilisés par la Stasi. Certains y continuent leur carrière en tant qu’employés normaux (et peuvent devenir officiers traitants), mais d’autres continuent sur leur trajectoire précédente. Et parfois la justice passe (dixième chapitre), que ce soit avant 1990 (uniquement en RFA) ou après 1990. Mais les suspects n’étaient souvent pas connus ou les preuves étaient insuffisantes avant 1990. Après 1990 se pose la question de la loi à appliquer pour juger les coupables, avec en parallèle la responsabilité générale de la Stasi.
Le volume est clos par un épilogue, qui est un très bon résumé du livre, des remerciements et des appendices (abréviations, un récapitulatif des cinquante kidnappeurs étudiés, une bibliographie et un index).
La Guerre Froide, toujours si près et étonnamment si lointaine. Et si le MfS n’a conduit qu’un nombre limité d’enlèvements après la construction du Mur de Berlin, ce n’est pas pour autant qu’il avait arrêté d’en planifier, comme il planifiait aussi des homicides (p. 108-112 et p. 397). Mais le besoin ne se faisait plus aussi pressant : le SED avait assis sa dictature, la situation semblait gelée pour des décennies et le Mur compliquait l’organisation d’actions tout en coupant les services occidentaux de leurs sources. De plus les organisations d’opposants étaient moins actives, découragées. Pourtant ce qui était la norme pour le MfS ne l’était pas du tout pour les services alliés (à moins que des ouvertures d’archives démentent ce point, mais c’est tout de même peu probable). In fine, ces enlèvements avaient deux finalités, l’une externe et l’autre interne. Externe, car ils visaient des agents à Berlin-Ouest ou en RFA et faisaient planer un sentiment d’insécurité que même la fin du Mur n’a pas totalement éradiqué chez les victimes (l’auteur a conversé avec l’une d’elles, p. 377). Mais aussi interne, puisse que les membres des « organismes armés » (Stasi, police, garde-frontières, armée) savent ce qui peut les attendre en cas de défection (p. 557).
Ce livre porte donc un éclairage très puissant sur les enlèvements, leurs victimes et ceux qui les commettent, en exploitant une masse très importante de documents (et en premier lieu les dossiers des collaborateurs et ceux de leurs missions) et en sachant aussi s’en extraire pour en apprécier leur insertion dans un ensemble plus large, celui de la Stasi et du parti unique qu’elle protège d’ennemis situés hors de son territoire. On peut reprocher à l’auteur un manque ponctuel d’indicateurs temporels dans son texte, nuisant en de rares cas à sa clarté, tout comme l’utilisation un peu trop poussée de pourcentages avec deux décimales, pourcentages artificiels quand on parle de 50 occurrences. Mais des ratios auraient-ils été plus indiqués ? Ce ne sont toujours et encore que 50 cas et en étudier plus aurait été une adjonction très importante de travail qui n’aurait pas rendu les statistiques plus vraies, sauf à étudier tous les kidnappeurs (mais il manque des dossiers …). Et le texte n’aurait pas gagné en légèreté, la présentation en série de cas d’enlèvement se fait un peu au détriment de la synthèse. Des comparaisons de données sur les collaborateurs auraient aussi bénéficié par moments de comparaisons avec la société est-allemande des années 50. On sait ce que gagne un malfrat engagé pour un enlèvement à Berlin-Ouest mais comme on ne connaît pas le salaire moyen, comment savoir si c’est une grosse somme ou une très grosse somme ?
Malgré les petites redites et les peu nombreuses erreurs typographiques, l’effet est tout de même parfois glaçant à la lecture de ce livre. Il y a le cas d’une fille contrainte par la maladie de sa mère de livrer son père, ce dernier étant ensuite condamné à mort, ou le cas d’un enfant de deux condamnés à mort qui est confié à un employé de la procurature générale et qui ne lira la lettre d’adieu de sa mère que 56 ans après sa mort (note 616 p. 240).
Le livre nécessite une bonne endurance, le sujet étant peu propice à l’humour et certaines parties étant un peu arides mais saura récompenser le lecteur familier de l’allemand (on peut douter d’une prochaine traduction en français …) par une bien meilleure connaissance des relations inter-allemandes au début de la Guerre Froide et de la vie dans un pays divisé, alors que les ruines encombrent encore de nombreuses rues.
(une victime passée par le goulag et le camp de concentration goûte encore à l’isolement complet dans les geôles de la Stasi p. 245 … 7,5)