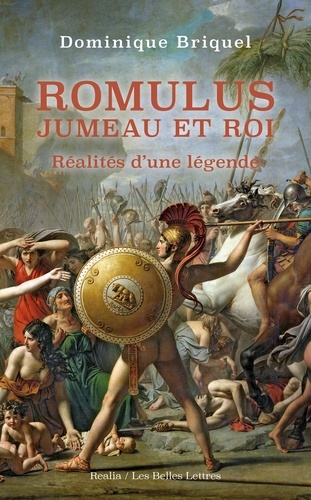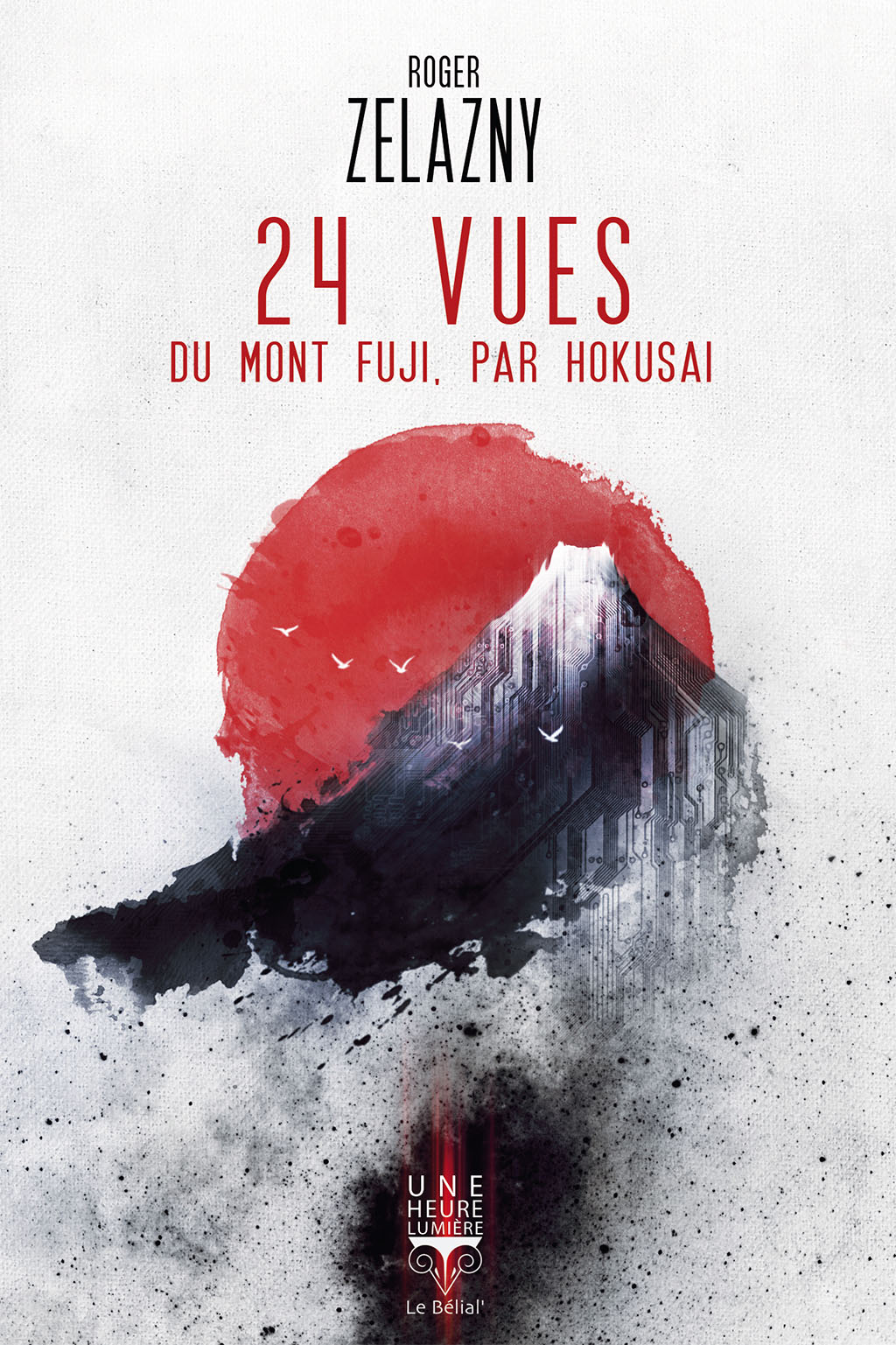Der Siegeszug der Archäologie
Essai de vulgarisation archéologique sous la direction de Hans Hillrichs.

Le titre du livre nous avait tout de même bien égaré. Non qu’il soit faux, puisque l’on parle bel et bien de Troie dans ce livre, mais ce n’est pas le seul sujet du livre. Issu d’une série télévisée sur les sites archéologiques emblématiques, ce livre permet à la fois la découverte de sites archéologiques légendaires sur trois continents ainsi que la figure de leurs découvreurs mais aussi l’évolution des techniques de l’archéologie depuis la fin du XVIIIe siècle. Six sites, avec leurs aires civilisationnelles, sont concernés : Pompéi, Saqqarah, Palenque, Troie, Machu Picchu et Harappa.
Richement illustré, ce livre débute avec une très courte introduction qui présente les six chapitres. Puis vient Pompéi, ou la transformation d’une catastrophe en une énorme chance pour l’archéologie. Site redécouvert au XVIe siècle, son « exploitation » ne démarre qu’à la fin du XVIIIe siècle. Encore aujourd’hui, la ville est loin d’être entièrement fouillée mais heureusement, les techniques ont grandement évolué et lointaine est l’époque où on l’on minait plus Pompéi pour ses trésors que l’on en faisait une étude raisonnée.
Le second chapitre passe en Egypte et conte les vies de deux égyptologues du milieu du XIXe siècle, Auguste Mariette et Heinrich Brugsch. La découverte du Serapeum de Saqqarah est au centre de l’article avec la fondation du Service égyptien des Antiquités qui met fin au pillage des artefacts de l’Egypte ancienne par les puissances européennes. Plus triste, le livre rappelle que la crue du Nil qui a submergé le premier musée cairote des antiquités égyptiennes a détruit les notes de fouilles de A. Mariette, dont une très grande majorité de choses jamais publiées.
La chapitre suivant nous transporte en Amérique du Nord, auprès des Mayas. Si certaines choses sont documentées au XVIe siècle, elles tombent dans l’oubli des remises de bibliothèques pour ne réapparaître qu’au XXe siècle. L’archéologie mésoaméricaine ne bénéficie pas uniquement du déchiffrement des hiéroglyphes mayas, elle tire aussi d’autres avantages de la modernité grâce à l’aviation (C. Lindbergh photographie depuis les airs la ville d’El Mirador en 1930) et à la plongée subaquatique (dès 1904 un plongeur grec explore le cénote sacré de Chichen Itza, p. 172).
Puis enfin, dans le chapitre suivant, Troie. On suit bien évidemment Heinrich Schliemann, ce passionné qui a non seulement fouillé Troie mais aussi Mycènes. Mais on apprend aussi que les fouilles troyennes ne prennent pas fin avec H. Schliemann. En 1988, la physionomie de la ville du Bronze ancien change radicalement, avec la découverte de la ville basse : la ville haute, la forteresse fouillée par Schliemann, fait 20 000 m2 tandis que la ville basse avoisine les 180 000 m2. La ville était bel et bien un centre commercial de grande importance, avec peut-être 12 000 habitants (p. 228).
Dans le cinquième chapitre, le lecteur accompagne Hiram Bingham III dans sa découverte du Machu Picchu en 1911. Le fils de missionnaires hawaïens parvient à être envoyé au Pérou pour y explorer la vallée de l’Urubamba (le but de cet enseignant de Yale était de gravir le sommet du Coropuna, en passant). La découverte de la cette résidence royale perchée à 600 m mètres au-dessus du fleuve ne compte pas pourtant parmi les découvertes les plus importantes de l’expédition pour la presse, pas plus que pour son découvreur scientifique (la découverte de Vilcabamba, la dernière capitale inca, fait bien plus de bruit). Il l’identifie même comme le lieu mythique de l’origine des Incas (p. 287), une théorie qu’il ne reniera jamais.
Le dernier chapitre s’intéresse à la ville de Harappa, le site le moins connu de tous ceux déjà évoqués dans ce livre. La ville se situe dans la vallée de l’Indus, dans l’actuel Pakistan. En 1924, c’est le directeur du Service des antiquités du Raj qui fait l’annonce de la découverte d’une ville de briques qui fleurit au milieu du troisième millénaire avant J.-C., puis d’une civilisation toute entière dans la vallée de l’Indus. Les recherches subséquentes feront perdre son caractère irénique à cette culture, mais pas les preuves d’un très haut niveau de gestion de l’eau et du bâti. Reste à savoir, comme le souhaitent ardemment les nationalistes locaux, si cette culture possédait une écriture, ce qui ne semble pas assuré et disputé encore aujourd’hui. Une très petite conclusion, les biographies des auteurs, une bibliographie indicative et un index concluent cet ouvrage.
Si l’importance des sites pour l’histoire générale de l’archéologie est justement soulignée, on a tout de même eu à exprimer quelques regards interrogatifs. Cet antinéronisme irréfléchi qui se perpétue au XXIe siècle est tout à fait déplacé (p. 63), sans parler de la confusion évidente de voir Sylla agir sous le principat (p. 38). La présentation historique est incomplète, mais dans ce cas, il est plus difficile de faire œuvre d’exhaustivité. Et de là à qualifier les Grecs du XIIIe siècle avant J.-C. de grande puissance (p. 200) … Le livre est très richement illustré, notamment avec des photos du tournage de la série documentaire, ce qui ne manque pas d’intérêt. Mais toutes ces illustrations ne sont pas de qualité, certaines (p. 344 ou encore p. 346) étant vraiment en dessous de tout. Très inégal. On retiendra surtout du livre sa présentation très plaisante d’archéologues d’importance à la vie bien remplie (Mortimer Wheeler, en plus d’être archéologue et conservateur, a eu le temps de devenir général de brigade aérienne avant d’être actif en Inde) et plus encore la partie sur Harappa, Mohenjo-Daro et la civilisation de l’Indus, une terra incognita.
(Hiram Bingham III, découvreur scientifique du Machu Picchu, n’était semble-t-il pas un homme délicieux … 6,5)