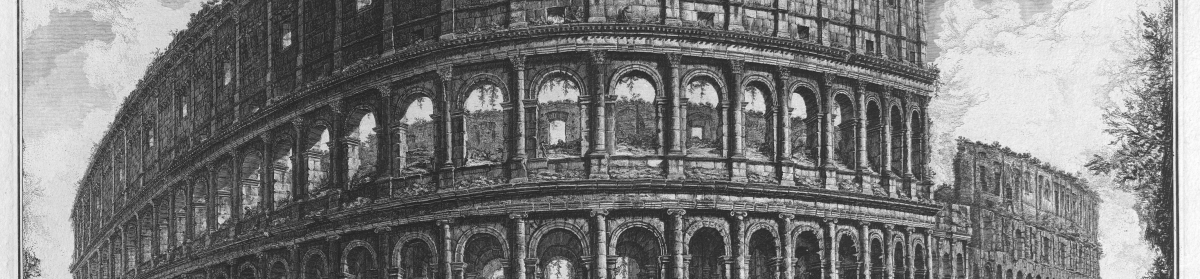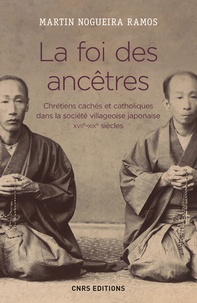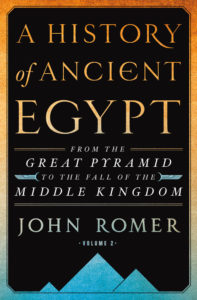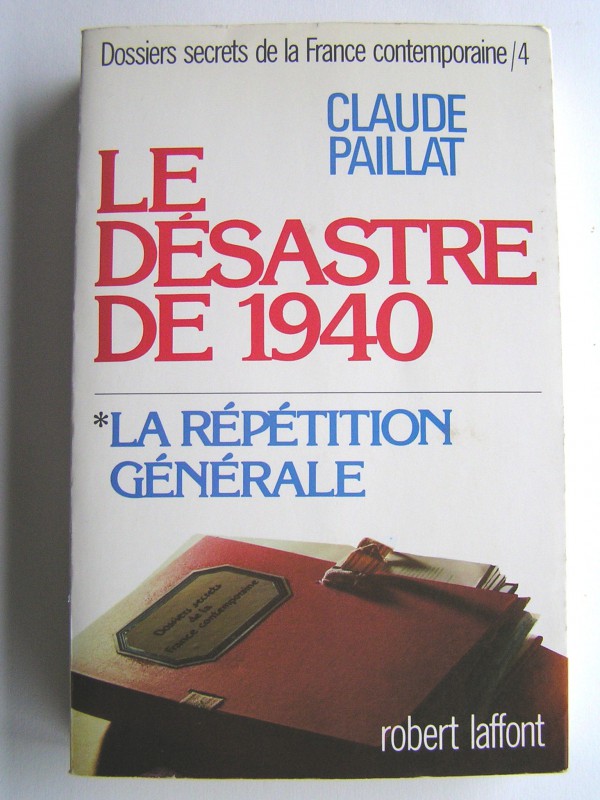Civic Identity and the Classical Past in Northern Italy. 1250-1350.
Essai d’histoire médiévale nord-italienne de Carrie Beneš.
Comme l’épigraphe de ce chapitre le suggère, ces traductions sont à but légal, moral ou historique comme pour l’amusement. Elles cherchent à rendre le passé classique plus accessible parce qu’il était pertinent pour le vécu concret, non parce qu’il était drôle ou intrinsèquement supérieur. p. 156
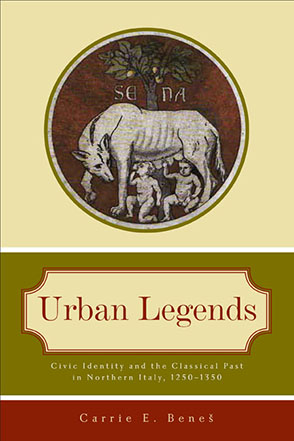
Dans le panier de crabes de la politique italienne du Moyen-Age central, où tous types de pouvoirs féodaux se confrontent, on ne se contente pas des mercenaires, des statuts et privilèges octroyés par l’empereur ou le pape, des assassinats et des alliances de revers mais on veut aussi s’affirmer et démontrer son bon droit et sa prééminence au travers de fondateurs illustres et, surtout, anciens. Mais pour présenter aux autres un récit cohérent et intimidant, il faut avoir les ressources intellectuelles pour élaborer ce dernier. Et donc avoir sous la main ou à proximité des spécialistes de l’histoire ancienne, c’est-à-dire romaine, avec des artistes ou des poètes pour la mise en forme.
Parmi tous ces pouvoirs, l’auteur a fait le choix de se limiter à quelques communes (dont l’émergence est souvent récente) du nord de l’Italie : Padoue, Sienne, Gênes et Pérouse. Mais avant cela, il y a une introduction présentant l’objet de l’ouvrage puis un premier chapitre ayant pour objet la redécouverte du passé romain en Italie. Ainsi, au tout début du XIVe siècle, un auteur florentin qualifie sa ville de « fille et créature de Rome », une ville qui monte pendant que sa génitrice décline (p. 15). Dante parlait à l’identique de la même Florence (mariant Fiesole, Troie et Rome). Il illustrait les trois manières possibles pour une ville de se rapprocher de l’Urbs, référence ultime même sans la papauté déplacée à Avignon : directement fondée par Rome, fondée parallèlement à Rome (par un Troyen par exemple) ou être d’une fondation plus ancienne que la Ville Eternelle.
C’est bien sûr ce qui se passe aussi pour nos quatre exemples à venir : Padoue est fondée par Antênor, Gênes par le prince troyen Janus, Pérouse par le Troyen (ou le Grec) Eulistes et Sienne par les deux fils jumeaux de Rémus. Parmi les villes qui se disent fondées par des Grecs (malgré le fort penchant pour Troie des sources romaines), on peut compter Pise, fondée par Pélops. Un auteur pisan raconte même que les Pisans aidèrent les Achéens devant Troie (p. 19). Milan prétend aussi antidater Rome, sous le nom de Subria. De manière générale, de nombreuses villes revendiquent être la première ville fondée en Italie (un parallèle avec la ville biblique de Caïn, en Genèse 4, 17) : Fiesole, Ravenne, Gênes au travers d’un autre Janus … A ces histoires sont associées des lieux ou des monuments, comme à Rimini, où l’on remplace au XVe siècle une stèle plus ancienne commémorant le discours de Jules César après le passage du Rubicon (p. 24). A chaque fois, il y a un but double à ces fondations mythique : un regain de gloire municipale mais aussi un véhicule pour l’unité des bourgeois renvoyés à une origine commune (p. 35).
Le second chapitre inaugure la partie des études particulières avec la ville de Padoue. Ces études sont toujours conduites selon le même schéma : une carte ouvre le chapitre, puis suis une contextualisation (naissance de la commune, autres seigneuries d’importance aux frontières, développement de la ville, fonctionnement etc.), comment la commune adopte officiellement l’histoire fondatrice et quelles sont les manifestations physiques que cela engendre, avec quelles intentions et quels moyens. Dans le cas de Padoue, on fait appel à Virgile et Tite -Live pour les sources (p. 44) et cela se matérialise dans la reconstruction de la tombe d’Antênor à côté de la cathédrale en 1283 après avoir fait graver sur une porte de la ville un poème sur Antênor dès 1210. Un cercle préhumaniste est à l’origine de la rénovation de la tombe, comprenant une très forte représentation de professions juridiques.
A Gênes (troisième chapitre), c’est le célébrissime Jacques de Voragine, archevêque, qui prend les choses en main. Il agrège trois différentes histoires (se basant sur Isidore de Séville, Paul Diacre, Solinus, Jacopo Doria etc.), chacune ayant un Janus comme héros, pour les fondre en une seule (p. 76) : un Janus vient de Terre Sainte régner en Italie à partir de Gênes juste après le Déluge, un second Janus vient de Troie et un dernier d’Epire et sera divinisé par les Romains. Ainsi, l’un fonde, l’autre agrandit et embellit et le dernier est vénéré des Romains (sous la république, ce qui n’est pas sans importance). Toutes les cases sont cochées. Aux textes s’ajoute une monumentalisation dans la cathédrale de Gênes.
Le chapitre suivant s’attaque à Sienne. Cette dernière a la particularité de mettre en scène deux jumeaux allaités par une louve, ce qui peut paraître un honteux plagiat mais qui ne l’est pourtant pas, puisque l’emblème de Rome à ce moment-là est le lion (ce que l’auteur ne semble pas dire dans ce livre). Mais ces deux enfants ne sont pas Romulus et Rémus mais Aschius et Senius, fils de Rémus. On retrouve ainsi la louve en sculpture sur la Porte Romaine et sur le Palais Public (la mairie) mais aussi divers loups vivants logés dans ce même palais. Des peintures dans le palais reprennent ce motif, tout comme le SPQR romain.
Pour ce qui est de Pérouse, le besoin d’un aqueduc (parmi d’autres projets édilitaires) permet de faire construire entre la cathédrale et le palais public (deux bâtiments mis au goût du jour à la toute fin du XIIIe siècle) une fontaine monumentale. C’est là qu’intervient Eulistes, un roi étrusque, mentionné dans le commentaire de l’Enéide par Servius (p. 121). La nouvelle fontaine, bâtie en 1278 sur la place principale de Pérouse, lui rend hommage en le plaçant parmi les douze statues qui la scandent. Les Pisano père et fils sont responsable de la partie artistique du projet. La littérature vient ensuite, avec la commande par la commune à Boniface de Vérone d’un poème sur le fondateur, suivie d’une version en prose une fois l’œuvre acceptée.
Le dernier chapitre du livre explore plus en profondeur la relation entre connaissance du monde classique et service de la commune. Plusieurs types de personnes sont impliquées dans l’utilisation des sources antiques pour célébrer des fondateurs et utiliser leur aura. Il y a ainsi ceux qui commanditent et ceux qui exécutent, ceux qui maîtrisent le latin et ceux qui n’ont pas cette éducation, le tout dans des réseaux de toutes sortes (familiaux, professionnels, religieux, de patronage) qui voient circuler les idées dans toute l’Italie et au-delà. L’élite éduquée, celles de ceux passés par les universités parle avec la bourgeoisie des guildes, riche mais ne pouvant lire que des traductions, tout en étant dans le même bain de traditions orales que toute la population de la commune. Un processus bidirectionnel (p. 154) se met donc en place, permettant la participation de chacun aux rituels communaux, promouvant une identité civique.
La conclusion revient sur le concept de conscience historique : les Italiens du XIIIe siècle ont bien à l’esprit que l’histoire de Rome est la leur. Difficile de l’oublier, tant les pierres le rappelaient à tout bout de champs. Les communes, qui doivent gérer leurs affaires dans un monde très concurrentiel, cherchent des modèles et ceux de la Rome républicaine ont montré leur efficacité.
L’ouvrage est complété par un répertoire biographique très utile (tous les gens cités ne sont pas connus et leurs liens connus que des spécialistes), les notes (du très sérieux), la bibliographie et un index.
Ouvrage très intéressant et creusant admirablement ses exemples, on ne peut que regretter qu’il ne prenne que ces quatre exemples et qu’il n’élargisse pas à d’autres types de pouvoir (cela existe ailleurs). On sent que c’est pleinement dans les cordes de l’auteur, quand on voit comment, en plus des innombrables exemples ne touchant pas aux quatre cités, sont traités les cas de réfutations de prétentions par des cités rivales. Comme celui-ci le dit très clairement (p. 4), l’appropriation du passé antique par les cités-Etat italiennes atteste d’un intérêt bien plus large pour l’Antiquité qu’il est généralement perçu pour cette période. Et cet intérêt classicisant dans un environnement municipal complète le christianisme avec intelligence (p. 164). Mais parmi cette excellence et cette maîtrise de tous les instants (y compris au niveau de la forme), apparaît étrangement l’étonnante remarque que les républiques médiévales ne sont pas démocratiques au sens du XXIe siècle (p. 152) … Qui n’a jamais prétendu que république et démocratie sont des synonymes ?
Quelques graphiques des réseaux auraient été un plus, avec l’accumulation de noms et la bougeotte qui caractérise certains artistes et les exils d’autres. Mais le livre se dévore.
(Pise dans le Sud de la Toscane p. 19 ? …8)