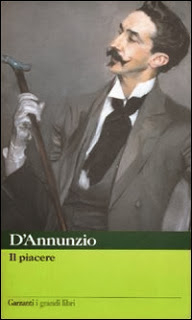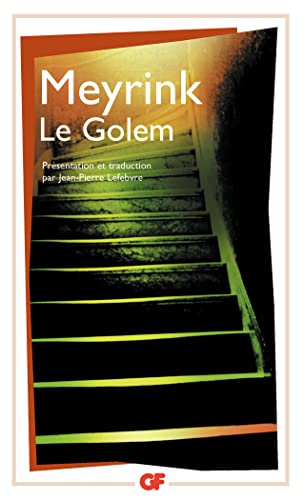Essai de linguistique appliquée à la science-fiction de Frédéric Landragin.

Que se passerait-il si des extraterrestres arrivaient demain sur Terre ? Comment communiquer avec eux, s’ils le veulent bien ? Ce livre n’a bien entendu pas la réponse à ces questions (cela dépend beaucoup desdits extraterrestres), mais liste tout de même une partie des éléments qui entrerons en jeu dans ce cas-là. Il s’aide pour cela de ce que la science-fiction a déjà pu mettre en œuvre, dans un roman ou un film, pour parvenir à communiquer avec des êtres inconnus.
L’introduction commence avec quelques notions de base, la plus importante étant la différence entre langue (système de communication) et langage (faculté de parler). Mais il est aussi question des quatre facettes du signe (p. 21) et des fonctions du langage. La linguistique est elle aussi décrite, avec ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas.
Puis l’auteur s’attache à montrer comment la SF a donné naissance à une sous-branche du genre appelée linguistique-fiction. Cette dernière utilise des théories de la linguistique pour bâtir des histoires, voir faire d’une notion un personnage. F. Landragin cite les exemples de L’Enchâssement de Ian Watson (publié en 1973 et qui place au centre de son récit la notion d’enchâssement des phrases), Les Langages de Pao de Jack Vance et de Babel 17 de Samuel Delany. Tout cela nous mène aux théories de Noam Chomsky et à la thèse dite Sapir-Whorf, avec toujours au centre l’articulation entre langue et perception de la réalité.
Le second chapitre se concentre sur l’origine et l’évolutions des langues naturelles (le français, le javanais, le patagon etc.). Il faut d’abord faire la différence entre l’oral et l’écrit, avec une plus grande facilité de description pour ce dernier. Leurs relations sont évoquées, de même que leurs évolutions. Il n’existe aucune évolution obligatoire qui ferait passer une langue d’un stade isolant à un stade agglutinant puis enfin à un stade flexionnel (p. 98).
Le troisième chapitre passe aux langues artificielles et imaginaires. Parmi les langues artificielles (qui ont un haut taux d’hapax dans leurs textes p. 135), la plus connue est sans aucun doute l’esperanto mais elle est loin d’être la seule (volapük, cablese, loglan etc). Parmi les nombreuses langues fictionnelles, on peut dénombrer le sindarin, le klingon, le mechanese. Il est évident que ces langues tout comme les néologismes sont un élément essentiel de l’émerveillement que ce doit de susciter une œuvre de SF.
Le chapitre suivant va plus loin dans la description des langues en détaillant certains éléments constitutifs que sont le lexique, la phonétique, la prosodie (pauses et accentuations à l’oral), la morphologie, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique et la stylistique. Le panorama est très vaste mais tout est très bien décrit en s’appuyant toujours sur des exemples issus de la SF.
Une fois que tout ceci est bien en tête, on peut enfin rencontrer nos extraterrestres. Le contact est facilité si l’on a préalablement découvert des archives que l’on a pu exploiter (déchiffrer). Le contact lui-même peut s’effectuer à distance (communication lumineuse) ou en face-à-face. C’est là que la désignation prend une importance considérable avec les notions de « je » et « tu » (p. 211). Puis après, il faut avoir quelque chose à se dire …
La conclusion pose la question de l’avenir de la linguistique-fiction, avant de laisser place aux notes, à la bibliographie et à un index des notions.
L’exposé est, comme pressenti, très solide. Les exemples sont variés et la SF française du début du XXe siècle n’est pas oubliée. Le propos est très accessible, très clair. Certaines théories sont même très habilement résumées grâce à des onomatopées (l’origine des langues, p. 79-80) mais leur rejet en bloc nous paraît en revanche beaucoup plus hasardeux. Pour ce qui est de l’indo-européen apparaissant vers 6000 a. C. (p. 89) et les premières écritures vers 10 000 a.C. (p. 73), là encore nous doutons au vu des découvertes archéologiques récentes. Sur la prononciation contemporaine du français en France (p. 96), les conclusions sont très abusives. De même place sur un même plan de comparaison le Gom Jabbar et la cuve axolotl comme termes nécessitants obligatoirement une explication de l’auteur (dans Dune) nous semble fausse (puisque l’axolotl qui donne son nom à la cuve est un animal aux vertus justement régénératives). La racine latine de « dormitoir » (dans Les Monades urbaines de R. Silverberg, ici p. 140) n’est pas non plus vue par F. Landragin. Enfin, certains effets tombent à plat (p. 75), mais on ne peut pas gagner à tous les coups … Mais le passage sur l’importation de phonèmes en français (p. 155) et le nombre de noms différents pour désigner une coccinelle en Corse (24, p. 152) rattrapent aisément ces faibles désaccords.
(les recherches sur l’origine des langues et la langue universelle ont été proscrites à la fin du XIXe siècle en France et au Royaume -Uni p.82 … trop de fantaisistes …7)