Réponse aux critiques formulées à l’encontre de la religion civique romaine par John Scheid. Paru en français sous le titre Les Dieux, l’État et l’individu. Réflexions sur la religion civique à Rome.

Dans le débat toujours vivant portant sur la religion romaine, des voix postulant que la religion civique romaine ne serait en fait pas une « vraie religion » mais une coquille vide ont pris plus de poids au début du XXIe siècle (p. 42). En plus d’être une fiction, la religion romaine ne serait que rituels vains et instruments de domination d’une élite, dont le peuple romain serait écarté. Son vide émotionnel supposé la disqualifierait. Pour J. Scheid, spécialiste de la question au Collège de France, ces critiques font trois erreurs en plus d’être submergés par l’exemple du christianisme : ils ne prennent pas en compte ce qu’est vraiment une cité antique, ce qu’est l’individu avant le Moyen-Age et ce que sont les religions dans un monde de cités-Etat (p. 4).
En onze chapitres, l’auteur va donc défendre une conception historique de la religion romaine. Il commence par définir ceux qui critiquent ses positions, en retraçant leurs influences (chez Georg Wissowa par exemple, du très fameux dictionnaire Pauly-Wissowa) en partant du Romantisme et de la dialectique hégélienne. L’auteur ne cache pas plus être inspiré par un courant proche de l’anthropologie sociale, avec G. Dumézil et J.-P. Vernant (à qui le livre est dédié) puis livre quelques commentaires préliminaires sur les critiques, premièrement dans le choix des termes de ces dernières (p. 11). Le concept de religiosité appliqué aux religions antiques (mais aussi à d’autres) est sévèrement attaqué.
Puis dans un second chapitre, l’auteur porte son attention sur le mythe du déclin de la cité-Etat après la bataille de Chéronée (en 338 a.C., erreur sur la date p. 32). Pour les critiques de la religion civique il est évident que celle-ci ne saurait être sans cités (cadre de l’unification allemande au XIXe siècle, p. 29). Mais si celles-ci ne disparaissent pas … Pour l’auteur, c’est l’évidence puisque l’empire romain est un agrégat de cités aux statuts différents sous l’égide d’une seule cité, Rome. Le chapitre suivant va plus encore dans le particulier et s’attache à décrire la place de l’individu au sein des cités. L’individu n’est pas que devoirs et droits civiques (ou tribaux, d’homme libre ou non, tout dépendant de son statut), il est aussi inséré au sein d’une famille dont la dimension juridique n’est pas à négliger (p. 34). L’Edit de Caracalla de 212 p. C. qui fait citoyen tout homme libre de l’Empire ne change pas cet état de fait (p. 39).
Le quatrième chapitre vise à démontrer que la religion civique n’est pas juste le discours de l’élite urbaine (qui fournit magistrats et prêtres). J. Scheid démontre dans ce chapitre que le culte civique est rendu de manière publique, avec un minimum de personnes présentes (comme le minian juif) en plus de l’être au nom du peuple. Pour l’auteur ces arguments sont surtout le reflet d’animosités d’auteurs du XIXe siècle à l’encontre du catholicisme (p. 49). Le chapitre suivant interroge le rapport entre religion et identité, avec le fait que des chercheurs ont reproché à la religion romaine de ne pas avoir réussi à forger une identité romaine (mythes, rites, philosophie et christianisme sont très clairement séparés p. 52). Mais beaucoup des cultes ne sont pas des cultes publics et sont limités à des régions ou des catégories de personnes. Il n’y a pas d’universalisme (p. 65). Mais pour ce qui concerne les cultes publics, la participation de tous les habitants de condition libre est requise. Des habitants, et pas seulement les citoyens du lieu (p. 66).
La question de la destination des rituels est traitée dans le sixième chapitre. Cela permet à l’auteur de revenir sur le caractère public des cultes civiques, par délégation ou non. Au peuple romain peut être associé la famille impériale mais aussi des alliés. Le Sénat exerce un contrôle sur les cultes, autorisant l’expression publique de certains ou la répression d’autres (en cas de troubles à l’ordre public). Ce dernier thème est central dans le septième chapitre, avec la gestion de l’impiété par les pouvoirs publics. Le huitième chapitre s’aventure dans les autres aspects religieux à Rome, notamment familiaux mais aussi locaux. L’initiation à un culte à mystères dans une ville ne vaut ainsi pas pour une autre localité (p. 109) et l’interprétation des rites peut varier dans le temps (les Parilia p. 111). De même, intégrer un culte était assez simple alors qu’en sortir était bien plus difficile, du fait des implications socio-professionnelles que cela avait.
Le neuvième chapitre revient à la principale critique contre la religion romaine, celle de la religiosité et de l’émotion. Mais il faut prendre en compte que le lien qui unit le dieu au citoyen est celui qui unit le patron au client, une relation d’obligations mais dont les émotions ne sont pas absentes (p. 115-117). La dixième partie de l’ouvrage se pose la question du changement religieux à Rome à la fin de l’Antiquité. Pour l’auteur, les cultes dits orientaux (cultes guérisseurs, mithracisme) ne préfigurent en rien l’irruption du christianisme jusqu’au plus haut niveau de la société. Ces cultes orientaux se révèlent par ailleurs moins différents des autres que ce que l’on a supposé, et finalement marginaux (géographiquement ou limités à des catégories sociales précises). Le dernier chapitre est une conclusion déguisée, qui enfonce le clou du côté de la méthodologie et des incohérences de la critique (rituels sans émotion, cela vaut aussi pour le judaïsme et l’islam ?). Suivent les notes et un index.
Ce livre n’est pas qu’un plaidoyer. C’est aussi un très bon précis sur la religion romaine (ou les religions romaines, ce qui serait peut-être plus exact). Tout n’y est bien sûr pas, mais cela reste très large. La partie en plus, c’est la partie historiographique et elle n’est pas moins intéressante que le reste. L’auteur y dévoile son arrière-plan méthodologique, peu amateur de la déconstruction stérile et des « studies », un danger pour les humanités à son sens (p. xx, p. 2). Les critiques (souvent S. Krauter, comme p. 97) font aussi montre d’un sérieux problème avec l’altérité, ce qui est tout de même problématique pour des historiens ou des anthropologues (p. 46). Les exemples du livre sont plutôt originaux et cela permet au lecteur de se familiariser un peu avec le sujet des deux thèses de J. Scheid, les Frères arvales, un collège sacerdotal romain très lié à la maison impériale.
Le traducteur en anglais est enseignant à l’université de Chicago. Le fait qu’il ne soit pas traducteur professionnel permet l’écriture d’une préface d’excellente tenue mais rend le texte un peu lourd et par moments peu immédiatement compréhensible. On ne sait pas toujours qui critique quoi … Mais ce livre montre le toujours criant déficit de traductions à destination du monde anglophone (p. xvi). Malgré les défauts de la traduction, ce livre se lit facilement, nécessitant finalement peu de connaissances particulières mais plus une culture historique générale d’assez bon niveau.
(un esclave possesseur d’esclave peut être actif religieusement dans un cadre privé p. 139 …8)
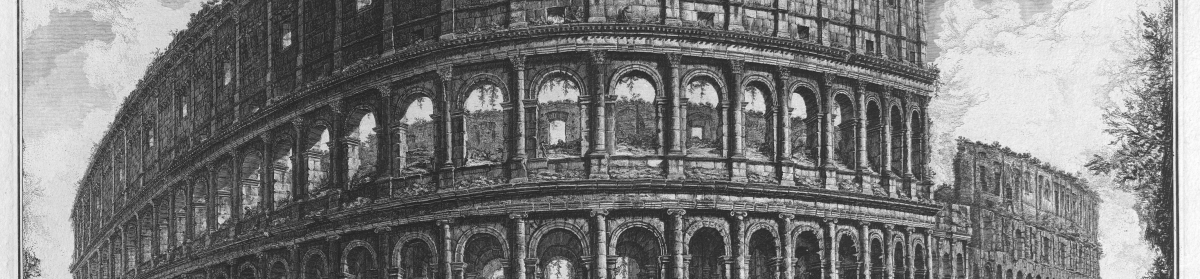
Une réflexion sur « The Gods, the State and the Individual »