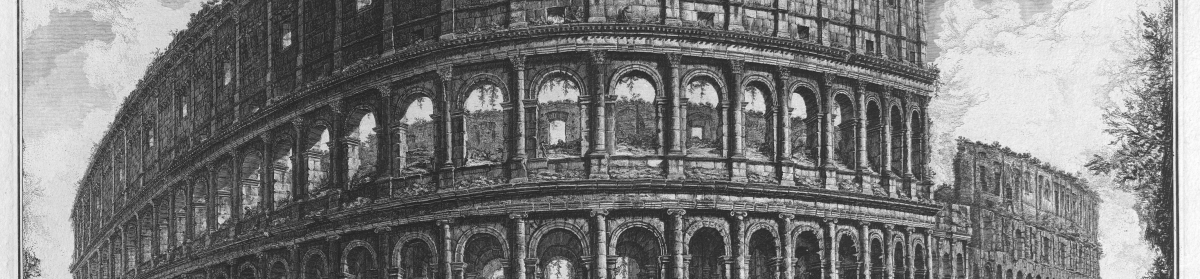The Holocaust as History and Warning
Essai d’histoire de l’Holocauste par Timothy Snyder. En francais sous le titre Terre noire : L’Holocauste, et pourquoi il peut se répéter.

Le sujet a bénéficié de beaucoup d’attention de la part des spécialistes et pourtant il est toujours autant nécessaire de pouvoir lire des ouvrages qui font le lien entre toutes les études. Mais T. Snyder ne se contente pas de la collation des différentes sources et analyses et offre au lecteur des perspectives peu communes, tant au niveau de la chronologie que de la compréhension générale de ce phénomène central du XXe siècle.
Pour commencer par le commencement, l’introduction s’occupe la source de l’Holocauste : la pensée hitlérienne. Celle-ci ne cache nullement son orientation, sans pour autant prendre parti sur les moyens : l’Allemagne doit se débarrasser des Juifs qui l’empêchent par leur présence et les idées qu’ils véhiculent d’attendre le rang qui lui est promis comme race dans l’éternel combat pour la survie et le bien-être, à savoir le premier. Puisque l’homme est un animal (comme l’a montré le darwinisme), il faut faire coïncider la science et la politique (p. 5). Le premier chapitre poursuit l’exploration du contexte idéologique en mettant en avant le parallèle fait entre l’Allemagne et les Etats-Unis (possible avec la mondialisation du début du XXe siècle), un pays au niveau de vie fabuleux, ayant l’espace pour sa population et qui a su se débarrasser presque complètement des « êtres inférieurs » qui occupaient ce même espace : les Indiens. Pour son espace vital nécessaire, son biotope (Lebensraum), la race allemande n’aurait alors, compte tenu de la domination anglo-saxonne des mers, que comme solution de coloniser l’Est européen (avec en exemple aussi les expériences colonisatrices allemandes en Afrique, de loin pas douces). La conquête doit donc se faire jusqu’à l’Oural (en détruisant l’URSS « judéobolchévique »), en redirigeant la nourriture produite sur place vers l’Allemagne (le blocus allié de la Première Guerre Mondiale a fait des dizaines de milliers de morts) et donc en affamant les populations locales (comme en 1916 déjà, p. 17). De ce point de vue, A. Hitler est à la fois colonialiste et anticolonialiste (p. 8).
Posé le contexte idéologique, T. Snyder passe ensuite au contexte géopolitique et analyse en détail les différentes phases dans les relations à trois entre Berlin, Moscou et Varsovie dans les années 1930. La Pologne a essayé dans ces années de maintenir une position de neutralité entre ses deux voisins aux visées révisionnistes (plus de 100 000 citoyens soviétiques ethniquement polonais sont éliminés avant la guerre p. 57). Plus étonnamment, elle soutenait aussi avant la guerre le sionisme combattant et terroriste de V. Jabotinsky (camps d’entrainement p. 64) tout en souhaitant se rapprocher de la Grande-Bretagne (pourtant la victime de ces mêmes terroristes en Palestine p. 67). En fin de compte, ce sont l’URSS et les Nazis qui s’entendirent pour se partager la Pologne …
Le quatrième chapitre du livre marque le début de l’argument principal de l’auteur : c’est la fin des Etats en Europe centrale et orientale qui permet l’Holocauste. T. Snyder démontre clairement à notre sens la gradation par l’expérience qui lie ces deux phénomènes. L’Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, à chaque fois c’est une étape de plus dans la répression, à chaque fois de plus en plus longtemps. En Pologne, l’Etat détruit n’est à dessein pas remplacé par un autre Etat (l’Autriche est intégrée au Reich assez rapidement) et donc les éliminations (de Juifs et de personnes jugées comme dangereuses par les Nazis) qui ont duré des jours en Autriche durent le temps de la guerre, d’abord à l’Ouest du pays puis à l’Est avec l’opération Barbarossa, dans un territoire déjà parcouru par les assassinats ciblés (mais de masse) et les déportations (les pays doublement occupés comme les dénomme l’auteur). En Pologne, mais aussi en Biélorussie et en Ukraine, il n’y a plus de légalité et il n’y a plus que la survie qui compte (et l’enrichissement rapide), au prix de l’extermination de la minorité juive (avec participations locales à divers titres). Des pogroms sont suscités (mais pas toujours avec succès selon les lieux et le contexte sociopolitique local p. 160), les polices locales sont restructurées et leurs missions réorientées. Néanmoins, comme le démontre l’auteur, si le résultat pour les communautés juives locales (mais aussi les handicapés et d’autres personnes considérées comme indignes de vivre) est le même, les processus empruntent des voies différentes selon les pays, conséquences de leurs histoires récentes. L’auteur se penche pour se faire aussi sur les trois pays baltes (le judéobolchévisme comme mythe rédempteur pour les collaborateurs des Soviets dans les pays baltes en 1941, p. 164 et p. 187) et donne de nombreux détails sur la répression et la déportation des Juifs par les Soviétiques (dans le cadre de la lutte contre le capitalisme, dans une sorte de réforme agraire par la dénonciation et la déportation p. 132).
Après les premiers mois de l’occupation nazie à l’Est, tout est déjà presque achevé et la survie des Juifs dans les territoires colonisés est devenue presque impossible tant le risque de dénonciation est omniprésent et le danger très réel pour ceux qui protègent ou ne dénoncent pas (une seule peine, la mort). C’est ce que l’auteur appelle le paradoxe d’Auschwitz : quand le camp d’extermination ouvre, sont qui y sont destinés (pas ceux qui y sont transportés) et vivent en Europe de l’Ouest ont plus de chances de survivre à la guerre que ceux qui vivent encore dans sa proximité. Et ce pour une seule raison : ils sont encore protégés par des Etats. Et pourtant c’est ce camp d’extermination qui devient le symbole de l’Holocauste, principalement parce que le but était aussi d’y faire travailler des gens (dans un choix stratégique entre le travail des déportés ou le transfert des calories qu’ils consomment vers l’Allemagne, p. 201) et qu’il y a des survivants (en plus grand nombre que pour les tueries au bord de fosses, aux rescapés infinitésimaux comme ceux entrés dans les camps d’extermination de Sobibor, Treblinka, Chelmno ou Belzec). Ce sont la bureaucratie, la citoyenneté et les besoins de la politique étrangère des Etats non détruits de l’Ouest de l’Europe qui sauvent beaucoup des Juifs du sort qui leur est réservé à Auschwitz.
Une fois ces bases posées, T. Snyder va plus profondément, en prenant plusieurs exemples en commençant par les Etats alliés aux Nazis que sont la Slovaquie, la Croatie ou la Roumanie (où les politiques d’extermination ont libre cours), l’Italie (où l’Holocauste ne démarre qu’après la chute de B. Mussolini en 1943), la France ou encore le Danemark (qui organise plus ou moins la fuite de ses sujets juifs vers la Suède neutre).
La dernière partie de ce conséquent livre de 640 pages est consacré aux gens qui sauvent des Juifs en Europe orientale, malgré les énormes risques. L’auteur les classe en plusieurs catégories. La première est celle des « sauveurs gris », en général des soldats, qui sauvent certains juifs mais en exécutent d’autres selon le lieu (y compris dans les Einsatzgruppen qui tuent par balle hommes, femmes et enfants par milliers en une journée). La seconde catégorie est celle des hommes ou femmes d’église (qui peuvent bénéficier du soutien de leurs ouailles) et des groupes de résistance et de partisans locaux, qui ont chacun pour eux d’appartenir à des organisations constituées dans un environnement sans Etat (Armée polonaise de l’Intérieur, partisans soviétiques, plus rarement encore nationalistes ukrainiens) et qui peuvent éventuellement recruter. La catégorie suivante est qualifiée de Justes par l’auteur et ceux-ci sauvent par intérêt personnel (d’ordre sentimentalo-sexuel ou économique par exemple) ou par simple humanité (la bonté en ces temps p. 313 et l’irrationalité du sauvetage p. 318). Une fin de livre appropriée sans doute.
Mais ce n’est pas réellement la fin … La conclusion met l’accent sur la non-unicité du génocide des Juifs en tant que phénomène historique et humain et sur le fait qu’un tel mécanisme pourrait bien resurgir si une crise frumentaire mondiale venait à surgir et que des responsables venaient à être désignés. Les années 2010 n’ont pas été sans problèmes de ce genre, comme en Egypte ou en Syrie par exemple. En Syrie, c’est sans nul doute une cause de la guerre civile. Et l’Etat peut paraître solide, il n’en est pas moins une patiente construction dont l’absence fait disparaître tout droit. Il reste des gens qui rêvent de ce genre de choses prévient l’auteur.
Au-delà des cartes dans le texte, ce volume est complété par d’abondantes notes (au système sans numérotation assez moyen), une bibliographie bien entendue très ample et un index étoffé.
Le point le plus le plus important du livre est de rappeler que les Nazis ont pour objectif de remplacer l’Etat par la race, mais que cet objectif n’est pas d’abord atteint en Allemagne mais bien à l’Est. L’Etat est clairement l’obstacle au plan des Nazis de se débarrasser des « éléments non-naturels » en Europe. Le lien direct entre l’échec de l’Opération Barbarossa et la Solution finale est de plus très clairement expliqué (et les unités de la Wehrmacht sont très vites autonomes pour ce qui est d’éliminer des gens p. 190). Le livre a aussi pour objectif de lutter contre une mémorialisation de l’Holocauste, où il n’y a plus qu’Auschwitz, et il y réussit assez bien (alors que le grand public soit censé découvrir la « Shoah par balles » à intervalles réguliers). Pour T. Snyder, l’histoire dans sa complexité et sa variété doit encore être présente dans la sphère publique non spécialisée. La différence entre le communisme et le nazisme est aussi patente dans cette étude : les exécuteurs soviétiques sont organisés, efficaces et seul le NKVD est chargé des basses œuvres, tandis que les Nazis sont dans l’improvisation et la massification des tueurs (chacun y est appelé, p. 123). C’est dans ce sens qu’il faut comprendre H. Arendt.
C’est un livre très rude mais agréable à lire au sens esthétique (par exemple p. 170 ou p. 285 sur l’Holocauste qui pave le chemin à l’occupation soviétique), avec des cartes nombreuses et très utiles (malgré l’erreur sur celle de la p. 197 concernant une Alsace non intégrée au Reich). La partie sur la France est peut-être un peu simpliste ou fait confiance au lecteur pour se rappeler qu’il y deux zones en France, une libre et une occupée, jusqu’en novembre 1942 (p. 246). L’auteur semble aussi laisser entendre, de manière fausse ou très incomplète, que ce sont les colonisateurs qui ont inventé les ethnies en Afrique, comme p. 329 dans le cas des Tutsis et des Hutus au Ruanda. Très concentré sur l’Europe centrale et orientale, ce livre est néanmoins un indispensable sur l’horreur meurtrière à grande échelle qui ravage la moitié d’un continent pendant de très longues années.
(les Polonais ne se nomment pas une Nation martyre sans aucun fondement … 8,5)