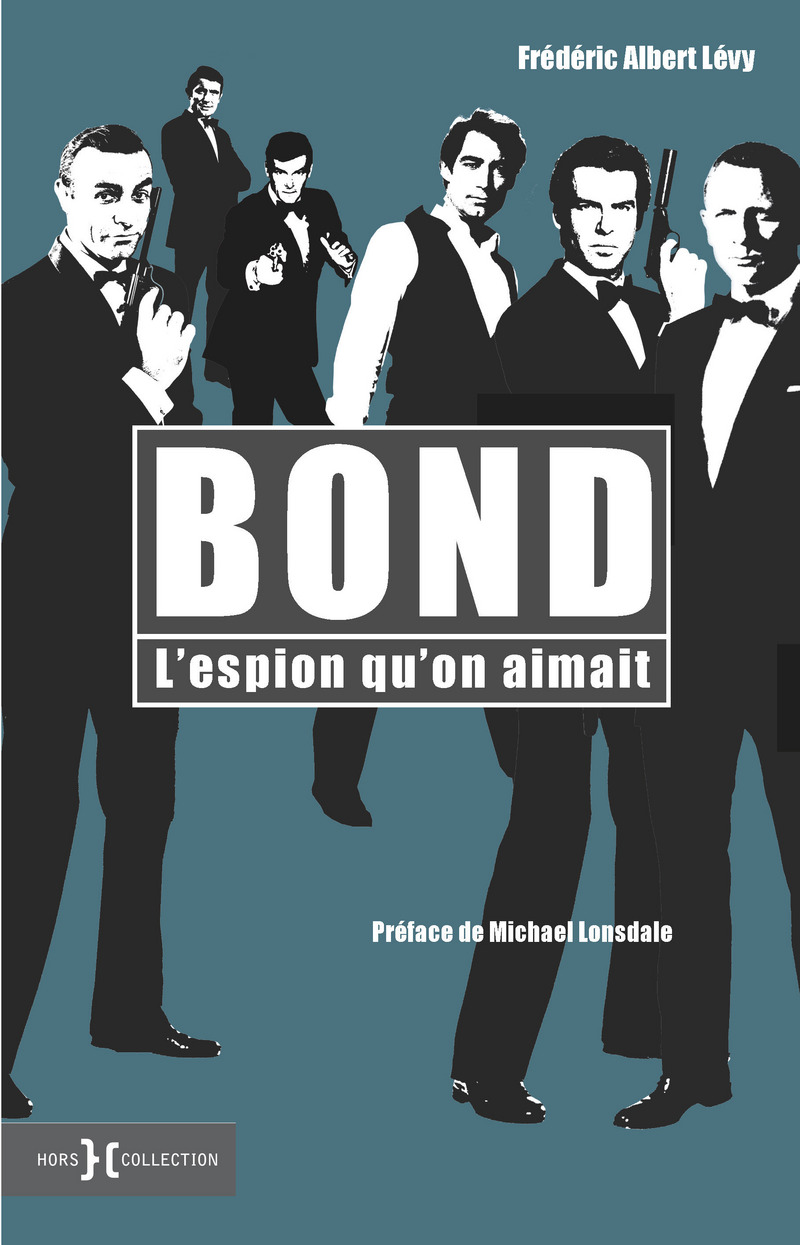Témoignage autobiographique sur la vie de commando marine par Louis Saillans.

Des films documentaires sur les commandos marine sont légion (mais principalement axés sur la sélection), les livres de témoignage le sont un peu moins. Ces derniers ont pour avantage de pouvoir faire plus facilement le choix entre ce qui est dicible ou pas dans les événements qui sont rapportés (du point de vue du secret militaire en premier lieu) et de permettre au spectateur/lecteur d’avoir accès à une certaine intériorité. Ce livre rassemble les souvenirs et les réflexions qu’ont pu faire naître dix années intenses (et l’adjectif est faible) sous les armes.
L. Saillans (forcément un pseudonyme) a un parcours particulier : il a d’abord été élève-pilote dans l’Armée de l’Air puis a bifurqué vers les commandos Marine par goût de l’aventure. Il aurait été intéressant de savoir si cette formation aéronautique lui a été d’une quelconque aide dans sa carrière, mais le livre n’en dit rien. Passé la terrible sélection, il est affecté en unité avant de devenir chef de groupe cinq ans plus tard. De ses missions, l’ouvrage ne mentionne que celles en milieux arides (seulement le Mali ?) mais on peut se douter que ce ne fut pas toujours le cas.
Les quinze chapitres du livres sont agencés chronologiquement, avec les premières années sous l’uniforme, le changement de voie, le stage commando, les premières missions (assez court) puis on passe aux missions en tant que chef de groupe (la majeure partie du livre) entre capture de chef terroriste, appuis aux forces locales, saisie de caches d’armes (de vive force), recherche d’un soldat allié porté disparu et neutralisation de groupes djihadistes. Les problèmes moraux qui peuvent se faire jour ne sont pas absents, tant dans le groupe que dans le cadre de la coopérations avec d’autres forces, étatsuniennes par exemple (p. 108). On a aussi l’opportunité d’apercevoir quelques bribes de la vie de camp ou comment les changements dans la vie privée peuvent avoir un effet sur l’état d’esprit de l’auteur (devenir père). Le dernier chapitre est articulé autour de trois citations (Dostoievski, Platon et Héraclite) et touche aux thèmes de la discipline, de ce que signifie être chef (la responsabilité) et de ce qui est transposable dans la vie civile. L’épilogue rappelle les propos de l’introduction : il faut maintenant pour l’auteur continuer hors du champs de bataille le combat pour les valeurs qui l’y animaient déjà.
Sans savoir grand chose du processus d’écriture de ce livre, il faut saluer sa très grande lisibilité (mais qui est cohérente avec le niveau montré à l’oral dans les entretiens qui ont accompagné le lancement du livre). Pas de grande littérature, du direct, du factuel, quelques termes qui auraient pu être mieux choisis (les « complices » de J. Moulin, p. 188) mais avec de belles tournures. Au delà de la description au ras du sable (qui garde tout son intérêt), ce qui est plus intéressant encore ce sont les moments autour de l’action, la préparation de la mission (mais aussi le brouillard de la guerre) et ce qui se passe après le retour à la base. Les raisons de l’engagement djihadiste (p. 110) sont un peu simplistes, trop monofactoriels, et les citations du chapitre 15 font un peu statuts de réseaux sociaux (mais sont argumentées). Par contre, Clausewitz est assez mal cité p. 190 … Le mélange en cahier central entre les photographies professionnelles (produites vraisemblablement pour les forces armées) et la collection personnelle de l’auteur est très sympathique (sans pour autant éviter la discussion) et apporte un grand plus au livre. Un bon ouvrage dans ce type particulier, qui a bien su manœuvrer entre récit qui avance et gestion du nécessaire secret.
(même pour le meilleurs il y a toujours danger … 7,5)