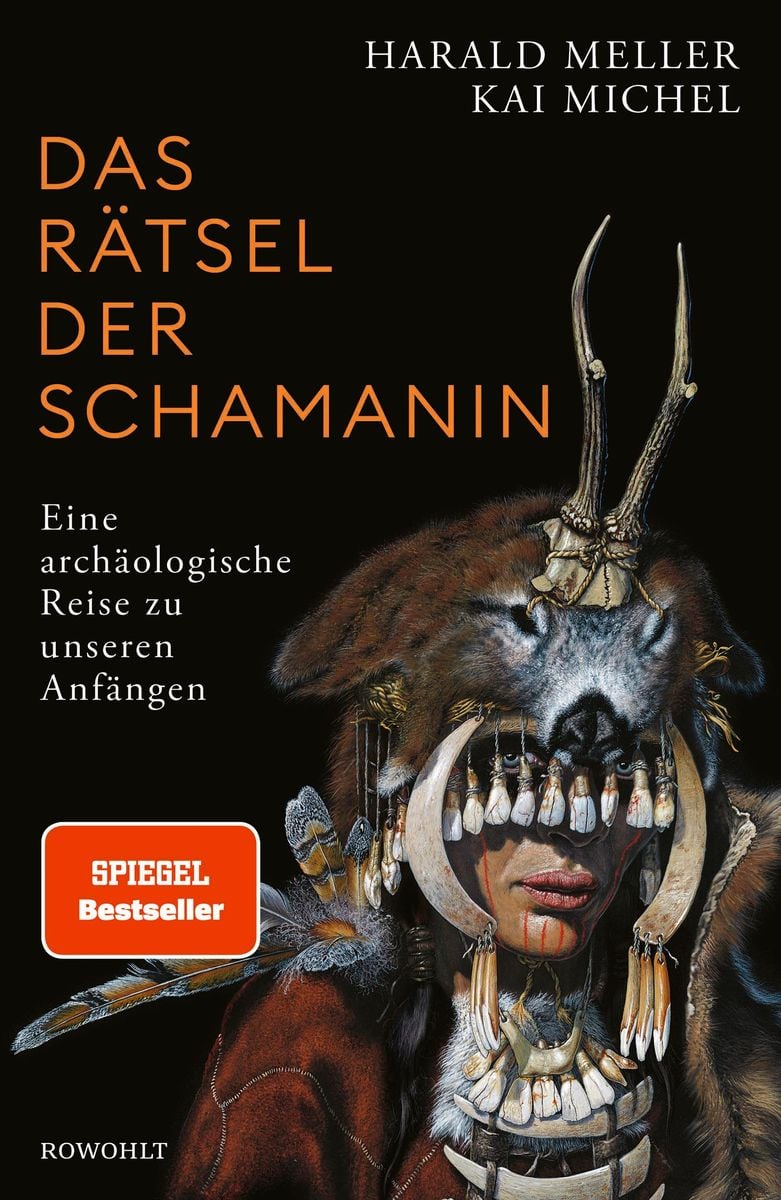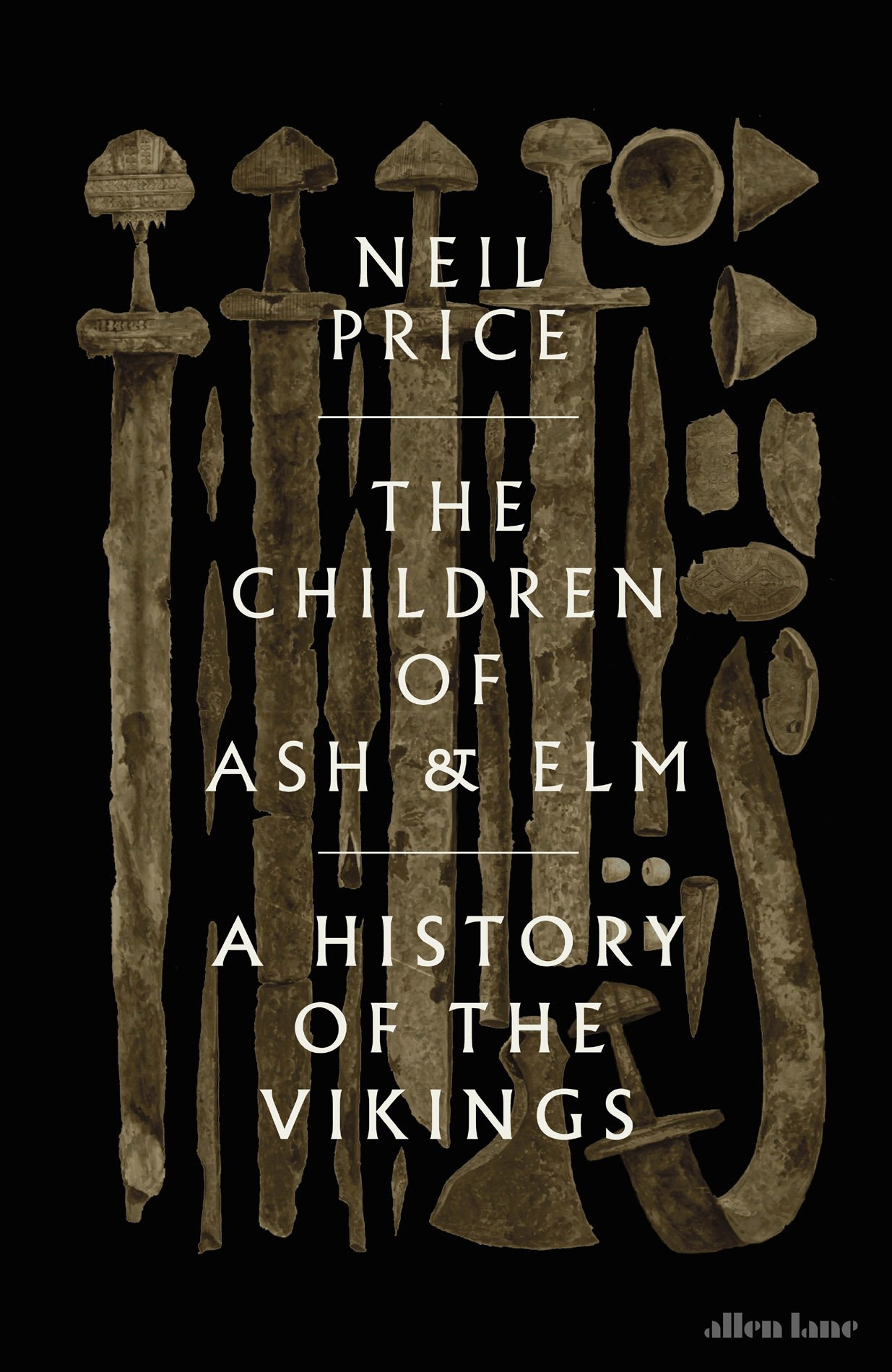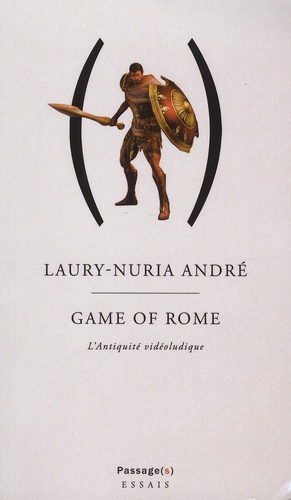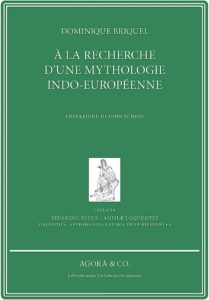Acta Hyperborea 16
Actes des journées nordiques d’étude sur l’Etrurie des 15 et 16 novembre 2018 à Copenhague édités par Mette Moltesen et Annette Rathje.
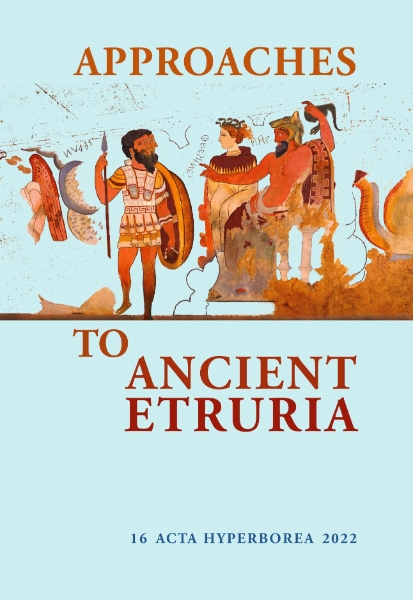
Les pays méditerranéens n’ont jamais eu le monopole de la recherche sur l’Antiquité classique (sans même aller jusqu’au différent toujours pendant entre la Grèce et la Grande-Bretagne à propos des marbres du Parthénon) et ces actes du colloque tenu à Copenhague le montrent à plus d’un titre. Rassemblant douze contributions de chercheurs danois, norvégiens, suédois et finlandais (mais une allemande et une italienne se sont subrepticement glissés dans ce groupe nordique) sur des sujets très divers, le recueil permet aussi au lecteur de comprendre comment l’art étrusque s’est répandu au Danemark et qui en furent les instigateurs (comme c’est déjà brièvement abordé dans l’introduction).
Un premier article pourtant assez étrange, détonnant même. Il traite de poteries proto-villanoviennes (XIIe-Xe siècles av. J.-C.) trouvées à San Giovenale (dans la province de Viterbe) que l’auteur souhaite attribuer à la culture dite de Terramare (XVIIe-XIIe siècles a.C., mais dans la vallée du Pô). D’une certaine manière l’article semble incomplet, parce que manquent les éléments qui devraient convaincre le lecteur que la datation du site doit être réévaluée et qu’un hiatus a eu lieu à l’époque villanovienne avant que le site ne soit de nouveau occupé à la période orientalisante (milieu VIIIe siècle). L’évocation de la chute de Troie et le fait que le Linéaire A soit du proto-étrusque (p. 28), en plus de l’absence de références aux travaux de D. Briquel sur les Pélasges, ne jouent pas en faveur de la crédibilité du propos qui vise in fine à prouver que la culture de Terramare est en fait déjà étrusque sans être villanovienne …
L’article suivant s’intéresse aux moulures architectoniques dans l’architecture étrusque et romaine d’époque républicaine. C’est la présentation d’un travail de grande ampleur, commencé dans les années 1950 et qui continue au XXIe siècle et qui a pour but de mesurer et décrire les différents types de moulures architectoniques présents en Italie centrale pour ainsi détecter des schémas géographiques ou temporels. Cela peut être aride mais il y a des résultats (il n’y a pas deux moulures identiques en Etrurie p. 40, les choix sont locaux et non pas chronologiques, impliquant des datations pouvant courir sur sept siècles) et il est toujours plaisant de tomber sur un petit temple que l’on connaît mieux que les autres.
Le chapitre suivant s’intéresse à l’image en contexte étrusque, avec la réinterprétation de représentation de scènes figurées (sur des objets tels des fourreaux), à la question des hybridations dans le domaine funéraire, aux simulacres (p. 100) puis enfin aux urnes cinéraires qui deviennent des canopes. Le tout pour arriver à la tombe comme demeure et espace liminal. C’est très concentré, cela saute de thème en thème de manière très rapide mais on voit tout de même où veut aller l’auteur. L’article qui lui fait suite reste dans le domaine de l’iconologie avec la réinterprétation de l’oinochoé Tragliatella, datée de la fin du VIIe siècle a.C. et trouvée à Cerveteri. L’auteur conclut à la représentation du curriculum vitae d’une femme nommée Thesathei, sans doute la propriétaire de la tombe où a été trouvé le vase. Toujours dans la thématique de la représentation des Enfers, l’article suivant décrit et analyse une plaque de bronze de la fin de la période orientalisante, entre hybrides et animaux nourissants et chassants (le loup comme animal transitionnel p. 145), montrant peut-être les goûts pour l’Orient de la famille propriétaire de la tombe (à Colle del Forno).
Puis l’on passe à ce qui, à notre sens, est parmi les meilleurs articles du recueil et qui traite des masques dans les tombes étrusques. L’auteur y insiste sur la signification funéraire du masque en Etrurie, sur les parallèles entre le personnage masqué de Phersu et le satyre (encore une grécisation de surface selon l’auteur p. 168) et finalement l’importance d’attirer sur soi l’attention des démons (par le rire et les outrances en premier lieu) pour permettre un passage sûr du défunt dans l’au-delà. Dans cet article on a aussi l’explication des différences entre théâtre romain et théâtre grec (le dionysisme est funéraire en Etrurie p. 170) et le pourquoi des larges coupes à boire retrouvées en contexte funéraire (et représentées sur les murs des tombes peintes). La coupe surdimensionnée devient le masque mais aussi la partie supérieure de l’urne biconique (p. 180-181), une impression démultipliée quand des yeux sont peints sur ladite coupe, une pratique grecque favorisée semble-t-il par la clientèle étrusque (p. 173-176).
Le septième article du volume tente de faire le point sur la question de savoir si l’on peut, à l’aide des représentations figurées, déterminer une pensée du paysage en Etrurie. Pour l’auteur, la question reste ouverte mais l’étude permet des considérations sur les canards et les pigeons peints dans les tombes jusqu’à la période archaïque, ou sur la grande présence des colombes.
L’archéoaccoustique est l’objet du chapitre suivant, avec un catalogue des différents instruments retrouvés ou représentés en Etrurie puis une description des différentes situations où de la musique peut être jouée : funérailles, banquet, chasse, sport, guerre et rites religieux. Des choses assez basiques mais le résumé est bien fait (sans citer J. Heurgon hélas …). Puis l’on retourne dans les tombes avec une étude architectonique et des emplacements peints sur les parois avec une étude limitée à Tarquinia (il y a 6100 tombes rien que dans la nécropole des Monterozzi à Tarquinia p. 258), entre horizontalité et verticalité, qui trace très bien l’évolution sur trois siècles. Quant à adhérer aux conclusions sur les mouvements du défunt, nous serons plus réservés. Suit une très belle étude sur le Sarcophage du Magistrat (de Cerveteri), elle même suivie par une très intéressante analyse épigraphique mentionnant la divinité CavaΘa Seχ (sur un skyphos qui aurait été retrouvé à Orvieto). Cette divinité est associée à Śuri, sorte de dieu apollono-chtonien. Les deux bénéficient d’un culte à Pyrgi, sans que l’on puisse encore mieux définir ses attributs à une époque (archaïque) où « l’étiquettage grec » commence à peine.
Arrive un des sommets (à notre sens) du recueil avec l’étude prosopographique de la circulation par le mariage des femmes nobles dans toute l’Etrurie, signe d’alliances interfamiliales débordant le cadre des cités. Il y a de ce côté là de belles choses possibles, dans une spécialité qui semblaient depuis très longtemps passée de mode. Pour achever le volume, il reste au lecteur à lire un bel article sur la question du portrait sur les urnes de Volterra (dont le grand nombre permet la sérialisation) avant de passer à quatre miroirs de la collection rassemblée par le sculpteur danois B. Thorvaldsen (dont des miroirs remaniés par des faussaires) et leur influence sur l’œuvre de l’artiste, un étudiant assidu de l’Etrurie à l’origine de la collection étruscologique copenhaguoise en plus du Musée Grégorien Etrusque du Vatican (le dernier chapitre).
Très richement illustré, bien équilibré en terme de sujets, producteur d’exclamation et de perspectives, voilà des actes qui sont un plaisir à lire. Comme toujours, tous les arguments avancés ne sont pas également convaincants (Terramare, l’explication du terme étrusque « lupu » p. 144) mais nous sommes loin des idées très aventureuses que l’on peut lire ailleurs. Suivez notre regard … Pour chaque article, des notes et une bibliographie récente sont fournies et si les public visé est celui des spécialistes, la clarté des propos permet à un lectorat plus novice mais intéressé d’accéder lui aussi à quelques belles pépites.
(l’oriental Maître des Animaux est remplacé par l’Ami des Animaux dans la Tombe des Lions Peints de Cerveteri où ces derniers sont caressés plutôt qu’étranglés …8)