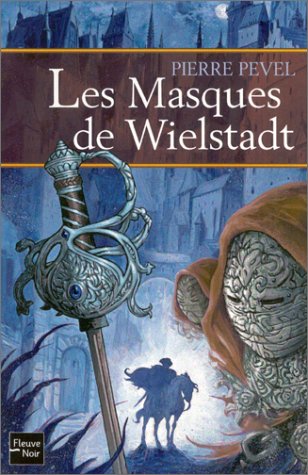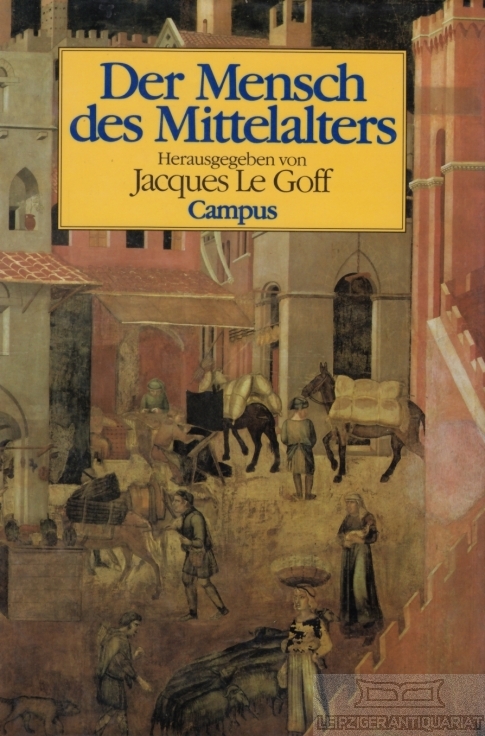Anatomia di une città scomparsa
Essai d’étruscologie de Stefano Bruni.

Pise, une ville antique sans antiquités. p. 7
Pise, c’est l’oubliée de l’étruscologie. Très rarement sur les cartes, ou alors remplacée par la colonie romaine de Luni, et absente des grands manuels de la discipline. Il est vrai que la cité étrusque la plus au nord sur la côte tyrrhénienne cumule les handicaps : comme souvent en Toscane une occupation urbaine continue jusqu’à nos jours, pas de tombes peintes comme à Tarquinia, pas de nécropole romantique comme à Cerveteri ou de murailles pittoresques comme à Rosselle. Les découvertes archéologiques des siècles passés n’ont pas non plus mis au jour de trésors et à peine quelques découvertes fortuites ont été faites avant le XXe siècle. Seule la mise en place d’une administration patrimoniale et la conduite de fouilles de sauvetage permirent de petit à petit se faire une idée de la ville située aujourd’hui bien plus loin de la mer qu’au Ve siècle avant notre ère, à la confluence de l’Arno et de l’Auser (aujourd’hui appelé Serchio, au cours détourné à partir du VIe siècle ap. J.-C. et ne se jetant plus dans l’Arno). Et c’est seulement avec ces découvertes que l’on passe d’une Pise vue comme ligure à une Pise étrusque.
Et c’est aussi l’objet de la première partie du présent livre, écrit par Stefano Bruni en 1998 alors qu’il est encore archéologue auprès de la Surintendance archéologique à Pise et en charge des fouilles urbaines. La seconde partie avance quelques pistes pour la reconstruction du paysage antique de la bouche de l’Arno, avec quelques intéressantes remarques sur ce qu’est un « paysage troyen » (p. 53), qualificatif que semble donner quelques sources grecques à la ville. La transition se fait naturellement avec l’étude des différents mythes de fondation, qu’il soit troyen, grec (en lien avec la Pise d’Elide, près d’Olympie), étrusque (Tarchon y est le fondateur, comme à Tarquinia) ou encore, de manière assez étrange, hyperboréenne ou sicule (p. 65).
La troisième partie a pour but de poser les bases de l’occupation de la région pisane à l’Age du Bronze et à l’Age du Fer. Si les premières hauteurs entre Pise et Lucques sont occupées dès le Paléolithique, c’est aussi le cas des dunes entre Pise et Livourne. L’emplacement de la ville actuelle reçoit un premier peuplement à l’époque du Bronze et l’Age du Fer voit vraisemblablement l’émergence de familles aristocratiques et les premières nécropoles. S. Bruni passe ensuite à la période archaïque et passe en revue la ville (enfin ce que l’on peut en voir, c’est-à-dire pas tant de choses que cela), les nécropoles, le port de San Piero a Grado et l’organisation territoriale. L’auteur fait aussi part de ses espoirs quant aux découvertes futures qui permettraient peut-être d’en savoir plus. S. Bruni enchaîne sur la période classique (aux vestiges retrouvés moindres, surtout à cause des fondations des maisons-tours de la période médiévale qui vont venir détruire ces niveaux, p. 209) avant de passer à la période romaine. Cette dernière partie évoque le renouveau monumental de la ville, la question des murailles de la ville (passage très intéressant sur pourquoi ce n’est pas forcément une nécessité p. 231), les effets de l’alliance avec Rome et les rapports conflictuels avec les Ligures, quelques mots sur la production artisanale locale et enfin, pour finir, l’intégration de Pise dans le système romain qui se fait au Ier siècle av. J.-C. Le livre s’achève sur une bibliographie conséquente, une liste des sources antiques et divers index. Il n’y a pas vraiment de notes (des références dans le texte) et les renvois se font dans la bibliographie. Un système pour le moins … moyen. Le cahier central d’illustrations est impraticable.
Avec cet ouvrage, on sent de manière brute que le manque de sources ne permet pas toutes les audaces. Le seul passage où l’auteur se laisse aller à quelques conjectures est même très clairement indiqué avec l’emploi du mot fantaisie (p. 191). C’est donc sérieux du début à la fin, avec un auteur au plus près des sources archéologiques mais qui fait plus que se défendre avec les textes. On aurait par contre quelques sérieuses remontrances à faire aux cartes, trop sommaires. Celle des p. 46-47 est à la fois trop détaillée (toutes les rues de la ville actuelle) et incomplète pour permettre une compréhension. On cherche même dans ce cas le lien avec le texte.
Mais ce livre, avec ses tous petits défauts et un italien pas toujours facile, parvient néanmoins à faire renaître devant le lecteur une ville très particulière au sein de la confédération étrusque. Une ville entourée d’eau (Ravenne, Spina, Venise), à l’origine toponymique inconnue, aux pratiques funéraires toutes en retenue (difficile même de savoir si le défunt est un guerrier p. 143, des lois somptuaires ?) alors que la ville affiche sa richesse, bien insérée dans les réseaux de la côte, mais aussi vers Bologne et la Sicile et plus loin, le monde ionique (p. 138). Productrice de cippes (leur emploi incroyable autour du tumulus de la via San Jacopo p. 150-151, déjà évoqué ici), construisant au besoin des cénotaphes, Pise use aussi de cratères pour recueillir les cendres de ses défunts, parfois en marbre. Et le marbre est bien plus travaillé que dans les autres cités tyrrhéniennes, avec une stylistique en lien avec Marseille et l’Ionie (p. 167). Cité tournée vers la mer, elle fonde des colonies (Gênes) et entretien des comptoirs jusqu’en Espagne (Lattes, p. 194). Il y a un caractère pisan indéniable pour l’auteur, très différent de celui de sa voisine Volterra, et que sans vraiment le définir, ce dernier donne au lecteur d’admirer.
(de temps en temps, une petite submersion … 6,5)