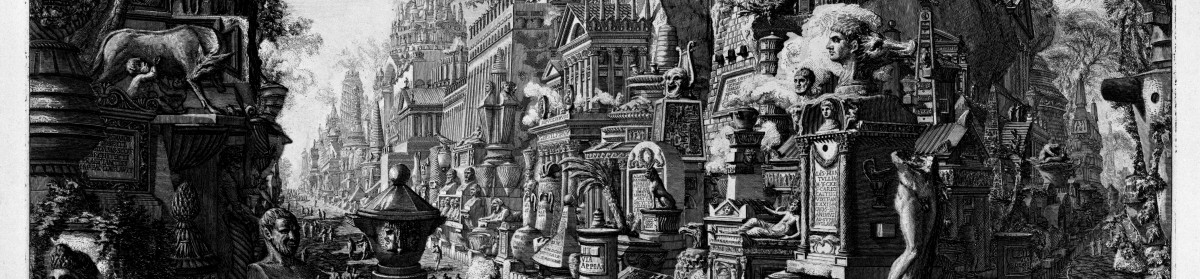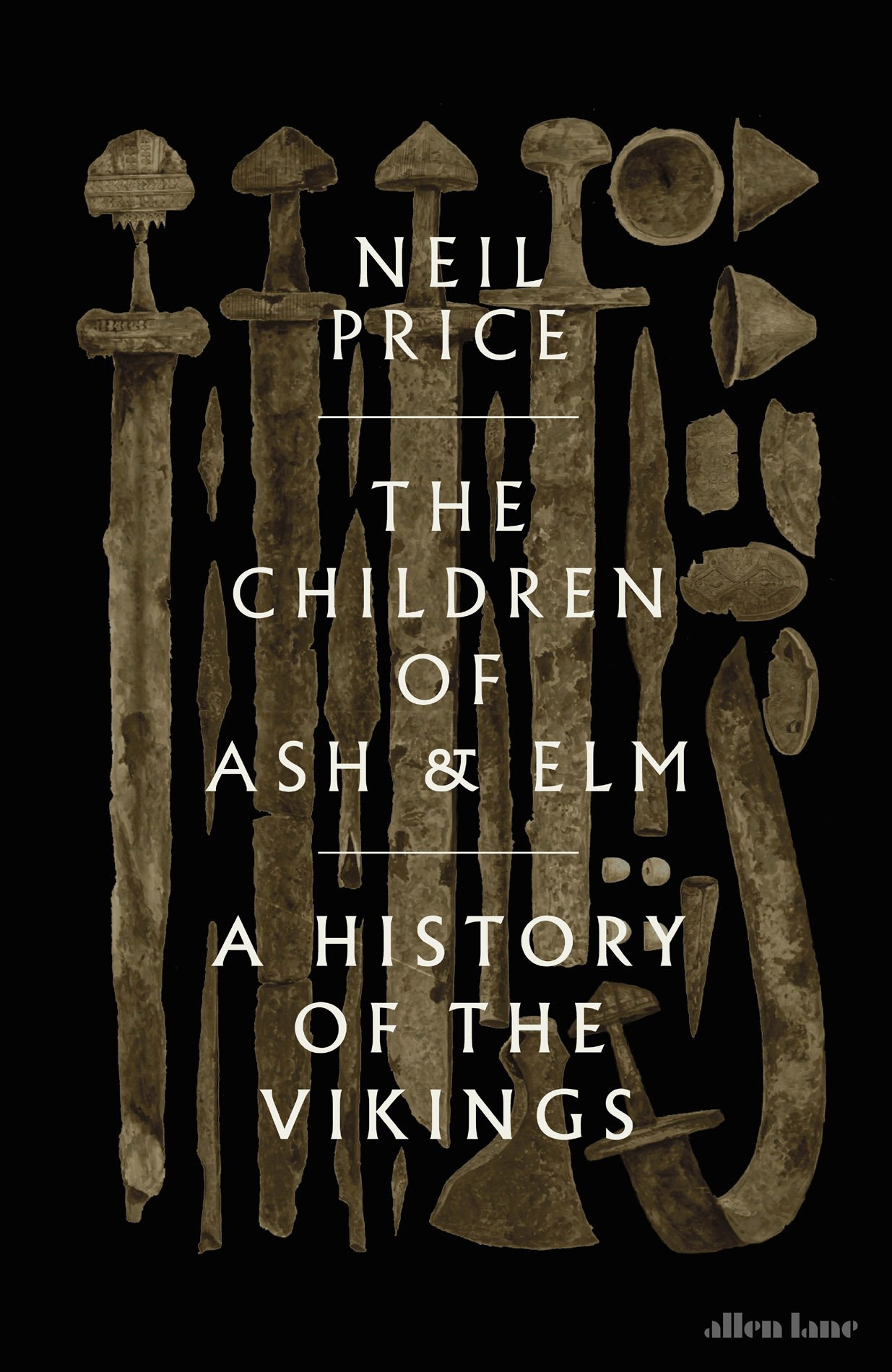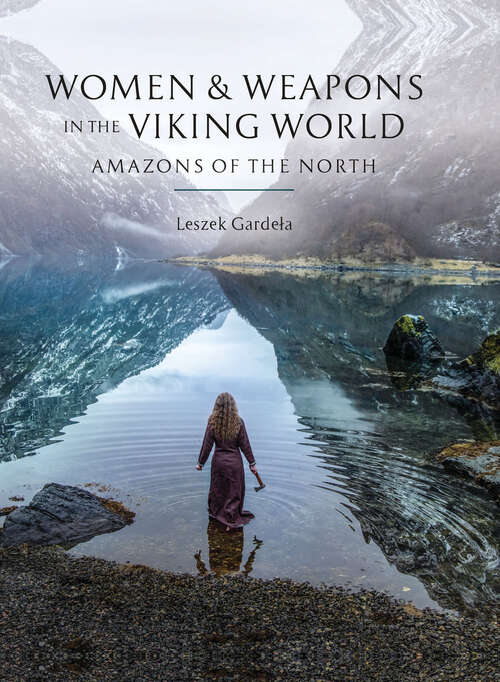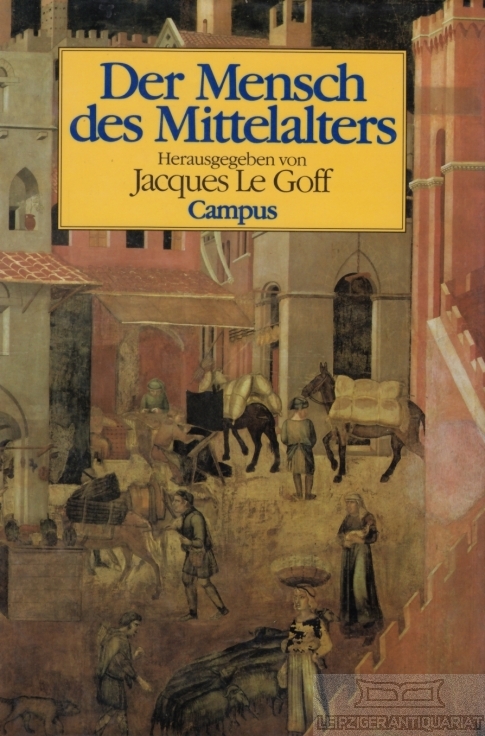A Radical Sect in Islam
Essai d’histoire de l’Islam par Bernard Lewis. Publié en français sous le titre Les Assassins, terrorisme et politique dans l’Islam médiéval.
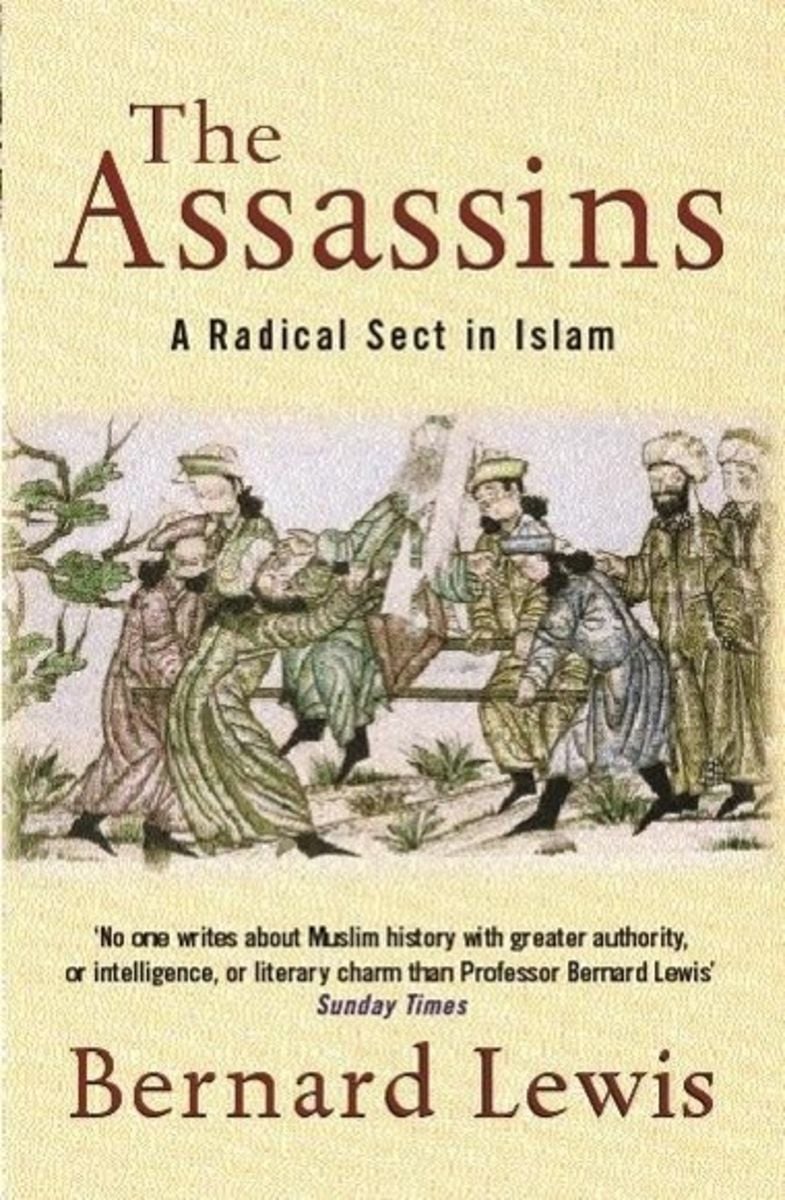
Après la lecture du roman Alamut, il nous est apparu qu’il nous plairait de déterminer ce qui relevait de la littérature de ce qui relevait de sources historiques dans ce roman. Et avec le livre de B. Lewis c’est une bonne tranche d’ismaélisme nizârite qui est proposée au lecteur, par un spécialiste, islamologue et orientaliste, qui a eu une activité politique plus disputée à partir de la fin des années 1990 (sans parler de positionnements scientifiques, disons particuliers, sur le génocide arménien ou l’antisémitisme importé en terre d’Islam). En 1957, c’est lui qui a inventé le terme « choc des civilisations ». Mais en 1967, il est encore loin des ors de la Maison Blanche (et de la justification d’une politique aux conséquences encore bien visibles et désastreuses) et se spécialise dans les relations entre l’Islam et l’Occident.
De manière très intéressante, le livre débute sur la manière dont l’Occident a pris connaissance de l’existence de cette secte musulmane, en prenant comme point de départ l’introduction dans le vocabulaire du mot assassin (comme chez Dante par exemple, en Enfer, XIX, 49-50, dans le premier quart du XIVe siècle). Louis IX lui-même échange des cadeaux diplomatiques avec le chef syrien de la secte en 1250. L’existence des Assassins est donc connue, voire reconnue comme un acteur politique, par les Croisés alors qu’ils ne sont pas parmi les cibles prioritaires de leurs assassinats. Ces dernières sont en effet les dirigeants politiques sunnites qui visent à la réunification de l’Islam ou pourraient le faire : un calife, un vizir, un sultan seldjoukide, jusqu’à Saladin lui-même. Les études scientifiques sont bien sûr plus tardives, mais relativement précoces, puisque dès 1603, une étude lexicographique parle des Assassins. En 1809, l’orientaliste Silvestre de Sacy lit un mémoire entièrement consacrée à ce sujet à l’Institut de France.
Le second chapitre quitte l’historiographie pour plonger dans la théologie musulmane et décrire ce qu’est l’ismaélisme, la matrice de la secte des Assassins. Logiquement, tout commence avec la mort de Mahomet et le choix qui doit être fait entre la succession familiale ou la succession par les compagnons. Les Chiites, partisans d’Ali le gendre de Mahomet, se transforment avec les années en confession autonome. Mais le massacre d’Ali et d’une grande partie de sa famille en 680 lance un processus axant le chiisme sur le dolorisme et la succession des imams, dont certains peuvent disparaître (et doivent revenir sous la forme du Messie pour la fin des temps). Mais tous doivent être issus d’Ali, par son seul fils survivant. Le chiisme se construit donc autour de la succession des imams, mais est aussi traversé par des courants révolutionnaires pouvant contester une succession. Celle du sixième imam en 765 est compliquée et aboutit à une séparation en deux courant, celui des Chiites duodécimains (reconnaissant douze imams, comme c’est le cas en Iran) et celui des Ismaélites. Ces derniers trouvent un public chez les perdants économiques des IXe et Xe siècle dans tous les territoires contrôlés par l’Islam. En 909, des Ismaéliens du Yémen sortent de la clandestinité et établissent un Etat et même une dynastie en Egypte en 969 : les Fatimides. Ces derniers ne prennent pas le contrôle de l’Oumma ni ne renversent tous les pouvoirs sunnites, principalement à cause de l’arrivée sur le devant de la scène des Seldjoukides. Le pouvoir fatimide se délite, et l’Ismaélisme subit une nouvelle sécession par la non reconnaissance par tous du calife cairote à la fin du XIe siècle. Si le prince rebelle Nizâr est tué, ses soutiens survivent et quittent l’Egypte.
Le chapitre suivant arrive enfin à Hassan-i Sabbah, le fondateur des Assassins et comment il passe du chiisme duodécimain à l’Ismaélisme grâce à un exilé d’Egypte puis s’engage dans la prédication. Il est notamment présent au nord de l’Iran, zone déjà travaillée par l’Ismaélisme et aux volontés d’indépendance vis à vis de Bagdad. Au bout d’un temps, le vizir de Bagdad veut justement mettre un terme aux entreprises ismaéliennes. Problème, Hassan a pris le contrôle du château d’Alamut et d’une série d’autres places fortes qui lui permettent de résister à une action de vive force du pouvoir de Bagdad (mais aussi aux Seldjoukides), qui justement échoue. Pour que cela ne recommence pas, Hassan-i Sabah commande son premier assassinat, celui du vizir Nizam Al Mulk.
L’arme de l’assassinat continue d’être utilisée par Alamut et ses dirigeants dans les années qui suivent dans les combats qui les opposent aux autres pouvoirs musulmans locaux. En interne, certains changements doctrinaux (une abolition de la Loi en 1164?, p. 72) conduisent à des dissensions. Mais c’est l’avancée mongole qui va se révéler un problème insurmontable pour les Assassins de Perse. Entre 1258 et 1270, ils sont dépossédés de leurs places fortes et finalement le dernier imam et sa famille sont exécutés au retour d’un voyage à Karakorum où il n’est pas reçu par le Khan (p. 95).
Un autre pôle nizârite existait cependant (cinquième chapitre). Dès le temps de Hassan-i Sabbah, les efforts de prédication en Syrie permettent l’établissement de fortes bases des Assassins venus de Perse, principalement dans les villes. En 1103 a lieu à Homs le premier meurtre qui peut leur être attribué. En 1106, ils ont pris possession de la citadelle d’Afamyia, mais Tancrède d’Antioche leur reprend dans la foulée. En 1126, ils ont la main sur la forteresse de Banyas, accordée par le Turc Dodequin qui règne sur Damas et peuvent acquérir d’autres places dans les années qui suivent. En 1175-1176, les Assassins essaient d’éliminer Saladin par deux fois et l’assassinat en 1192 de Conrad de Montferrat, roi de Jérusalem (alors que la ville n’est plus sous contrôle franc), serait selon l’auteur aussi à attribuer aux Assassins, dans une de leurs rares actions contre des Chrétiens.
La secte existe toujours comme pouvoir politique en Syrie jusque dans les années 1260. La menace mongole est combattue, mais c’est le sultan mamelouk d’Egypte qui les oblige à payer tribut. En 1271, ils lui sont soumis alors que Alamut n’est déjà plus.
Le dernier chapitre discute des buts et des fins des Assassins de manière générale. L’assassinat politique n’est bien sûr pas leur invention et le régicide est une constante en Islam depuis la mort de Mahomet, où les martyrs demandent vengeance et où la justification religieuse du meurtre de dirigeants illégitimes est constante. D’autres sectes chiites pratiquent le meurtre ritualisé (par étranglement, p. 128). L’innovation se situe dans l’usage planifié et continu du meurtre politique, très efficace dans des sociétés où la continuité politique est dynastique au mieux. Les ordres de moines combattants, qui reçoivent un temps tribut des Assassins, les craignent sans doute moins, du fait de leurs mécanismes de succession de type électif (p. 130).
La lecture du livre n’est pas toujours simple, non parce que l’auteur est adepte de circonvolutions inutiles, mais parce que du fait des alliances changeantes, mais aussi de faits qui courent sur plusieurs siècles, les interactions sont très mouvantes. Heureusement il y a des cartes. Les photos en cahier central sont assez inutiles, parce que majoritairement de mauvaise qualité ou pas assez explicitées.
Il peut aussi par moments manquer un peu de contexte. Le passage sur l’abolition de la Loi à Alamut est peu clair et B. Lewis n’arrive pas à expliquer comment un tel changement de doctrine, suivi d’un retour à la situation ante, peut avoir été possible (puisqu’il pense cet épisode véridique), surtout dans une ambiance sectaire tout de même peu propice à ce genre de virages brusques. L’auteur, nous semble-t-il, fait l’économie de nous mentionner des hypothèses qu’il ne retient pas mais qui ne sont pas plus improbables. C’est le cas par exemple avec la mort de C. de Montferrat. Certes la série vidéoludique Assassin’s Creed met l’assassinat sur le compte des Ismaélites, mais le roi de Jérusalem avait d’autres ennemis, et comme le dit justement l’auteur dans son dernier chapitre, ces derniers n’avait de loin pas de monopole (sans parler des sources peu loquaces). N’excluons cependant pas l’influence que le format du livre peut avoir sur la suppression de développements qu’un éditeur pourrait voir comme superflus. Les notes en fin d’ouvrage sont assez peu nombreuses mais apportent un grand plus sur les questions de sources. Par contre les translittérations nous ont parues étranges, surtout pour un arabisant du calibre de l’auteur, mais c’est peut-être là une pratique anglophone (éventuellement datée) qui ne nous est pas connue.
Après cette lecture, nous pouvons juger le roman de V. Bartol comme très solidement et profondément ancré dans les faits historiques, avec une bonne utilisation de personnages historiques reliés entre eux par le romancier mais aussi certaines compressions chronologiques (dont justement le moment nihiliste).
(synonyme de zèle, foi et sacrifice avant d’être celui de meurtre …7)