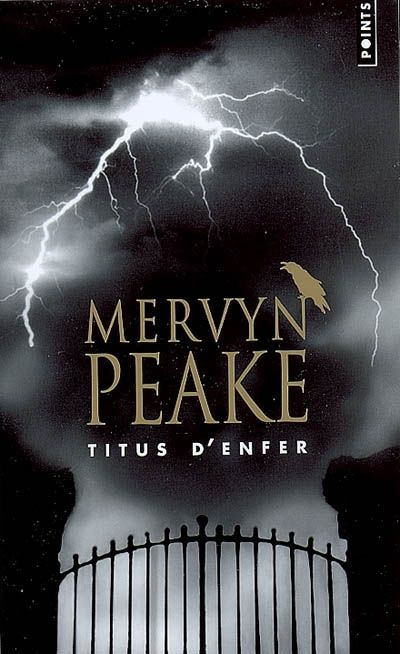Recueil de témoignages édités par Thomas Dandois et François-Xavier Trégan.

Il existait jusqu’à présent des ouvrages sur les revenants français de Daesh. Certains étaient peut-être même des repentis, mais sûrement pas tous. Avec ce livre, notre image est complétée puisqu’il fait le choix de s’intéresser aux recrues locales (des Syriens et un Jordanien) de l’Etat Islamique (EI) qui ont fait le choix de la désertion.
Mais il n’y a pas que le fait d’avoir été membre, volontairement ou non, de l’EI qui relie ces gens (les adultes interrogés étaient tous volontaires, les deux enfants étaient des enfants soldats arrachés à leur famille). Ils ont aussi tous été exfiltrés par une organisation basée dans le sud de la Turquie et dont l’assèchement en ressources humaines est l’angle d’attaque contre l’EI. Et c’est visiblement une activité dangereuse. Mais comme cette organisation est conduite par des anciens habitants de Raqqa, cela a pour conséquence limitatrice que les témoignages recueillis par les deux auteurs sont ceux de gens provenant majoritairement de cette région ou de Deir ez-Zor tout en ayant l’avantage que ces mêmes témoins ont habités dans la région de la capitale syrienne de l’EI.
Mais les auteurs ne sont pas non plus dupes des gens qu’ils rencontrent, comme ils le soulignent dans le préambule : ils sont très déçus par l’EI, mais n’ont pas forcément renoncé au salafisme ou au jihadisme (p.13). Le préambule permet de présenter les méthodes utilisées, l’intérêt des témoignages croisés qui permettent des recoupements et certaines conditions d’entretien (un soir d’attentat p. 14).
Les six premiers chapitres permettent d’esquisser un portrait de l’organisation qui exfiltre les déserteurs de l’EI appelée Thuwwar Raqqa. On y apprend, dans la mesure où cela ne pose pas de problème sécuritaire, comment fonctionne cette organisation, les dangers encourus, sa naissance et ses évolutions. Thuwwar Raqqa rassemble aussi des documents sur l’EI, tant sur son ordre de bataille que sur ses ramifications plus civiles. Que sur ce point l’organisation fasse des appels du pied à l’endroit de services de renseignement (contre financement) paraît évident, et il est difficile pour le lecteur de prendre pour argent comptant tout ce qui est décrit. Toujours est-il que les deux auteurs (dont au moins un est arabophone) sont impressionnés. Le dernier chapitre de cette partie donne un avant-goût des témoignages, avec parfois des informations que l’on ne retrouvera pas forcément dans ces mêmes témoignages.
La seconde partie rassemble les témoignages, un par chapitre et onze en tout. Le premier est celui d’un dénommé Abou Ali. Jordanien mais ayant étudié en Syrie, il passe assez facilement la frontière pour rejoindre l’EI. Il est envoyé en formation théologique, où dès le premier jour on lui demande s’il veut participer à une mission suicide. Il ne peut faire confiance, tellement on peut vite passer de vie à trépas. Il dit avoir été choqué par le peu d’ouverture d’esprit des gens sur place … Après la formation théologique, trois semaines de formation militaire et direction le front. Brancardier puis gardien de prison, il déserte depuis Alep.
Le second témoignage est celui d’Abou Oussama. Il rejoint l’EI parce que ce sont eux qui ont rétabli l’ordre à Raqqa et qu’il est attiré par le Jihad. Puis suivent Abou Hozeifa (il est resté quatre ans et demi) qui a été le chef d’un check-point, Abou Maria un cuisinier aux premières loges de la corruption des émirs. Kaswara avait encore 14 ans quand il est devenu un agent de la sécurité intérieure de l’EI. Il a égorgé et fait égorger mais est parti après avoir subi un viol. L’instituteur Abou Fourat n’a pas été membre de l’EI mais s’est enfui et il a peut-être connu Moussa et Youssef, deux enfants soldats, eux aussi interrogés par les auteurs. Leur oncle apporte fait aussi le récit, très pessimiste, de comment les enfants sont attirés et formatés par Daesh, ce que confirme Abou Ahmad dans le chapitre suivant. Abou al-Abbas a quant à lui été chanteur pour l’EI et dans le dernier témoignage Rayan raconte comment, étudiant, il s’est retrouvé dans Al-Qaida puis l’EI parce qu’il avait été refusé par d’autres groupes rebelles. Une très courte postface veut mettre en garde le lecteur : la fin de l’emprise territoriale de l’EI n’est de loin pas la fin de l’organisation.
La forme du livre est dérangeante d’une certaine manière. Ce ne sont pas des témoignages bruts mis en forme mais des témoignages réécrits, sans indications. Ils sont très travaillés, peut-être même trop, et ne permettent pas de pouvoir retrouver les formulations originales, encore moins les questions des deux auteurs. Et des questions il y en a sûrement eu, comme presque chaque témoignage s’achève sur une exhortation à ne pas se joindre à l’EI. Les entretiens ont peut-être décousus mais il y avait sans doute moyen de plus respecter les paroles d’origine.
Dans leur insincérité, les témoignages sont intéressants, montrant bien la prise en main de la société syrienne par l’EI et son utilisation des enfants, comme d’autres totalitarismes avant eux (p. 167 entre autres). Les témoignages donnent une idée assez précise de l’attrait qu’a pu avoir ou que peut encore avoir cette organisation, avec des parcours divers qui amènent à s’engager, forcé ou non. Pour beaucoup de témoins adultes néanmoins, l’idée de départ n’était pas si mauvaise mais les jihadistes de l’EI ont tout gâché, surtout en invitant des combattants étrangers. Tous n’excluent pas de ne pas retourner combattre, en Birmanie par exemple (p. 104).
(le terreau est toujours là … 6)