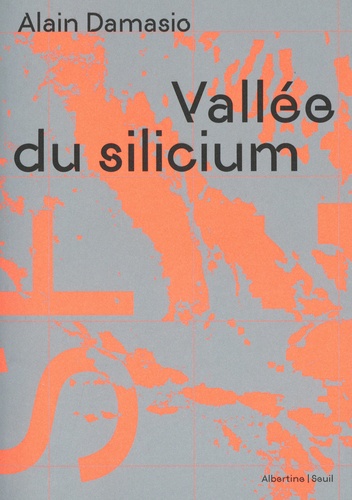De la chute du mur à la guerre d’Ukraine 1989-2024
Essai d’histoire du temps présent par Georges-Henri Soutou.

Un professeur d’histoire diplomatique, mondialement reconnu pour ses travaux sur la Première Guerre Mondiale, qui s’aventure dans l’histoire des relations entre la Russie et l’Occident après 1989, voilà qui devait être intéressant. La mise en perspective, l’érudition, les analyses à grand spectre et les pointes, tout ce qui es non seulement le fruit d’années dans les archives mais aussi le sel de la lecture de G.-H. Soutou, tout cela nous était promis. Mais la base de tout cela n’existe pas encore : des cartons et des cartons dans des rayonnages, des photographies soigneusement indexées et des années qui ont vues la poussières des évènements retomber.
Les dernières années du XXe siècle ouvrent logiquement le bal. La fin de l’URSS est une très grande surprise et toutes les puissances mondiales craignent la désagrégation d’une puissance nucléaire majeure. L’objectif est la stabilité de l’espace soviétique, pas la liberté des peuples et l’aide à la mise en place de la démocratie. Si les pays d’Europe centrale peuvent s’appuyer sur une histoire démocratique (de durée variable), en Russie les précédents historiques n’abondent pas (ou sont très anciens et méconnus, comme la république de Novgorod). L’optimisme règne pourtant, au point de s’illusionner beaucoup sur les intentions des gens aux pouvoirs à Moscou, tous issus du système soviétique. Veulent-ils abdiquer toute idée de puissance et se ranger gentiment derrière leur supposé vainqueur ? Sûrement pas. Si le libéralisme économique est très visible, son pendant politique ne prend pas racine. B. Clinton essaie bien de mieux ancrer la Russie mais dans une politique qui se rapproche de l’unilatéralisme. La crise yougoslave n’arrange pas les choses, avec l’OTAN qui redéfinit son rôle en Europe et bombarde même la Serbie en 1999. La remontée des prix des hydrocarbures redonne économiquement de l’air à la Russie tandis que l’élection d’un nouveau président russe, V. Poutine, permet une réorganisation interne en Russie, la stabilisation économique, le retour de l’État et une mise au pas des acteurs régionaux qui pensaient se ménager une autonomie (oligarques, gouverneurs, la Tchétchénie mise au pas après un premier échec sous Eltsine).
De son côté, la décennie 2000, celle de la guerre en Irak, ne démontre pas une modération en matière d’interventions occidentales (et comme on ne prête qu’aux riches, les révolutions de couleurs sont aussi attribuées à des actions occidentales en sous-main) et l’opération de Libye, qui se solde par un effondrement du régime. La Russie et la Chine se sentent flouées, la résolution du Conseil de Sécurité à laquelle ils ont donné leur accord leur semble avoir été outrepassée. Mais la décennie 2000 voit aussi les premières déclaration de défiance, voire d’hostilité de la part de la Russie à l’encontre des démocraties libérales. La Géorgie est corrigée en 2008 et l’agitation commence dans l’est de l’Ukraine. Dans ce pays, l’intervention russe se fait visible en 2014, à la faveur du mécontentement populaire de la place Maïdan. La Crimée est envahie, l’armée russe soutient les soi-disantes insurrections du Donbass. Les réactions occidentales sont prudentes … et le couvert est remis en 2022 dans ce qui devait être une opérations éclair. Mais le fruit n’était pas si mûr …
Le rythme est incroyablement rapide dans ce livre qui ambitionne d’aller dans un minimum de détails sur 35 années de relations changeantes, mais qui ainsi ne peut éviter certains simplismes. Si on considère la faible présence des notes, on peut se dire qu’il y a ici la volonté de l’éditeur de produire ici un livre à visée pédagogique et qui cherche un public général, intéressé par l’actualité mais avec une prise en compte de la temporalité. Le lecteur qui suit cela de manière plus assidue reste sur sa fin devant les raccourcis et les choix faits dans la présentation des options des acteurs. Nous voyons cela comme un choix éditorial, obligeant l’auteur à se conformer à un format d’essai qui lui laisse finalement, malgré les 300 pages de texte, très peu de place. C’est en fait trop journalistique. G.H. Soutou domine tout quand il s’agit de diplomatie au XXe siècle, mais il n’est pas un spécialiste de l’Ukraine : la bibliographie, certes choisie, est très lacunaire de ce côté alors que le thème occupe peut être un cinquième du livre. L’auteur est de plus sensible à une vision très russe des choses, qui le conduit à des affirmations sans filet du type « la bonne performance des Russes en Géorgie en 2008 » (p. 185). Une performance contre une nation de quatre millions d’habitants que les spécialistes s’accordent à voir comme très en deçà des attentes.
Les passages sur Maïdan et les néo-nazis, le « dialecte » ukrainien, l’inutilité des sanctions (p. 215), les régions dites russophones, Boutcha (p. 273) et Bandera ne sont pas plus inspirés, avec quelques biais qui sont peut-être dus à l’angle diplomatique (centré sur les gouvernements, moins sur les acteurs sociaux) de l’auteur. La proposition d’architecture européenne de sécurité proposée par le Kremlin fin 2021 et devant conduire à un rétrécissement de l’OTAN n’est pas évoquée, mais il y a de très bons passages sur la disparition des minorités en Europe à partir de 1945 (p. 97), sur l’universalisme unilatéral des Etats-Unis des années 90-2000 (p. 68-71), sur les réflexions stratégiques en France juste après la disparition de l’URSS ou encore sur la différence entre V. Poutine et le communisme (p. 174).
Mais comme G.-H. Soutou le dit lui-même à deux reprises, l’histoire sans les sources, c’est difficile. Le résultat ne peut que décevoir.
(On se moque des livres écrits trop rapidement en 4e de couverture …4)