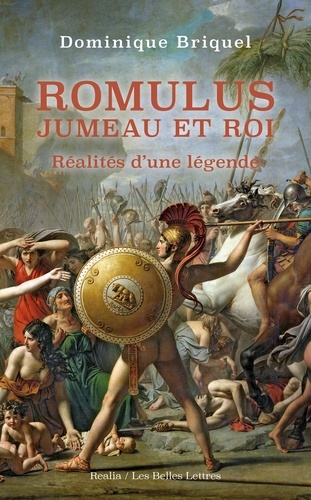Recueil d’articles sur la mythologie indo-européenne et son versant romain par Dominique Briquel.
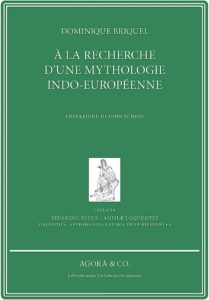
Comme D. Briquel le rappelle souvent, il n’y a pas de mythologie romaine comme il y a, par exemple, une mythologie grecque. Chez ces habitants du Nord-Latium (et peut-être même chez tous les Latins), la mythologie, d’où d’ordinaire les simples mortels sont exclus, s’est légendarisée et a pris divers traits dans l’histoire ancienne de l’Urbs. Les schémas mythologiques indo-européens se retrouvent, pour ainsi dire, non chez Hésiode mais chez Thucydide. Ne s’étant pas arrêté à la figure de Romulus et ses actions, l’auteur s’interroge depuis six décennies sur ce que les Romains ont conservé du fond commun mythologique indo-européen et ce livre en présente un aspect en reproduisant 21 articles (dont certains inédits) écrits entre 1976 et 2021. Reprenant la méthode dumézilienne, il n’hésite pas pour autant à amender le grand comparatiste qu’il a personnellement connu.
Ces articles se répartissent en trois thèmes, à chaque fois précédés d’une présentation. Le premier est celui du combat des dieux, commandant la mise en place du monde et son devenir. Il y est bien entendu question du Ragnarök (comparé au Mahabharata et au mythe de Prométhée) mais aussi de la place qu’occupe le sanctuaire de Saturne en lien avec le sanctuaire de Jupiter sur le Capitole ainsi que les adversaires de Zeus lors de sa montée sur le trône des dieux. On peut aussi lire les premières ébauches de thèmes qui deviendront des livres par la suite : la naissance de la république romaine comme avènement d’un monde parfait, mais aussi la prise de Rome par les Gaulois (390 a.C. selon la tradition) comme retranscription de la bataille finale des dieux.
Le second thème est celui du feu dans l’eau, apanage royal et signe de son pouvoir. D. Briquel y compare comment sont contés la prise de Babylone par Cyrus le Grand et la conquête de Veies (en 396 a.C. selon la tradition), ce qu’il faut comprendre de la punition de l’Hellespont par Xerxès au prisme du feu dans l’eau mais aussi comment il faut voir les Vieux de la Mer et Poséidon dans une optique indo-européenne. Un autre article détaille le lien qui unit le roi de Rome Tarquin l’Ancien à Vulcain (un dieu pas uniquement lié à Romulus donc), avant de commenter le devenir des biens des Tarquins après leur exil avec la création de la république. Pour clore cette partie, l’auteur se penche sur une possible influence indo-européenne dans la Bible avec le combat de Jacob contre Dieu et le passage du fleuve Yabboq (Genèse 32, 23-32).
Le dernier thème s’intéresse à diverses divinités et héros, dans le but de clarifier la personnalité de Quirinus (le troisième membre de la triade précapitoline avec Jupiter et Mars et dieu de la troisième fonction patronant les citoyens) mais aussi de Hermès, dieu paradoxal et pas toujours aimable mais qui n’endosse pas pour autant le destin de Loki, autre figure divine/démoniaque truqueuse. D. Briquel porte aussi la lumière dans la fin de l’ouvrage sur certaines caractéristiques calendaires à Rome et leurs significations avant de passer à l’étude de deux visions du féminin à Rome, celle associant la matrone idéale Lucrèce et Junon faisant face à celle liant la jeune Clélie et Diane. Enfin, le volume s’achève en livrant au lecteur quelques remarques comparatives sur le mythe de Hercule et Cacus, situé sur le site de la future Rome. Avec une bibliographie très robuste s’achève ce recueil de 460 pages de texte qui avait commencé avec une courte préface de John Scheid et une introduction.
Pour nous qui avons une connaissance très limitée des textes de l’Inde védique, il y a toujours à découvrir dans les comparaisons de D. Briquel. Mais dans ce livre, ces découvertes ont aussi concerné la place de Prométhée, dont les actions en tant que participant à une bataille divine au côté de Zeus nous avait échappé. Il y a bien évidemment des redites, mais que nous avons remarqué uniquement parce que nous lisons en un temps resserré plusieurs articles unis par une thématique mais qui ont été écrits à des années ou des décennies d’écart. Les trop nombreuses erreurs typographiques ont par contre un peu moins d’excuses, surtout au vu du prix du livre.
Plusieurs points saillent dans ce contenu dense, plaisant à lire et bien entendu plus que solidement documenté. Le premier est dans la première partie l’importance du passage entre la monarchie dite varunienne et celle mitréenne, entre Cronos et Zeus ou Saturne et Jupiter (p. 75 par exemple), c’est-à-dire le passage de la force brute et aveugle à la souveraineté aidée de la Loi, qui comme les mythes de premier sacrifice (parfois en lien avec un mythe de razzia de bovidés) marquent le début de la civilisation. Le second est l’article sur Xerxès, une explication que nous aurions aimé connaître plus tôt. Ces aspects de maîtrise des eaux comme marque du souverain (et pas uniquement le souverain perse ou en Perse) sont pourtant fondamentaux dans la compréhension de nombreux épisodes de l’histoire grecque (mais aussi romaine ou même germanique comme l’explore le présent livre). Le parallèle entre l’Or du Rhin de la légende germanique et le blé des Tarquins nous a aussi surpris (et marqué). Moins surprenantes, les pages sur la Diane « hors cité », le Rex nemorensis (p. 413-413) mais aussi les trois types de feu (connus pour l’Inde mais moins facilement identifiables à Rome, p. 452-453) et le paradoxe qu’est Hermès nous ont aussi particulièrement plus.
Encore de bons moments comparatistes, où l’on peut suivre au long cours la pensée d’un grand savant.
(l’Or du Rhin, c’est une question de pouvoir, pas d’avarice …8,5)