Essai de définition de l’architecture par Yves Michaud.
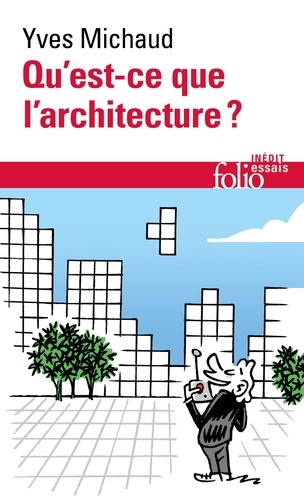
Seuls les pouvoirs de plomb peuvent garantir les significations [des monuments] à force de châtiments et de réactivations aussi constantes que rituelles […]. p. 273
Yves Michaud veut avec ce livre se distancier d’une approche stylistique ou chronologique de l’architecture, mais mettre en lumière les catégories sous lesquelles nous voyons, inconsciemment ou non, l’architecture dans son ensemble, des pavillons décuplés aux architectes stars. En premier lieu, il veut persuader le lecteur que l’architecture n’a pas commencé avec le XXe siècle et que le dernier concept à la mode peut être bien plus ancien qu’on ne l’imagine.
Douze catégories sont ainsi définies, formant autant de chapitres, auxquels viennent s’adjoindre un premier chapitre voulant définir l’objet et un ultime chapitre détaillant deux absences dans la catégorisation précédemment développée.
Le premier chapitre rappelle que l’architecture, ce n’est pas toujours un objet, et que celle-ci peut être vue de différentes façons, comme Art ou comme coût. Puis Y. Michaud passe à ce qui lie architecture et temps : le temps du projet (la fin du prescripteur unique p. 99), du programme, du chantier, celui de l’usage et de la flexibilité de celui-ci, et pour finir la dégradation, la maintenance, l’abandon et la ruine. La catégorie suivante est celle de la situation et du contexte. Ce qu’il faut entendre par ces deux termes, c’est en premier lieu l’attention que l’architecte doit porter à l’hygiène et à la solidité, c’est à dire les conséquences du lieu où l’objet est bâti. Viennent ensuite les ressources qu’il faut acheminer sur place … Il y a pour l’auteur une tendance à l’atopie, c’est à dire que pour de nombreux projets, le lieu n’importe plus (p. 58). Les catégories suivantes nous font découvrir l’utilité, la nécessité, la commodité ou encore les fonctions. L’utilité peut aussi être dérivée : les arènes de Nîmes servirent de carrière.
Le cinquième chapitre poursuit son exploration avec les différences entre projet, design et dessin (la sténographie de la pensée p. 122, mais aussi fard prévalant sur l’expérience), avant que le chapitre suivant n’élargisse le propos sur la représentation (avec sa part de séduction). Puis viennent les matériaux. Le matériau fait-il la forme ? Peut-il exister une architecture du feu ? Le tout amène le lecteur vers les questions de forme et de formalisme, puis vers le vocable d’espace/espaces. Le onzième chapitre accorde son attention à la question de l’ornement, entre disparition et réapparition. En faisant une étape du côté du symbole (monument et architecture monumentale), Y. Michaud nous transporte ensuite dans un avant dernier chapitre auprès de la beauté (et les contemporains fun et kitsch). Puis viennent les deux absents annoncés en introduction : ce sont la ville et l’écologie. Si l’architecte a de moins en moins prise sur la ville, sa mission de protéger l’Homme contre son environnement peut se doubler de l’inverse, dans les prospectives fondées sur l’évolution des demandes de matériaux (p. 342). En 1960, certains théoriciens pensaient que le plastique allait remplacer l’acier … Le volume est complété par la bibliographie, une sitographie et les notes.
Si le début du livre peut faire peur parce que le lecteur est jeté sans ménagement dans le bain froid du conceptuel, ce même lecteur peut très vite se raccrocher à la structure mise en place par Y. Michaud. Non seulement les chapitres s’enchaînent avec aisance, mais leur contenu est un bon mélange entre soubassement philosophique et exemples connus et moins connus, dans une perspective proche de la pratique. Si l’auteur ne veut pas s’embarquer dans une histoire de l’architecture, il est difficile de faire sans. Cela reste léger et permet par exemple au lecteur de prendre conscience des débuts de la standardisation dès le début du XIXe siècle (p. 98), les débuts du contrôle de gestion à la fin du XVIIIe siècle ou encore les conséquences de la découverte de la Grèce au même moment avec pour conséquence la régression de l’idéalisation (devant la grande variété enfin accessible) et une nouvelle appréciation du gothique et de sa hardiesse (p. 150-151). Ouvrage sans faiblesse ni baisse de rythme, il gratifie en outre le lecteur de pépites (la lumière des enseignes en néon comme retour de l’ornementation p. 240), l’histoire de l’architecture du XXe siècle vue comme une histoire sainte avec ses chapelles (p. 301), ses constats sur la production des starchitectes et leurs valeurs esthétiques (p. 314-316) mais aussi de savoureuses piques dont Y. Michaud a le secret, dont certaine font irruption sans prévenir (p. 220 ou p. 332-333).
Une belle grille de lecture en même temps qu’un rappel de fondamentaux.
(le fun est le beau contemporain p. 315 … 8,5)

