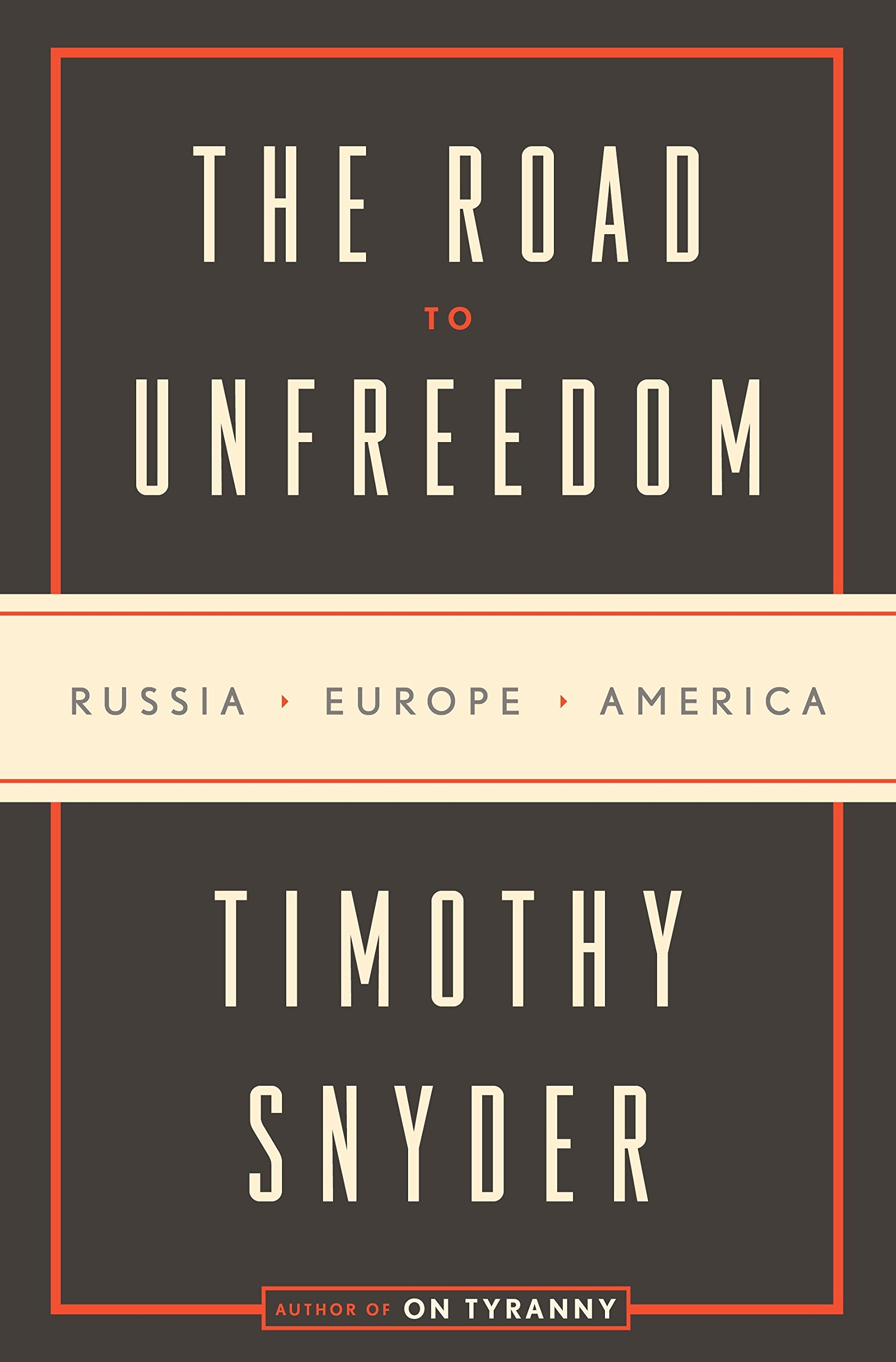Chroniques californiennes et nouvelle apocalyptique de Alain Damasio.
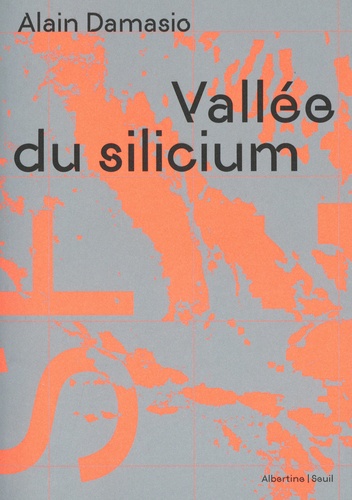
La matérialité du monde est une mélancolie désormais. p. 40
La Villa Albertine est l’équivalent étatsunien de la Casa Velazquez ou de la Villa Médicis, mais répartie dans plusieurs villes. Alain Damasio a été invité pour une résidence de deux mois à San Francisco et c’est l’occasion pour lui de visiter la ville et la Silicon Valley (d’où le titre). Il en tire, revenu chez lui, sept chroniques et une nouvelle.
La première chronique s’intéresse au siège social d’Apple à Cupertino vu comme la cathédrale d’une marque-religion, incarnation inverse des débuts de l’informatique et d’internet jusque dans le bâtiment : l’anneau « pour les gouverner tous » est fermé, tout est sous contrôle. C’est aussi pour A. Damasio la possibilité de définir ce qu’est un technococon, un futur qu’il juge plus probable que la vie purement virtuelle ou le métavers.
La seconde chronique est centrée sur les véhicules vides dans le pays de la voiture. Enfin vide … ils sont surtout automatisés. Mais d’autres, qui nourrissent de données des applications, sont conduites par de nouveaux esclaves qui travaillent à se faire remplacer, non pas dans plusieurs années mais dès 2023. Déjà présent dans ce chapitre, la question du corps continue d’être explorée dans la chronique suivante, comme par exemple ce qui lui arrive dans un aéroport … Mais aussi sur le fait d’être le bureaucrate de son quotidien (p. 83).
La quatrième chronique est une exploration du quartier de Tenderloin à San Francisco, haut-lieux de la misère et des addictions, avec ses overdoses et ses ONG. Mais il y a aussi de l’art, dont une fresque sur la thématique du voisinage utopique que s’attache à décrire l’auteur. La chronique suivante nous emmène dans le thème de la santé connectée, celle des montres ou des bagues qui analysent tout et des médicaments faits sur mesure. A. Damasio se demande de quel corps il est ici question. Peut-on écrire sur la technologie sans évoquer l’intelligence artificielle ? Certes pas, du moins pas dans la sixième chronique où l’auteur espère l’émergence non d’une intelligence artificielle mais d’une intelligence amie sur la base d’une conversation avec un programmeur-star. La septième et dernière chronique (écrite vingt mois après la résidence p. 201) veut distinguer le pouvoir de la puissance, entre cyberpunk et biopunk. Comment faire avec la technologie.
Suit une nouvelle apocalyptique, au sommet d’une tour de San Francisco, dans une futur proche fait de création biologique, de domotique assise sur la psychologie des habitants et de deadbots. Vient non pas le grand tremblement de terre mais la grande tempête, celle aux torrents vertigineux et aux impulsions électromagnétiques dévastatrices. Un condensé littéraire des chroniques précédentes en quelque sorte.
Ce n’est pas un roman ni une suite de nouvelles, mais c’est bien un livre de A. Damasio. On retrouve beaucoup des éléments des Furtifs, les références philosophiques habituelles, les jeux de mots et les néologismes (un très beau IAvhé p. 12), un ciselage typographique, mais aussi une inflexion dans la réflexion sur la technologie, moins frontale que dans ces mêmes Furtifs. Il y a une évolution, admise et avouée par l’auteur, dans sa pensée sur la technologie et sa réflexion sur cette évolution est intéressante. A. Damasio s’aventure parfois en terrain glissant (la voiture invente le trottoir ? p. 210), la féminisation des pluriels est dispensable, mais son manifeste vitaliste et la raison qu’il y a encore à écrire vaut le coup d’être lu (p. 216-222, avec tout ce qu’il y a avant bien entendu) et augure de futures belles pages, avec ou sans technococon.
(à « distance réseaunable » p. 85 … 8)