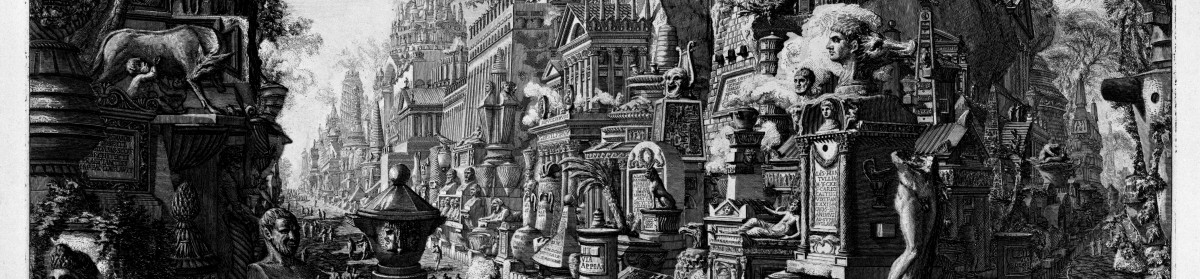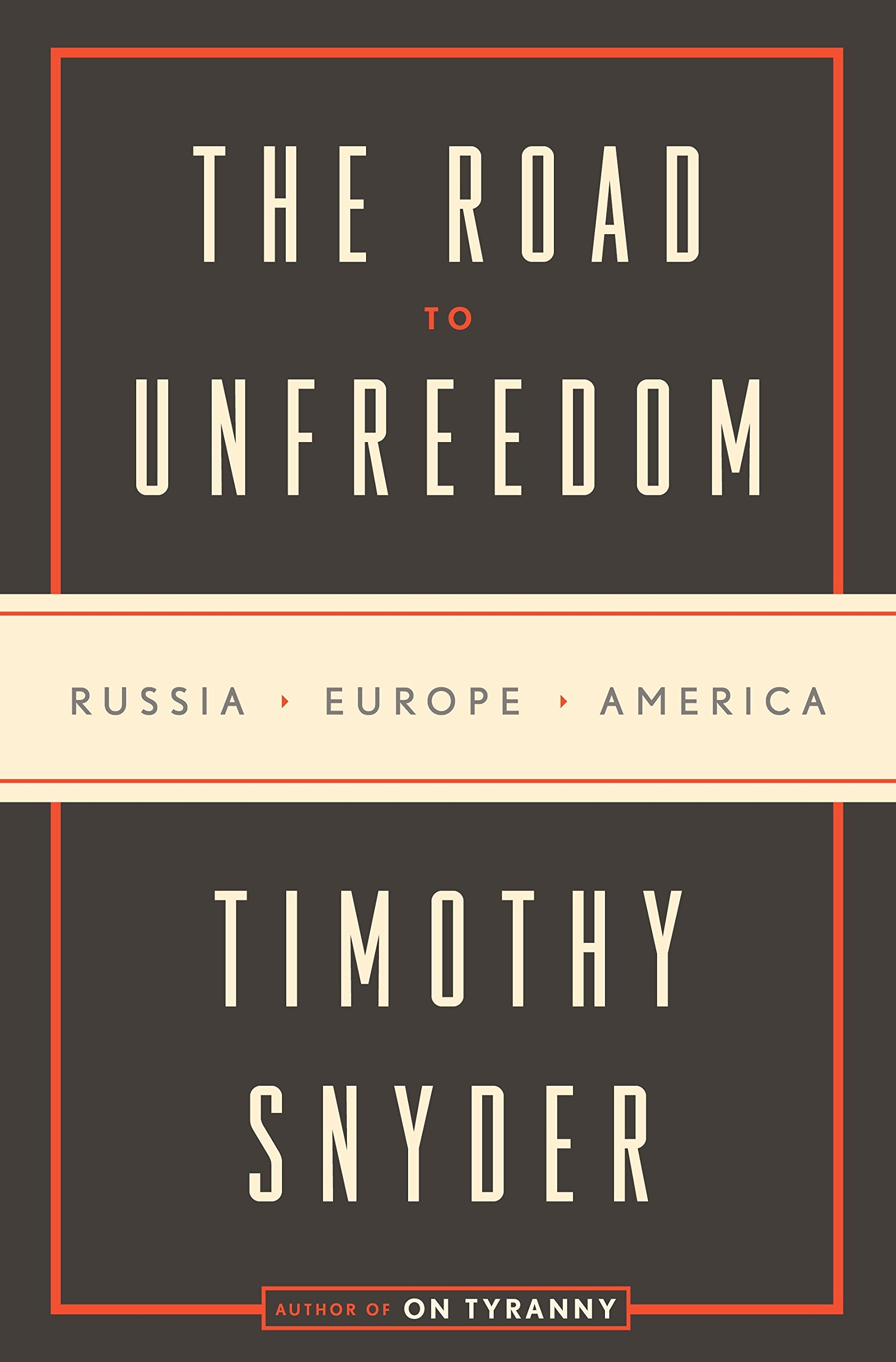Von der Wiederbeschaffung bis zur Zeitenwende
Essai historico-politique militaire de Sönke Neitzel.
Si Sönke Neitzel était déjà connu des spécialistes de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale grâce à son ouvrage magistral sur les enregistrements des généraux allemands en captivité au Royaume-Uni (en 2005), il est devenu une figure médiatique avec l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022. Titulaire de la chaire d’histoire militaire et d’histoire culturelle de la violence à l’université de Potsdam, il était le candidat naturel pour écrire le volume sur la Bundeswehr dans une collection équivalente en Allemagne à celle des Que sais-je en France.
L’ouvrage est découpé en trois parties : la naissance de la Bundeswehr en 1955 et ses évolutions durant la Guerre Froide, la période 1990-2020 et ses opérations extérieures et enfin les défis nés du conflit en Ukraine à partir de 2014 jusqu’à nos jours.
La renaissance de forces armées en Allemagne dans les années 1950 n’a rien d’une évidence. Plusieurs éléments concourent à cela cependant. En premier lieu, la fondation en en 1949 de la République fédérale d’Allemagne mais aussi celle de l’OTAN la même année. Mais plus encore que l’échec de la CED en 1954, c’est la fin du monopole atomique étatsunien en 1949 qui est décisif dans la reconstitution de forces armées ouest-allemandes. La dissuasion devant être aussi conventionnelle en plus de nucléaire, la RFA se devait de participer à sa défense en ajoutant des divisions sous commandement OTAN. La RFA était aussi fortement incitée à le faire par la conscience très claire du gouvernement de Bonn que si les forces du Pacte de Varsovie n’étaient pas mises en échec au plus près de la frontière c’est son propre territoire qui subirait le bombardement nucléaire … Une fois le principe acquis auprès des Alliés et la population ouest-allemande y étant majoritairement favorable, le gouvernement de Bonn pouvait lancer la montée en puissance vers l’objectif de 440 000 personnels dans les forces armées (très majoritairement dans la composante Terre, cible atteinte en 1965). La question de la composition du corps des officiers (c’est à dire du recyclage d’officiers de la Wehrmacht et de la SS) avait déjà été réglée très en amont et des enquêtes étaient menées pour tout recrutement à partir du grade colonel et en fin de compte il y eu moins de nazis dans la Bundeswehr qu’au BND ou dans les ministères de la Justice ou de l’Agriculture (p. 12-16). Pour se prémunir d’un retour aux tentations putschistes de la République de Weimar, l’accent est mis sur le serment prêté à la Constitution et sur l’attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, mais dans les unités certaines traditions d’avant 1945 (mais pas forcément de la période nazie) refont surface. Dans les années 1970, le ministère tente de clarifier plus avant la question, sans forcément exclure a priori certaines pratiques apparues après 1933 (p. 35-38). Certaines traditions sont alors interdites, notamment chez les parachutistes très influencés par les combats d’Indochine et d’Algérie.
S. Neitzel détaille aussi les problèmes d’attractivité de la Bundeswehr dans les années 1970-80 (la création d’universités en 1973 et de cursus diplômants ont pour but d’y remédier en préparant la reconversion), les réformes, un pacifisme finalement limité (« la conscription oui, mais pour les autres » voisinant la quête de sens de ceux devant défendre des concitoyens qui ne veulent pas l’être). Au mitan des années 1970, les forces armées ouest-allemandes comptent 1,2 millions de personnels avec les réserves, dans un état de préparation jugé satisfaisant par l’OTAN, du moins capable d’absorber le premier choc du Pacte. En 1985, le but politique d’une Bundeswehr au zénith de sa capacité de combat, c’est à dire sa crédibilité, est considéré comme atteint par l’auteur (p. 46).
La réunification allemande et la fin du Bloc de l’Est place la Bundeswehr devant deux défis majeurs. Le premier est l’absorption de la NVA, l’armée est-allemande. Ceci est fait assez rapidement, en ne conservant que très peu de matériel, assez peu de personnel, mais en créant des unités dans l’est du pays, qui comme ailleurs, seront à recrutement local. Le second défi est la raison de l’existence de la Bundeswehr, dont la taille est réduite à 250 000 personnels en 2005. Il y a participation aux missions de l’OTAN (dites « hors de la zone ») mais pour S. Neitzel c’est plus pour « être avec mais sans rien faire » (p. 53). Le but du politique est surtout que rien en se passe, que ce soit en Somalie, dans le déminage du Golfe persique, ou en Yougoslavie (sous casque bleu ou au Kosovo). Le premier usage d’armes par des soldats allemands depuis 1945 a lieu quand des Tornados utilisèrent des missiles pour neutraliser des radars serbes en 1995, sans que cela soit rendu public. En fin de compte, la Bundeswehr se retrouve elle aussi avec le paradoxe de devoir faire plus (projetée) avec de moins en moins de moyens, humains et budgétaires, sans pouvoir planifier les engagements (le contrat OTAN ne peut plus être rempli en 2001, p. 66). Puis vint l’Afghanistan …
L’Allemagne participe à l’opération OTAN Enduring Freedom à hauteur de 3900 personnels à partir de novembre 2001 et à l’ISAF sous mandat de l’ONU à partir de décembre de la même année (1200 soldats pour six mois à l’origine). En 2006 les premiers engins blindés sont envoyés en Afghanistan, mais leur usage n’est autorisé qu’en 2009. La même année a lieu le premier mort au combat d’une armée allemande depuis 1945, un soldat d’origine russe dont le père avait déjà combattu sur place sous uniforme soviétique … Les rêves d’une opération de strict mentoring s’évaporent avec le scandale du bombardement des camions citernes (toujours en 2009). Les critiques s’accumulent, y compris au plus haut niveau politique et militaire allemand, alors que le contingent culmine à 5300 soldats engagés et que les pertes atteignent 35 morts au combat. Aucun membre du gouvernement n’est présent à la cérémonie de fin de mission fin juin 2021 … S. Neitzel est également critique de la mission au Mali en 2013, avec selon lui pas plus de réflexion stratégique qu’en 2001 (« mais si pas contre Daesh, contre qui alors » regrette la troupe p. 100) . Mais l’auteur réserve ses feux pour la politique militaire allemande en direction de l’Ukraine en 2014, mais plus encore en 2022. Le « changement d’époque » (Zeitenwende) décrété en 2022 est passé au crible et l’auteur apprécie peu les changements de pied incessants du gouvernement fédéral, sans parler des délais de mise en œuvre. Les problèmes de disponibilité du matériel, de recrutement, de réappropriation de capacités et de dronisation persistent. Sur une note amère, l’auteur rappelle que la lenteur se paie in fine avec du sang.
Le propos bien équilibré, entre histoire, sociologie militaire et critique à grand spectre qui se veut constructive. L’accent est spécialement mis sur la culture militaire et ses difficultés, dans une armée sans combat jusqu’en 2001 et sans décoration reconnue, pour intégrer et faire vivre un esprit de corps. Pour l’auteur, la plupart des ministres et des inspecteurs généraux qui se succèdent manquent de courage (un simple carnet de chant est évalué sans décision trois ans durant) pour dire la réalité ou veulent pratiquer des exorcismes. S. Neitzel mentionne pour ce point explicitement la ministre U. van der Leyen à Illkirch-Graffenstaden (près de Strasbourg) en 2016, après la découverte dans une salle du 291e Jägerbataillon d’une fresque représentant un soldat de la Wehrmacht (à l’occasion de l’arrestation du lieutenant Franco Albrecht qui projetait un attentat sous fausse bannière). Le Livre Blanc de 2016 ne trouve pas plus grâce à ses yeux : se payant de mots, sans solutions aux problèmes et ne contenant qu’une seule fois le mot « combat ». L’exaspération, que justifie amplement l’auteur, est palpable dans la fin d’un volume qui attend du lecteur une bonne maîtrise de la langue allemande en échange d’un niveau de connaissances préalables relativement faible.
(le KSK n’a jamais libéré d’otages, censé être son cœur de métier p. 96 … 8,5)