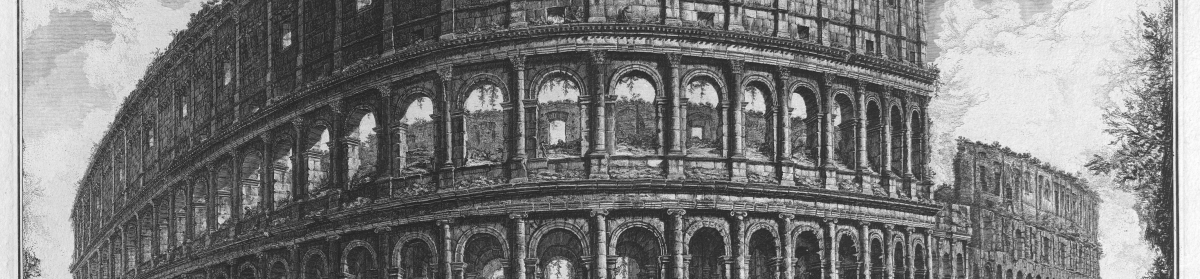Essai d’histoire des religions de Gershom Sholem.
Publié en français sous le titre Les grands courants de la mystique juive.

Nous avons pu rencontrer la mystique chrétienne et rhénane dans ces lignes en s’intéressant à ses productions, tout comme a pu avoir un aperçu du rationalisme juif médiéval en se rapprochant de la pensée de Maïmonide. De même, le mouvement charismatique juif (dit ultra-orthodoxe) nous avait été décrit d’un point de vue ethnographique. Il manquait donc encore à notre tableau, entre autres, la mystique juive affrontée depuis son versant intellectuel. Malgré son âge certain (première parution en 1941), ce livre est resté une référence dans l’étude de la mystique juive et de ses différentes formes. Il répond à ce vide particulier dans notre tableau.
Le livre reproduit neuf leçons, données en 1938 à New-York. Toutes ont été complétées a posteriori, sauf la dernière. Pour faciliter la lecture, les notes, très nombreuses, ont été rassemblées en fin de volume. Une fois passé les différentes préfaces, de ces neuf leçons, on peut faire ressortir sept parties.
La première de ces parties est une introduction générale, décrivant le but de ces leçons et débutant comme de bien entendu avec une définition du mysticisme, à savoir un pont au-dessus de l’abîme créé par la religion à la sortie de la religion primitive où tout était uni (p. 8), où comme Thomas d’Aquin le dit, la connaissance de Dieu au travers de l’expérience (p. 4). L’auteur passe ensuite à d’autres généralités sur le mysticisme juif sur les Sefirots (les dix sphères créatrices de Dieu), la Torah, l’usage de la langue chez les Cabalistes (pas née en réponse à la philosophie mais s’appuyant même sur elle pour aller vers une autre direction p. 24), le problème des sources (puisque les mystiques juifs sont peu portés sur l’autobiographie, sauf exceptions p. 16), sur la métaphorisation et la symbolique, sur le retour du mythe dans le judaïsme (p. 22) et enfin sur l’absence d’élément féminin dans le mysticisme juif (au contraire de son équivalent chrétien ou musulman, p. 37-38). On ne peut pas cacher que cette introduction démarre sur les chapeaux de roues et qu’il faut bien s’accrocher dès le début, au risque de ne pas tout comprendre par la suite. Il faut saisir cette différence entre le l’abstraction philosophique et le symbolisme mystique qui regardent différemment la même Loi … Mais l’auteur ne cache pas non plus les dangers dans lesquels et le mysticisme et la philosophie peuvent tomber (p. 36-37).
La seconde leçon entame la progression chronologique avec le mysticisme dit du Char (Maaseh Merkabah), dont l’efflorescence a lieu entre le Ve et le VIe siècle. Il se base sur la vision du char céleste qu’a eu Ezéchiel mais aussi sur les visions personnelles des mystiques (et qui peuvent être antinomiques avec la vision du prophète, p. 45-46). Sur les auteurs de ces textes et visions, la science semble avoir quelques problèmes à y attribuer des auteurs qui ne soient pas fictifs ou anachroniques. Ces auteurs par contre ne sont pas isolés, ils appartiennent à des écoles, à des groupes de mystiques qui ont pour caractéristiques communes d’avoir peur d’être accusés d’hérésies (pourtant certains de leurs hymnes sont intégrés dans la prière communautaires p. 60) et d’user de chiromancie et de physionomie (p. 47-48). Ces deux techniques divinatoires, tout comme les pythagoriciens du IVe siècle, sont utilisées pour définir les critères d’adhésion du novice. Ce n’est d’ailleurs pas la seule chose que les pythagoriciens ont en commun avec les mystiques du Merkabah, puisque ces derniers judaïsent l’idée déjà ancienne des sept degrés du Paradis (p. 53-54). De manière assez étonnante, et sans doute au grand dam de Maïmonide, ces mystiques ne semblent pas trop réticents devant l’anthropomorphisation de Dieu, celle d’un Dieu/roi assez différent du Dieu/esprit des rabbins (p. 63).
La troisième leçon quitte les rives de la Méditerranée pour les sombres forêts de la Germanie et y trouver le Hassidisme médiéval (qui n’a rien à voir avec celui, est-européen, du XVIIIe siècle). Celui-ci prend place entre 1150 et 1250. Le texte central de ce mouvement est le Sefer Hasidim, écrit par Juda de Ratisbonne, qui montre des connexions avec la pensée chrétienne et plus particulièrement la réforme clunisienne (p. 81). On trouve ces dévots dans tous les grands centres du judaïsme germanique et ils se démarquent par leur radicalité, leur insensibilité au blâme et à la louange (l’ataraxie aussi prisée des saints chrétiens de la période, p. 97). D’une certaine manière, ces mystiques ne sont pas inconnus du grand public puisque l’histoire du golem leur est lié, mais l’importance de l’extase n’est pas passée dans la culture populaire. L’aspect magique est d’une très grande importance (maîtrise des éléments), faisant pièce à la figure du « faible piétiste » (p. 99). Ces mystiques allemands usent de diverses techniques de combinaisons de lettres et de chiffres, basées sur des textes liturgiques, même si le lecteur éprouve du mal à saisir le but de ces jeux combinatoires. Ces techniques (appelées Gematria, Notarikon et Temurah, p. 100) sont en fait minoritaires dans le Cabalisme auxquelles elles sont attribuées. G. Sholem compare le Hassid du Moyen-Age à ceux de l’époque moderne et aux mystiques du Char (p. 101 et 118).
La quatrième partie est constituée des trois chapitres décrivant la Cabale, qui prend son essor vers 1200 pour connaître son apogée à la fin du XIIIe siècle. Ce courant ne rejette pas la tradition mais accorde une grande place à l’inspiration, et par conséquent, s’adresse à une élite (sans pour autant toujours réussir à y rester confiné p. 125). La première variante étudiée par G. Sholem est celle d’Abraham Aboulafia qui décrit comment se préparer à la méditation et à l’extase et qui souhaite séparer la magie de l’utilisation des noms de Dieu (p. 145). L’auteur décrit par ailleurs la théorie prophétique de ce dernier comme un mélange entre Maïmonide et le yoga (p. 135).
La seconde variante est celle du Zohar, que G. Sholem développe en deux chapitres. Le premier de ces chapitres, très impressionnant, est consacré au livre lui-même ainsi qu’à son auteur et le second chapitre explore la théorie théosophique du Zohar.
En ce qui concerne le livre, pour l’auteur, il n’y a plus de débat sur l’auteur du Zohar : c’est Moïse de Léon (un espagnol donc, comme beaucoup des premiers cabalistes), qui n’a jamais avoué avoir été l’auteur de ce livre écrit en araméen et qui le cite dans d’autres de ses écrits (p. 201). Pour G. Sholem, le Zohar est l’antithèse d’Aboulafia et élabore une théosophie juive (un terme que G. Sholem définit, et cela n’a rien à voir avec une pseudo-religion p. 205-206). Pour ce qui est de cette même théosophie, elle s’appuie sur une lecture mystique de la Torah (p. 209), ce qui fait tu Zohar le premier livre juif intégrant l’idée chrétienne qu’il y a quatre modes d’interprétation d’un texte sacré (littéral, homilétique, allégorique et mystique, p. 210). De leurs lectures, les Cabalistes déduisent qu’Adam est responsable d’une fissure entre la vie et l’action et que ce monde cassé n’est réparable que par la dévotion à Dieu (p. 232-233). L’accent est aussi mis sur la pauvreté, là encore une première dans le judaïsme rabbinique (p. 234), ainsi que sur l’élaboration d’une théorie du Mal (p. 235) et d’une théorie de l’âme (p. 239).
Mais l’expulsion d’Espagne, vécu comme un traumatisme égal à la destruction du Temple pour beaucoup de contemporains, va rebattre les cartes et avoir une influence considérable dans la mystique de l’époque moderne qui avec les théories d’Isaac Luria est le sujet du septième chapitre (p. 245). On retrouve avec ces mystiques le phénomène concentration, cette fois-ci dans la ville galiléenne de Safed, mais les idées développées par Luria, Moïse Cordovero et leurs disciples et successeurs ne se diffusent plus uniquement dans un petit cercle d’érudits mais atteignent un grand groupe de croyants à partir de 1550 (p. 284-286). Le point focal d’intérêt passe des origines du monde (les mystiques précédents) à la rédemption (mais passant par les origines, puisqu’ils développent l’idée du Tsimtsum, ce retrait de Dieu permettant l’existence du monde p. 260). Ainsi pour I. Luria, l’objectif de l’Homme est de réunifier le Nom de Dieu et de restaurer l’harmonie originelle (p. 275), avec participation de l’âme à un cycle de réincarnation (ou transmigration) faisant partie de ce processus de restauration dont la croyance se répand parmi les mystiques après l’Exil (p. 281-284).
Les idées cabalistes qui se sont insinuées dans toutes les communautés juives autour du monde et plus particulièrement dans l’empire ottoman pavent le chemin au sabbatianisme, cette hérésie mystique (mais aussi révolte juive) conduite par celui qui se voulait le Messie, Sabbataï Tsevi, et son prophète, Nathan de Gaza (le huitième chapitre). Ce dernier n’est pas que le prophète annonçant le Messie mais aussi l’interprète de l’apostasie de ce dernier (S. Tsevi, après d’être déclaré comme Messie, se convertit à l’Islam à Constantinople en 1666). Le sabbatianisme ne se limite pas pour autant à l’empire ottoman mais atteint jusqu’au nord de l’Europe (Prague, Offenbach) et il est particulièrement soutenu par les Marranes, qui eurent aussi l’expérience de l’Apostasie (p. 303 et p. 309). G. Sholem insiste aussi sur la difficulté qu’il y a eu jusqu’au XIXe siècle à étudier le sabbatianisme (à cause de ses paradoxes, p. 316, mais aussi par peur de l’hérésie, p. 299-300) et à comprendre cette révolte. Il met aussi en relation le sabbatianisme et le réformisme juif du XIXe siècle, le comparant à l’influence des Quakers et des Anabaptistes dans le christianisme (p. 301) et note le lien entre le Frankisme, son épigone allemand, et la Révolution française de 1789 (p. 320).
Le dernier chapitre est celui portant sur les seconds Hassidim. Pour l’auteur, c’est la troisième étape d’un même processus commencé avec le lurianisme et le sabbatianisme (p. 327) et qui est pour G. Sholem l’une des quatre options possibles après la chute du sabbatianisme (p. 328-329) avec lequel il y a une filiation qui se voit dans son rapport aux actes considérés comme scandaleux par les orthodoxes (antinomianisme, p. 334, comme par exemple avec des prières charismatiques). G. Sholem est très rapide dans ce chapitre où tout est un peu trop uniforme (mais l’auteur en est conscient et l’avoue dans la préface). Cette leçon est plus personnelle dans le ton et un peu moins construite (p. 337 par exemple). L’auteur dégage cependant quatre caractéristiques qu’il voit dans le mouvement (p. 343-344) : l’enthousiasme, des illuminés (zaddikim) au centre de chaque communauté, une idéologie dérivée du cabalisme mais populaire et imprécis dans sa terminologie et une appropriation individuelle de valeurs générales devenant ainsi éthiques.
On ressort avec éblouissement de la lecture. Si le sommet est le chapitre qui analyse le Zohar et son auteur, le reste du livre est à peine moins aérien du point de vue de l’érudition. Il y a une telle masse de lectures derrière ce livre ! Et l’auteur ne s’est pas contenté des ouvrages de mystiques juifs ou chrétiens, mais n’a pas laissé ni la philosophie ni le monde gréco-romain de côté. La lecture nécessite bien évidemment une grosse dose de concentration, mais son montant est amoindri par une écriture directe et claire, si tant est que le lecteur n’ait pas besoin de chercher la signification de trop de mots spécifiques au champ étudié.
Certaines idées sur l’aspect monolithique de la religion juive (celle de la période rabbinique) peuvent aussi être battues en brèche, tout comme certaines conceptions que l’on a pu avoir sur le sabbatianisme, au rayonnement plus large et plus puissant si l’on suit G. Sholem, européen comme ottoman, populaire plus que limité à certains cercles apocalypticistes.
G. Sholem n’hésite pas devant la controverse avec ses devanciers, anciens comme contemporains (sur le Zohar par exemple p. 199). Il n’est pas tendre avec les savants du XIXe siècle, à deux doigts du règlement de compte même (p. 66-67). Mais s’il relève les erreurs, il a aussi l’honnêteté de remarquer leurs succès (p. 203).
Il reste en toute fin de livre, à la toute dernière page, une allusion à l’actualité du moment (1941). L’auteur avait pleine connaissance de la répression en Europe, mais ne pouvait sans doute pas connaître son étendue. Cette dernière phrase porte une lumière crue sur un texte qui parle plus de circulation des idées entre de très nombreux groupes parfois éloignés de plusieurs milliers de kilomètres que de cloisonnement en ensembles hermétiques.
(cette petite histoire hassidique sur la puissance des mots p. 349 forme une belle conclusion … 8,5)