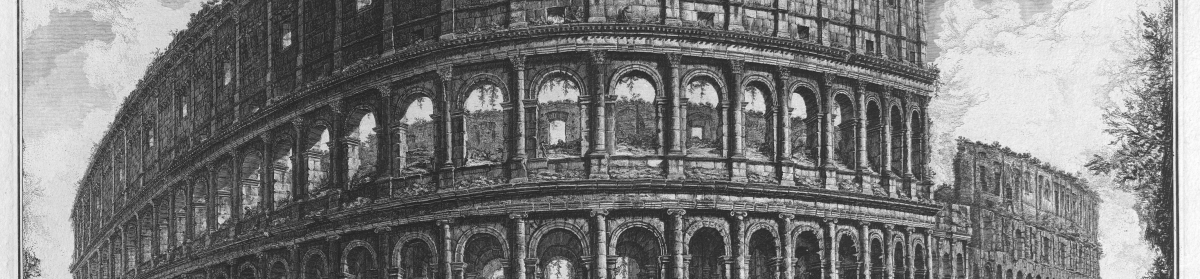Ouvrage de vulgarisation scientifique de Lucy Shipley.

Ce livre réussit un tour de force : il allie vulgarisation et actualité de la recherche. Paru en 2017, ce livre intègre des découvertes faites jusqu’au mitan des années 2010, sans pour autant perdre de vue qu’il s’adresse à un public néophyte (mais déjà intéressé par l’Antiquité, comme il semble décrit p. 49). La série à laquelle appartient ce livre s’est donnée pour objectif non seulement de décrire le parcours, l’émergence, l’efflorescence et la fin de grandes civilisations et de peuples de l’Antiquité, mais aussi de savoir ce qu’il nous en reste dans notre monde actuel. Et c’est que le bât peut amener à blesser …
L’introduction explicite tout d’abord ce qu’il faut entendre par civilisations perdues. Au XIXe siècle, les choses sont claires : des explorateurs ou des savants qui font le constat que les habitants d’un territoire ne sont pas dignes de leurs ancêtres, voire qu’ils n’ont rien en commun (p. 13). L’erreur inverse, c’est de considérer que ces personnes nous sont identiques. Et ces deux mythes nous ont été transmis, avec parfois une origine dès l’Antiquité. L. Shipley, une fois ces bases posées, peut passer à la question suivante : pourquoi les Etrusques nous importent ?
La réponse à cette question se trouve dans le premier chapitre, qui comme chaque chapitre de ce livre, est dominé par un artefact archéologique. Dans ce premier chapitre, c’est le Sarcophage des Epoux du Musée du Louvres. Il permet à l’auteur d’aborder les questions de l’archéologie, de la périodisation de l’archéologie étrusque (et les problèmes que cela emporte), les limites techniques (la datation au carbone 14 et sa marge d’erreur p. 22-23). Le lecteur peut à ce moment remarquer quelques traits assez britanniques dans le texte, entre un humour qui rend le propos encore plus plaisant et une attention très marquée pour le paysage, dans la lignée de J.B. Ward Perkins. Et le paysage qu’a connu le couple du sarcophage, dominé par la forêt, c’est ce qui permet à l’auteur de glisser vers la description du territoire étrusque et de parler des sources de la richesse étrusque : l’agriculture productrice de surplus et la métallurgie, elle aussi exportée à grandes distances.
Le second chapitre reste dans le domaine funéraire, se concentrant d’abord sur la crémation à partir d’une urne-cabane de Tarquinia. De cette cabane, la question de la maison et donc des origines découlent (et c’est amené d’une manière très différente des autres ouvrages du même genre). Les différentes théories sur l’origine des Etrusques, dont certaines étaient déjà débattues dans l’Antiquité, sont évoquées : l’origine anatolienne, l’origine alpine ou l’autochtonie italienne. L’auteur discute avec très grand intérêt des analyses ADN des dernières décennies (p. 41-45), celles concernant les Hommes comme celles étudiant des bovidés d’une race locale. Les résultats de ces études ainsi que la reprise des premières études peuvent avoir fait avancer un peu les choses … Mais ce chapitre n’est pas que celui des vieilles questions te des mythes originels, c’est aussi celui du passage de la civilisation villanovienne à la culture étrusque urbaine au VIIIe siècle avant J.-C., avec des phénomènes de synœcismes (rassemblement de villages pour former une ville) donnant naissance aux cités et une rarification des établissements aristocratiques autonomes. Avec l’essor des cités se développent aussi les contacts dans tout l’espace méditerranéen, avec un attrait particulier pour l’art oriental (ce que les spécialistes appellent la période orientalisante, au VIIe-VIe siècle). La fin du chapitre, dans sa volonté de faire des rapprochements entre migrations antiques et réfugiés du XXIe siècle, se fourvoie complètement, entre erreurs factuelles et propos au minimum aventureux (p. 45). Qu’a à voir la situation de l’Europe au néolithique avec le XXIe siècle ?
Quittant Tarquinia, L. Shipley nous emmène vers le Nord, à Vulci, pour détailler le mobilier très composite de la Tombe d’Isis. Des artefacts de Syrie, d’Anatolie et d’Egypte sont la preuve du réseau dans lequel les occupants de la tombe se mouvaient à la fin du VIIe siècle. L’auteur s’aventure dans l’époque napoléonienne (Lucien Bonaparte a fait faire beaucoup de travaux archéologiques en Italie centrale) dans le cadre de ses interrogations sur l’exotisme. Déjà sur le XIXe siècle, tout n’est pas au point : L. Bonaparte n’a pas épousé une ancienne reine d’Etrurie (p. 54). De plus, comparer des princes étrusques (dont l’auteur surinterprète l’usage du terme dans un sens littéraliste qu’il n’a jamais eu) aux maharadjas n’a aucun sens. Mais quand on glisse de la Tombe d’Isis à l’EI (ISIS en anglais), c’est le fin du fin …
Le quatrième chapitre nous conduit toujours plus au Nord, cette fois-ci vers la cité de Chiusi et son kylix (coupe à boire) athénien. Les vases étrusques furent très en vogue, au point de déclencher une étruscomanie au XVIIIe siècle. Mais vînt J. Winckelmann, dont les travaux démontrèrent l’origine grecque de ce que l’on pensait des œuvres étrusques. Les Etrusques, pales imitateurs, barbares ou même voleurs, étaient forcément inférieurs aux Grecs ou aux Romains aux yeux de J. Winckelmann. Leur place dans les sciences de l’Antiquité (p. 70) s’en ressent encore aujourd’hui … L. Shipley développe ensuite quelques idées sur le commerce gréco-étrusque, dont le fait que les potiers et peintres athéniens produisent spécifiquement pour le marché étrusque, et que cela influence aussi leur production destinée aux Athéniens. Différentes interprétations peuvent ainsi être passés en revue.
Le chapitre suivant est centré sur l’un des sites iconiques de l’étruscologie, la résidence aristocratique de Poggio Civitate. L. Shipley détaille les différentes phases du site (où elle a travaillé p. 90), sa décoration et ses différentes fonctions. La présence de chevaux est attestée, mais jusqu’en 2012, on n’avait nulle trace des habitations des ouvriers et du personnel du complexe (p. 88). Le sixième chapitre explore un thème classique, lui aussi visiblement discuté dès l’Antiquité : la femme étrusque. Il y est question d’une tombe découverte à Tarquinia en 2013, celle dite de l’Aryballe suspendue, contenant les reste d’une femme munie d’attributs guerrier. A partir de cette découverte, exceptionnelle, l’auteur élargit son propos à la place de la femme dans la société étrusque, dans les couches les plus favorisées (p. 99) mais aussi dans des strates sociales plus basses. Une comparaison avec la vision romaine est faite p. 102, où dans le récit de la fin des rois étrusques de Rome voit opposée à la femme étrusque qui banquette la pieuse vertu de Lucrèce la romaine, filant sa laine (la figure de Tanaquil, épouse de Tarquin l’Ancien, est curieusement épargnée, p. 103). La tradition littéraire européenne s’est emparée des figures de Tanaquil et de sa petite-fille Tullia, mais surtout pour y inscrire un personnage intrigant et à la morale relâchée. La fin du chapitre, échafaudant un parallèle entre femme étrusque et publication de photos intimes sur internet. Dire que dans l’introduction on parle des péchés d’anachronismes du XIXe siècle …
Le principal problème de l’étruscologie jusqu’à récemment fut sa grande dépendance aux contextes funéraires (septième chapitre). Mais là encore, dans les dernières décennies, le paysage a beaucoup changé. Si beaucoup des villes étrusques ne sont pas accessibles aux recherches archéologiques parce que leurs sites sont toujours des sites urbains (qui souhaite détruire la Pérouse de la Renaissance ?), la ville de Marzabotto (dénommée Kainua en étrusque, p. 110, une découverte qui a à peine trois ans !), entre Florence et Bologne, peut être étudiée plus à loisir. De plan hippodaméen (mais plus ancienne qu’Hippodamos de Milet), c’est une colonie au même titre que Spina sur la côte adriatique. En plus des maisons rectangulaires regroupées par îlots, la ville a bien sûr des espaces sacrés et d’assemblée (p. 113). L. Shipley discute l’appartenance de Marzabotto à la catégorie « ville » selon les critères romains et grecs, avant d’évoquer de manière succincte les différentes magistratures étrusques. Le chapitre s’achève, presque inutilement, sur le récit du massacre e Marzabotto, qui vit périr 770 personnes de tous âges en 1944 (p. 121).
Le huitième chapitre de ce livre nous voit quitter les montagnes du Nord pour revenir en Etrurie intérieure, auprès des falaises de tuf de cité d’Orvieto. Dans la nécropole de la Cannicella à la sortie de la ville, a été retrouvée une statue de marbre blanc haute d’un mètre représentant une femme nue (produite vraisemblablement à la fin du Vie siècle, bien antérieurement à l’Aphrodite de Cnide, le premier exemple grec, datée de 350-340 avant notre ère). C’est l’occasion pour L. Shipley de revenir sur l’image de liberté sexuelle associée dès l’Antiquité aux Etrusques (mais en étant imprécise sur les utilisations variées du terme de Vénus …). Cette sensualité étrusque, pas mise en rapport avec les représentations contemporaines grecques ou romaines (p. 124), a beaucoup inspiré l’auteur D. H. Lawrence, qui prend le contrepied d’un Théopompe très rigoriste. Ce chapitre court renseigne bien sur les interprétations possibles que l’on peut avoir de la statue de la Vénus de Cannicella (qui en elle-même est un artefact de tout premier ordre sur de nombreux plans), mais les explications tripartites de la fin du chapitre (et Dieu sait à quel point nous estimons G. Dumézil) sont loin d’être convaincantes (p. 158 et p. 174).
Le chapitre suivant s’attaque au mystère suivant, celui de l’écriture. Il a fait couler beaucoup d’encre depuis plus d’un siècle et est un passage obligé de n’importe quel ouvrage de vulgarisation. L’auteur brosse à grand traits le paysage : il reste très peu de textes étrusques (p. 139), principalement parce que les supports d’écriture étaient périssables. Le second problème est que le langage, s’il est lisible (l’alphabet est d’origine grecque), est difficilement compréhensible. De nombreux rapprochements ont été tentés (la langue étrusque n’est pas partie du groupe indo-européen), avec presque toutes les langues connues sans doute, mais pour l’instant rien n’a été concluant (même si, pour le louvite, on pourrait avoir une parenté). La méthode combinatoire semble donner plus de résultats, mais a l’inconvénient de la lenteur (p.145). L. Shipley présente ensuite l’un des textes étrusques les plus célèbres : les tablettes en or de Pyrgi, une bilingue étrusco-punique à la gloire du rénovateur du sanctuaire portuaire de la cité de Caere. Et si c’est affiché de manière aussi voyante, c’est qu’il y a des gens pour le lire (p. 148), en grand nombre.
Le neuvième chapitre en parle, mais ce n’est que dans le dixième que l’on propose au lecteur une présentation de la spécialité étrusque qui a survécu jusque dans l’âge paléochrétien : la divination. Cette dernière aurait été révélée aux Etrusques par le prophète Tagès, le vieux jeune homme (p. 155). L’auteur fait la description de plusieurs rites, reparle des rituels tripartites déjà évoqués plus haut, de quelques sanctuaires et de divinités étrusques, mais il manque beaucoup d’aspects de la thématique. Le tournant du IVe siècle est mentionné, mais sans aller vers l’explication (p.162), sans envisager un éventuel polycentrisme dans la relation entre la déesse étrusque Uni et la déesse phénicienne Astarté (p. 161). Les soi-disantes réminiscences étrusques dans la peinture médiévale n’arrivent pas à convaincre (p. 164 et p. 175).
Le dernier chapitre, enfin, traite de la Fin. Pour un peuple qui a tant investi dans l’apparat funéraire, c’est évidemment un thème central. L’auteur ne développe pas outre mesure les différentes conceptions de l’au-delà repérable dans la production artistique étrusque mais se concentre sur les démons (Charun, Vanth) et prend pour artefact central dans ce chapitre la tombe dite du Chariot infernal de Sarteano (découverte en 2003). L’interprétation est pessimiste, presque victimiste, et on n’est pas obligé d’adhérer à tout ce qu’écrit l’auteur (surtout pour l’intégration des croyances étrusques à Rome p. 163 ou sur Charun p. 174). L. Shipley poursuit avec l’utilisation des Etrusques dans le cinéma horrifique, pour finir dans une brève conclusion sur un ton élégiaque et plein d’espoir. Le volume est complété par de nombreuses pages de notes, par une bibliographie indicative et un court index.
Le lecteur, avec cette lecture du plus grand intérêt, accomplit avec l’aide de l’auteur un triple voyage : géographique, temporel, épistémologique. L’écriture est claire, alerte, dans des chapitres admirablement construits. Si nous avons été critiques avec la volonté de faire des parallèles avec le XXIe siècle (mais c’est dans le cahier des charges de la collection), tout non plus n’est pas à négliger de ce côté-là. Le chapitre sur l’écriture est l’un des meilleurs, dans un livre pourtant d’une très haute tenue. On peut regretter quelques erreurs, attribuable à l’inattention comme la mauvaise localisation du sarcophage de Seianti Hanunia Tlesnasa (à Florence et pas à Londres p. 178), ou à la volonté, forcée, en fin de chapitre de faire des parallèles (Jésus de Nazareth qualifié de prophète p. 163 pour en faire un pendant à Tagès). Pour la datation de mythes grâce à des drainages (p. 156), là nous n’avons pas d’explications plausibles … Un très grand soin a été apporté aux notes, qui ne contiennent pas que des références bibliographiques, mais sont un véritable plus pour le lecteur curieux. Il y a de nombreuses illustrations couleurs dans le texte.
De petits défauts mais rien qui puisse atteindre la très haute qualité générale de ce livre qui réussit à allier acquis de la recherche et nouveautés importantes, sérieux et humour, clarté et enthousiasme communicatif mais aussi hauteur de vue et approches originales.
(la dernière entrée de la chronologie qui ouvre ce livre mentionne V. Raggi comme la première femme à régner, dans un style certes différent, sur Rome depuis Tullia … 8,5)