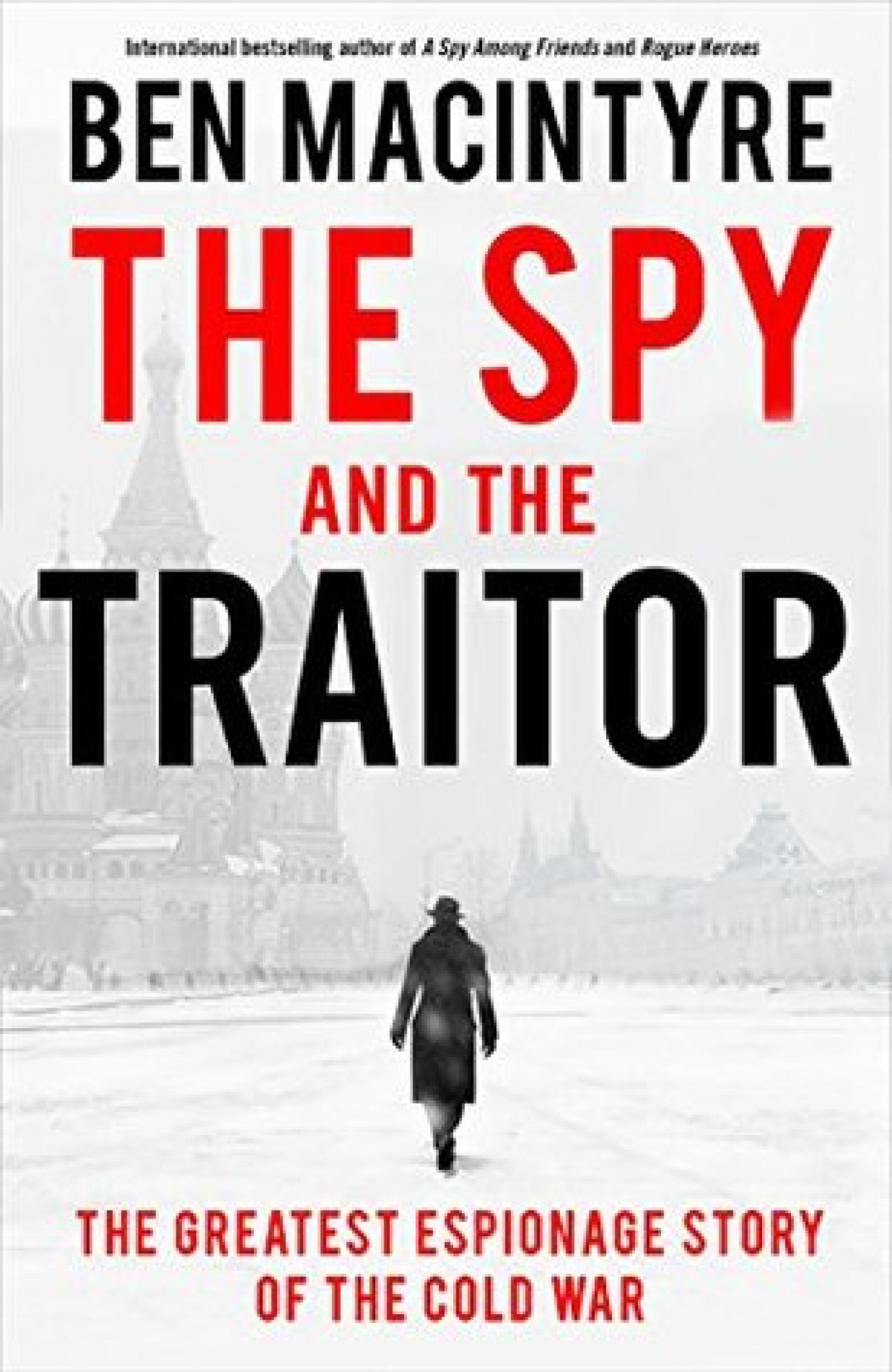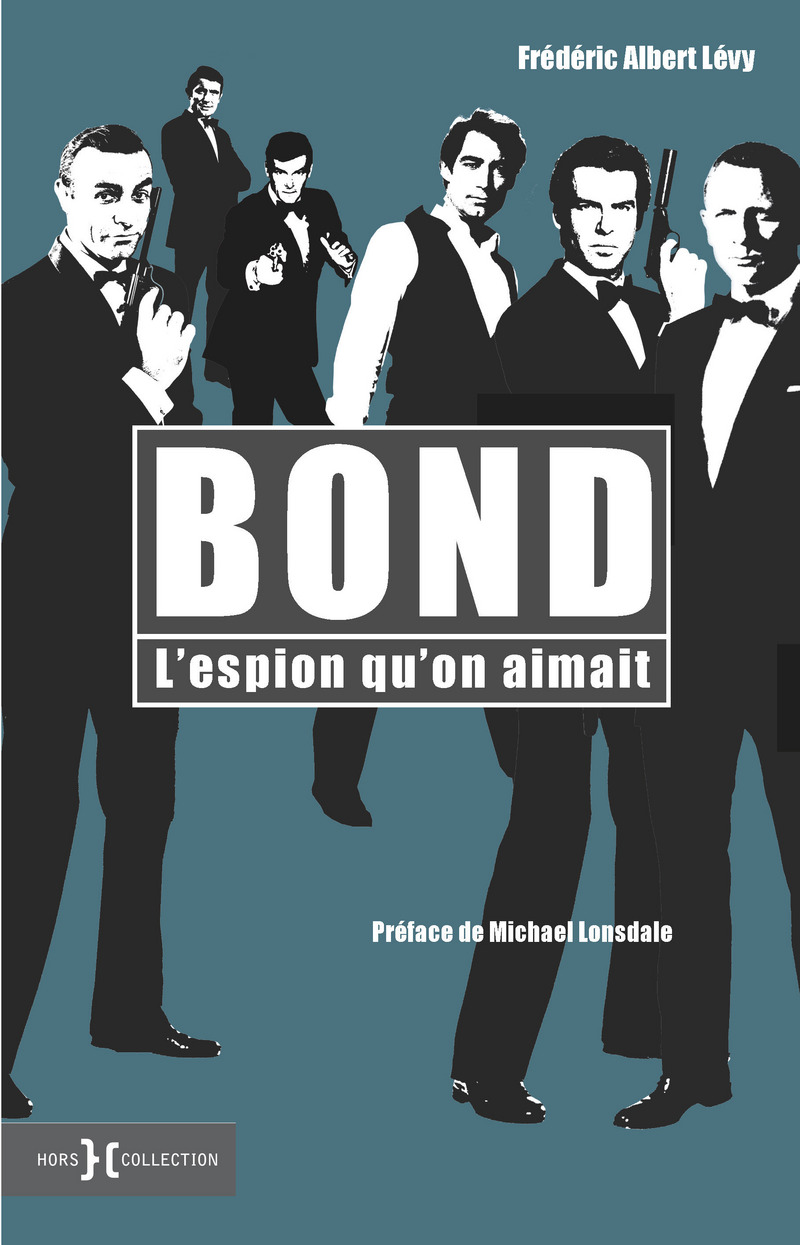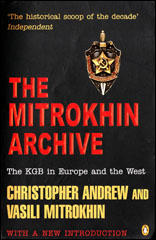The KGB and the World
Essai historique de Vassili Mitrokhine et Christopher Andrew.
Existe en français sous le titre Le KGB à l’assaut du tiers-monde : agression-corruption-subversion, 1945-1991
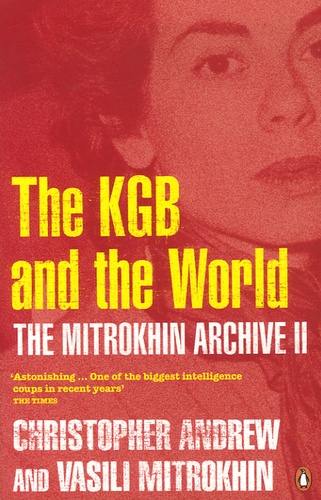
L’archiviste du Premier Directorat Principal du KGB n’avait pas tout dit avec son premier livre sur les actions du KGB en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis. Les autres continents avaient bien sûr été aussi un champ d’action des services secrets de l’URSS, et en premier lieu du KGB. Trotsky n’avait pas été en sécurité au Mexique. Mais le livre se concentre sur l’après 1945 (bien que la période 1917-1945 aurait été d’un grand intérêt aussi), avec toujours pour base les notes prises par l’archiviste sur des dossiers qu’il a eu entre les mains lors du déménagement partiel du siège du KGB et qui partirent avec lui lors de son exfiltration vers le Royaume-Uni en 1992 (ce que rappelle sans entrer dans les détails l’introduction).
Le livre s’organise en quatre parties inégales mais également munies d’un chapitre introductif : les Amériques, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique. La partie sur les Amériques s’intéresse entre autres à Cuba, au Chili, au Guatemala, au Panama, au Salvador, au Pérou, à l’Argentine et à la Colombie. Cuba prend bien sûr une place très importante puisque le régime a pu se maintenir et qu’il a été non seulement une tête de pont pour les services soviétiques mais a aussi voulu prendre sa part de manière active dans l’exportation de la révolution, que ce soit avec des guérillas (avec E. Guevara à la manœuvre, aussi pour moins le voir à La Havane) ou, plus tard, avec des soutiens armés plus conventionnels comme en Afrique (Mozambique, Angola, Ethiopie, Algérie etc.). Les Sandinistes et Allende (avec ses défauts) sont de la partie. Les auteurs veulent aussi montrer qu’avec la mort d’Allende, les priorités du KGB changent. L’élection d’un président un peu plus à gauche au Mexique permet au KGB d’être plus actif dans le pays. Mais si la résidence locale affirme faire beaucoup pour influencer la population via des articles de presse, elle n’apprécie pas à sa juste valeur un transfuge de la CIA qui finit chez les Cubains (p. 104). Si les Cubains sont de plus en plus critiques de l’URSS au fur et à mesure que le soutien économique soviétique se fait moins massif (parce qu’ils n’en ont plus les moyens et que les quémandeurs sont nombreux), la crise avec Solidarité en Pologne leur fait tout de même craindre qu’en cas d’invasion soviétique pour ramener la Pologne dans le droit chemin, ils soient en guise de rétorsion envahis par les Etats-Unis (p. 126).
Le Moyen-Orient englobe l’Egypte dans ce livre. Ce pays a été le plus grand allié de l’URSS dans la zone et l’intérêt premier des Egyptiens, c’est de faire monter le niveau de leur armée dans le cadre de son affrontement avec Israël. L’URSS était tellement confiante dans son alliance qu’elle a demandé au PC local de se dissoudre … C’était donc un peu compliqué pour les communistes locaux quand A. El-Sadate a renversé son alliance pour se ranger du côté des Etats-Unis en 1976. Mais le KGB agissait en parallèle en Irak (S. Hussein était un grand admirateur de Staline et de ses méthodes p. 188), en Iran et aussi bien évidemment en Syrie (comme la seconde partie de la guerre civile syrienne des années 2010 l’a rappelé). La République Démocratique du Yémen, là encore un pays meurtri du début du XXIe siècle, avait elle aussi d’étroits contacts avec l’URSS et donc avec ses services secrets. Israel est aussi traité, avec la question de l’antisémitisme très présent au KGB et au cas des refuzniks, ces Juifs soviétiques à qui on refuse le visa d’émigration dans les années 1970 et 1980 et qui sont réprimés. Les Soviétiques ont beaucoup de mal, au vu des notes Mitrokhine, à pénétrer les appareils de sécurité israéliens mais sont très en chevilles avec le terrorisme palestinien (mais pas que), de toutes obédiences. Mais tout n’était pas sous contrôle …
En Asie, le livre porte la lumière sur de très gros morceaux. En premier lieu la Chine, un terrain très difficile pour le KGB après le schisme de 1960 (l’URSS avait donné les noms de son réseau au PCC p. 271). Et avec le Grand Bond en Avant, où parler avec un étranger vous envoie au camp, c’est encore pire pour les officiers traitants du KGB. La vie n’est pas bien facile non plus à Hanoi, alors même qu’il n’y a pas l’inimitié qu’il y a avec la Chine (p. 266) L’ambiance est bien plus relâchée au Japon (sous protectorat étatsunien) et plus encore en Inde. Dans ce pays, le rapprochement politique avec l’URSS, notamment avec Indira Gandhi, ouvre les portes toutes grandes au KGB. Conséquence de cette proximité avec l’Inde, le KGB est beaucoup moins en faveur au Pakistan et au Bengladesh. Petit excursus dans cette partie asiatique, les auteurs font un détour par les affaires intérieures de l’URSS en traitant de l’Islam soviétique (qui fait miroir avec la partie sur l’Eglise orthodoxe dans le premier volume). Au KGB, il n’y a pas de barrière entre domestique et étranger, comme le montre la chasse aux dissidents, y compris sportifs ou artistiques (p. 486-487). Logiquement, l’Afghanistan prend la suite, un sujet forcément très lourd dans ce volume et où le KGB agit beaucoup avant et après l’intervention de l’armée soviétique pour sauver un régime frère.
Le dernier continent est traité en une introduction et un chapitre … c’est donc très rapide pour passer très vite sur l’Afrique du Sud, l’Ethiopie (sur les causes premières des concerts contre la faim p. 478), l’Angola ou encore le Maroc. Le volume s’achève sur la désillusion qui gagne le KGB dans les années 1980, entre des alliés qui ne sont toujours que marxistes par intérêt (ou encore staliniens), les difficultés économiques soviétiques de plus en plus insupportables et sur les changements ou les constances au KGB après 1991. Le SVR (successeur du Premier Directorat Principal du KGB) fête toujours l’anniversaire de la fondation de la Tchéka en 1917 mais a maintenant une église paroissiale à Moscou …
Des appendices sur l’organisation du Premier Directorat Principal, des résidences (postes à l’étranger), sur les dirigeants du KGB, puis les notes, la bibliographie et un index complètent un volume de 490 pages de texte entrecoupé de deux cahiers d’illustrations.
Ce volume semble bien plus dépendant de C. Andrew que le premier. Les informations apportées par les archives Mitrokhine semble bien moins nombreuses et cela se voit très fortement dans la partie sur l’Afrique. Un intérêt moindre dans ces sujets semble être la cause principale, allié au fait que recopier des dossiers que l’on n’est pas censé avoir entre ses mains prend évidemment beaucoup de temps et que des choix sont opérés. Il n’est donc pas scandaleux que certaines zones géographiques soient mieux représentées que d’autres.
Il y a tout de même beaucoup d’informations dans ce livre, et chacun y trouvera des éléments à son goût. Un point commun avec le premier volume : les chefs de l’URSS comme ceux du KGB préfèrent qu’on leurs disent ce qu’ils veulent entendre, même quand cela vient d’Aden ou de Managua. Les agents le savent parfaitement et comme ils souhaitent continuer leur carrière (voire leur vie au début de la période considérée) ils font remonter leurs succès (réels ou prétendus) et ce qu’ils voient mais se gardent bien de relier des points. Les fonctions d’analyse restent conséquemment des voies de garage au sein du Premier Directorat Principal du KGB, ce qui a évidemment de profondes conséquences. La première de ces conséquences est souvent la surprise. Si l’on en croit Mitrokhine, le KGB n’apprend le début de la Guerre des Six Jours que grâce aux dépêches d’agences de presse (p. 151).
Quelques points en florilège. La facilité du travail du KGB en Inde est illustrée par le fait que l’ambassade indienne à Moscou est la cible d’un kompromat (pot de miel en général, p. 313). Les limites du KGB sont déjà visibles au Japon dans les années 1970 : il n’y est pas assez puissant en termes financiers pour corrompre dans les plus hautes sphères (p. 302). Tout aussi étonnamment, le lecteur découvre que le FPLP palestinien reçoit des armes que même d’autres pays du Pacte de Varsovie ne peuvent avoir (p. 247), que le Nord-Caucase est dès les années 1970 un espace soviétique hors de contrôle (p. 377) préfigurant la guerre civile des années 1990 ou encore que le KGB monte de fausses bandes de moudjahidines en Afghanistan pouvant comprendre plusieurs centaines d’hommes (p. 409). On ne suivra pas forcément les auteurs quand ils avancent le chiffre de plus d’un million de victimes pour la Guerre d’Algérie (p. 431).
Peut-être encore à la différence du premier volume (avait-il moins d’ambitions ?) la lecture n’est pas terriblement aisée. On saute de lieu en lieu, on revient à d’autres. La partie sur l’Amérique centrale nous a paru très nébuleuse. Les chapitres sur l’Afghanistan ou sur les terroristes moyen-orientaux comptent sans doute parmi les meilleurs.
Un livre très utile mais qui aurait peut-être gagné à être réduit dans son spectre.
(la taupe idéologique reste inconcevable pour l’ex-KGB p. 483-485 … 6,5)