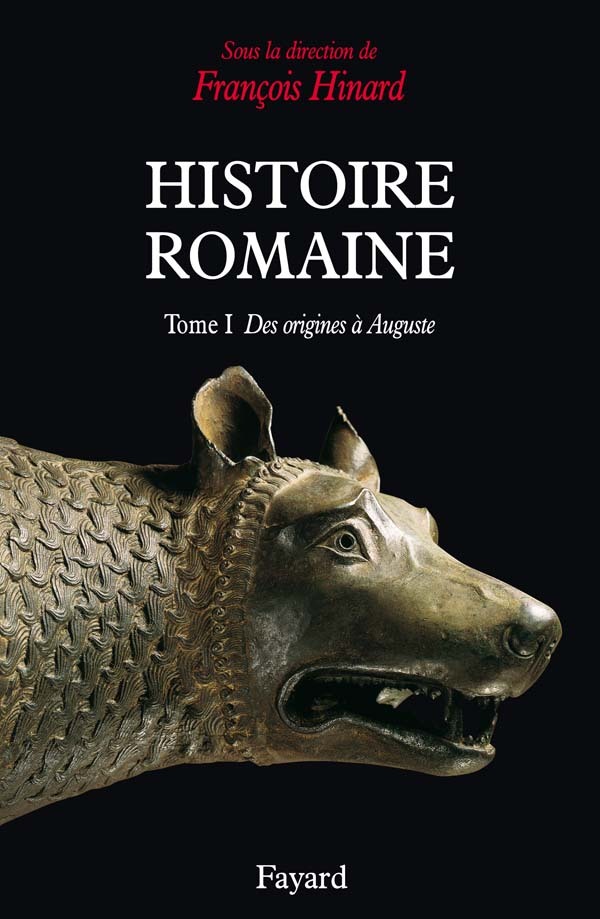Une histoire des guerres de Religion
Essai d’histoire moderne de Jérémie Foa.

Le désavantage dans une guerre civile, c’est que l’ennemi vous comprends. L’avantage dans une guerre civile, c’est que vous comprenez l’ennemi. Mais comprendre ne suffit pas. Pour sauver sa vie en période de grand trouble, quand vous êtes un catholique, un protestant, un ligueur ou un soutien d’Henry IV dans une ville qui est violemment hostile à votre parti ou votre confession, il vous faut d’autres connaissances ou d’autres techniques pour vous dissimuler et vous faire passer pour quelqu’un du bon parti. Les mêmes choses nécessaires si vous voulez à votre tour surprendre l’ennemi et investir sa place. Ce sont ces savoirs et ces savoir-êtres qu’explore Jérémie Foa dans cet ouvrage, suite au plus grand spectre de son livre sur la Saint-Barthélémy. Il y ausculte les faits et gestes de personnes prises dans un tourbillon immaîtrisable et qui cherche à clarifier les quatre doutes de la guerre civile : celui des personnes, des lieux, des choses et des mots (p. 14).
La première partie est celle du corps et elle débute par l’étonnement de Montaigne (Essais, II, 5). Celui-ci, malgré des jours de voisinage vers 1572-1573 pendant la quatrième guerre civile, n’avait pas remarqué que son compagnon de voyage était protestant. Il ne s’était pas méfié, n’avait pas posé de questions … Mais il n’y a pas que ceux qui ne se dévoilent pas, il y a ceux qui se déguisent, en paysan par exemple, pour pouvoir sortir d’une ville ou y entrer. L’erreur d’accessoire se paie cher, comme celui d’avoir de blanches mains (p. 47). Si l’on fuit, il faut aussi pouvoir exhiber ou cacher des signes, comme par exemple des croix sur son habit ou une écharpe blanche.
Celui qui est en danger doit aussi être attentif au marquage de l’espace (deuxième partie). Il lui faut connaître l’orientation confessionnelle ou politique des villes ou des quartiers qu’il traverse. Parfois c’est la maison même qui renseigne sur ses occupants. Le conflit se matérialise aussi par des affiches (comme la fameuse Affaire des Placards de 1534, qu’il fallait tout de même prendre le temps de lire …) mais plus encore par la destruction de maisons de personnes condamnées. Les méchants ayant tendance à se cacher ou à cacher leurs méfaits derrières des murs, les autorités conduisent des perquisitions chez les présents comme les absents. L’absence étant un motif de suspicion … On espère bien sûr y trouver des preuves matérielles, ce qui a pour conséquence que les perquisiteurs deviennent parfois des spécialistes de la « littérature interdite », reconnaissant auteurs et éditions (p. 186). D’autres ont développé un flair pour les caches, aidés parfois en cela par des maçons.
Dans ce monde de faux-semblants la vigilance se doit d’être permanente mais elle peut ne pas suffire à se prémunir d’attaques masquées. C’est le règne de l’assassinat par les familiers, mais aussi de l’usage du poison et, plus étonnamment encore, du colis piégé (p. 156). On en vient tout de même à vouloir faire sauter l’église des Prêcheurs à Marseille à la Nativité 1594, et à Vence deux ans plus tard un évêque veut en éliminer un autre (p. 163). Avec les éventuels dégâts collatéraux que peut provoquer une charge explosive sous une cathèdre … J. Foa passe ensuite en revue quelques objets qui peuvent revêtir une importance cruciale en temps de troubles : le contenu des poches, un jambon le vendredi ou pendant le Carême, ou encore le livre d’heures porté par le futur duc de Sully pendant la Saint-Barthélémy (le genre de personnages dont on pense toujours qu’ils sont nés vieux). L’auteur consacre un chapitre entier aux écrits, livres et messages et aux dangers qu’ils font courir à ceux qui les portent.
Dans une dernière partie enfin, J. Foa analyse ce que les guerres civiles font à la langue. Il y a en effet un envahissement du « prétendument » (la fameuse RPR qui s’immisce jusque dans les édits royaux entre 1563 et 1685 p. 202-208), une multiplication des antanaclases (un mot pour deux choses) et des paradiastoles (deux mots pour une chose), où chacun ne soit d’être informé de la novlangue, prendre garde aux shibboleths et où la présomption d’un jeu de mots ou un tic de langage peut provoquer un lynchage. C’est cette insécurité de la parole qui va conduire à la création de l’Académie Française, devant mettre la langue au clair (le Dictionnaire), parmi d’autres exemples de pacification royale. C’est la neutralisation du langage par la Couronne qui conduit à l’utilisation du terme citoyen (p. 237).
Une très belle et trop courte conclusion achève le propos (avant les notes et la bibliographie comme de bien entendu). L’homme des guerres civiles n’est pas seulement un loup (Hobbes), il est aussi une huître qui s’ouvre et se ferme a volonté (Louis d’Orléans). Le devenir-huître !
A la lecture de ce livre il doit être clair pour chacun pourquoi la France cherche l’unité depuis le XVIe siècle, sous tous ses régimes et selon des modalités qui divergent peu. Les guerres civiles dans ce qui était le royaume le plus peuplé d’Europe ont laissé un souvenir brûlant dans la psyché nationale qui a trouvé à se résoudre dans l’absolutisme royal et l’égalité révolutionnaire. Et la thérapie commence avec la neutralisation de l’espace (p. 141) par le pouvoir royal, avec la redéfinition en parallèle ce qui constitue un espace privé en rapport de l’espace public (p. 144), y compris de manière olfactive. La pièce de lard dans les lentilles protestantes pendant le Carême devient possible à la fin du XVIe siècle si les fenêtres sont fermées et sans fumet ostensible.
Dans le voyage au raz du pavé et des chemins poussiéreux de campagnes entre les injonctions contradictoires des guerres civiles, où l’on doit tour à tour montrer avec ferveur et dissimuler, le lecteur a la grande chance d’être aidé encore une fois par le style cristallin et de la plus haute qualité littéraire de J. Foa. Tout est ciselé avec la plus grande finesse, avec une pédagogie heureusement soutenue par de belles trouvailles que l’on peut qualifier de lacananoïdes. L’échange de la méthodologie paléographique de Tous ceux qui tombent pour la hauteur de vue du présent livre ne se fait pas aux dépens du lecteur. Cela aide à faire passer toutes les cruautés des temps …
(« ces guerres se mesurent en métrique pédestre » p. 39 … 8,5)