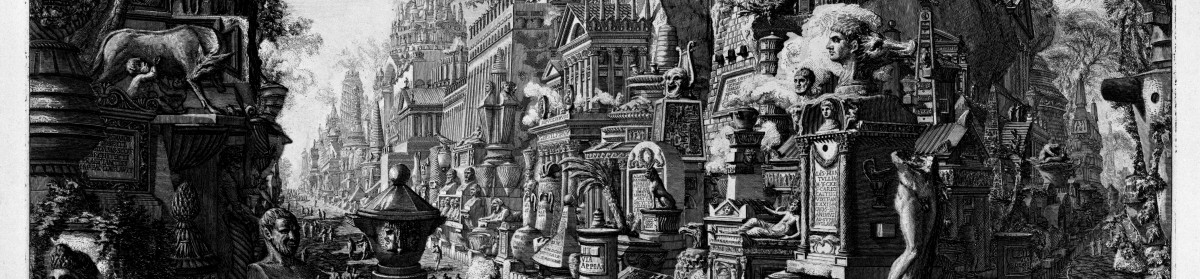Essai d’étruscologie de Vedia Izzet.

Dans cet essai, Vedia Izzet (qui enseigne à Southampton) s’est donnée pour objectif de lier différents aspects de la culture matérielle étrusque par le concept de confins, d’interfaces (p. 31) et d’étudiers les changements qui ont lieu dans la culture étrusque à la fin du VIe siècle. Elle progresse ainsi du plus petit vers le plus grand, commençant avec les miroirs pour aboutir au grand large du commerce international dans l’espace méditerranéen.
Mais avant cela, V. Izzet pose son cadre méthodologique, et ceci de manière très approfondie dans le premier chapitre. Il est fait appel de manière très forte aux sciences sociales (sociologie du réseau, ethnologie). Cela a pour corollaire un hypercriticisme envers les sources écrites (puisqu’elles sont toujours écrites par des non-étrusques), qui concoure à conduire, selon l’auteur, l’étruscologie hors de l’archéologie classique (p. 10-15). C’est une vue qui se défend (et semble se retrouver de plus en plus, bien entendu chez les anglo-saxons, plus sensibles historiographiquement à la proximité avec l‘ethnologie), visant à ne plus voir les Etrusques comme coincés entre les Grecs et les Romains, la cinquième roue du carrosse et de simples transmetteurs idiots d’une culture grecque supposément supérieure. V. Izzet propose aussi de se défaire du biais funéraire et d’une vision trop marquée par l’histoire de l’art (forte critique du Corpus Speculorum Etruscorum p. 17). De manière générale, elle constate une absence de réflexion sur le pourquoi des évolutions (p. 19), trop souvent ramené à des influences étrangères (p. 20-21). Si l’on peut ne pas être en accord avec tous ces choix méthodologiques, c’est très solide de ce côté-là, non seulement dans ce premier chapitre mais aussi dans tous les suivants.
Le second chapitre initie la série d’études avec les miroirs, une grande spécialité étrusque. Ils sont considérés non seulement pour leurs revers historiés mais aussi pour leur qualité d’objet usuel (ce qui est, il faut en convenir avec l’auteur, moins fait), dialoguant avec celui, homme ou femme, qui le tient. L’étude dans ce chapitre se base sur le principe du corps modelé socialement (la peau sociale p. 49, avec son apprêt, les vêtements etc.), qui prend place dans un cadre de possibles sociaux. Du point de vue des sources, l’auteur rappelle qu’environs 4000 miroirs étrusques ont été retrouvés, dont seulement quatre dateraient d’avant la fin du VIe siècle et dont la moitié ne sont pas gravés. Mais si la conscience des corps et l’idée de beauté existe avant le Ve siècle, comment expliquer l’essor de la production à ce moment -là ? De plus, de nombreux miroirs comportent des scènes de parement, renvoyant au porteur dudit miroir. L’auteur, évidemment, cherche ses arguments dans les études de genre mais ses comparaisons risquent beaucoup l’anachronisme. De même, certaines analyses n’arrivent pas à convaincre (l’objectivation de deux danseuses p. 69 par exemple ou sur le sens de la nudité et de l’habillage, à la même page ou les exagérations des p. 71-73). Il arrive même que l’auteur puisse se contredire, parlant de choix de genre d’abord mais n’évoquant que la passivité féminine. Une comparaison entre ce que V. Izzet dit de la femme étrusque et la place de l’épouse du suzerain dans l’amour courtois aurait été intéressant … Par contre elle explique lumineusement la mécanique du parement, fait de soustractions chez l’homme (nudité) et d’addition chez la femme (p. 81). Il faut donc, pour l’auteur, bien prendre en compte les deux surfaces du miroir et leurs interactions.
Le troisième chapitre poursuit son parcours scalaire en passant à l’architecture funéraire. Le mouvement qui a lieu voit la disparition des grandes tombes à tumulus (il y a une critique des termes latins et grecs employés pour les descriptions) pour laisser la place à des tombes plus standardisées (comme à Orvieto). V. Izzet détaille d’abord les entrées des tombes (en théorie l’auteur ne veut étudier que Cerveteri, mais les exemples sont situés dans toute l’Etrurie), puis les différents types de structures avant de passer aux décorations (sculptées ou peintes). Les tombes entièrement peintes représentent à peine 2% de l’ensemble (p. 111). L’organisation des nécropoles évolue elle-aussi, avec une place laissée libre à la possibilité de rassemblement, comme une place urbaine, accompagnée d’une plus grande rationalisation de l’espace et une fin de l’orientation générale vers le nord-est des tombes (p. 118-119). Petite nouveauté, il a été prouvé la présence de tentes devant les tombes, vraisemblablement lors des funérailles (p. 112-113). L’auteur pense que c’est lié aux peintures à l’intérieur, mais il faut avouer que ce n’est pas entièrement convaincant.
Le chapitre suivant reste à la croisée des mondes puisqu’il prend en considération les sanctuaires. Il y a une très claire monumentalisation des sanctuaires à la fin du VIe siècle (p. 128), sans pour autant un abandon de sanctuaires plus anciens sans structures pérennes (comme le Lac des Idoles par exemple). V. Izzet détaille la forme que prend ce nouveau type de sanctuaire en se penchant sur le temple sous toutes ses facettes. Le maître mot, assez contestable, est que tout y a une signification (p. 122), mais lier la décoration à on emplacement sur le bâtiment n’est de loin pas sans intérêt.
Tant que l’on est dans l’architecture, restons-y avec l’architecture domestique (cinquième chapitre). L’objet de l’étude est ici le passage des huttes avec leurs murs courbes aux maisons intégrées dans les insulae, et donc aux murs droits et à des dimensions prédéfinies. La difficulté du corpus documentaires se niche ici dans le fait que de très nombreuses villes étrusques, et bien évidemment parmi les plus importantes, sont aussi le site de villes médiévales, modernes et contemporaines. L’étude s’en trouve fortement limitée. Ce chapitre est hélas miné par une contradiction (p. 147) : l’étude se veut non-chronologique mais elle l’est tout de même. Si l’on ajoute à cela la désagréable impression que certains auteurs cités semblent découvrir l’eau tiède (toujours p. 147), qu’il est questions de facteurs socio-culturels du changement qui ne sont jamais précisés (p. 152) et que le concept de non-maison est des plus flou (p. 151) et ne porte pas bien loin, cela fait de ce chapitre l’un des moins bon du livre.
Le chapitre suivant élargit encore le champ pour se placer au niveau des cités. Il est question de territoires, délimité par des forts ou des sanctuaires mais l’auteur développe aussi un point de vue non rituel des via cave (p. 193) et s’attarde sur des questions très britanniques de paysage avec les modifications causées par les canalisations (jusqu’à 600m de long à Véies au VIe siècle, p. 196) ou les routes (p. 195). Les constituants de la ville ne sont pas pour autant oubliés tout comme l’interface entre ville te campagne (p. 189). La vision d’une antiquité italienne non romaine très rurale en est assez chamboulée : dans la vallée de l’Albegna au VIe siècle, on compte 70% d’urbains (p. 206).
Le septième et dernier chapitre est peut-être le meilleur du volume. Comme couronnement, il donne au lecteur un aperçu des échanges méditerranéens (où la Grèce n’est pas le centre de tout) et à la place de l’Etrurie dans ceux-ci. La Grèce donc, ou plutôt les différentes cités grecques, mais aussi l’Italie et ses composantes. La côte levantine est elle aussi brièvement abordée, après avoir fait un très utile rappel historiographique. La conclusion de ce chapitre sert de conclusion générale, résumant la pensée de l’auteur, avant de passer à bibliographie imposante (plus de 70 pages !) et un index.
Au bilan, ce livre, aux larges ambitions tout en n’étant pas un manuel peine à atteindre ses objectifs. Pour le lecteur, les causes des changements listés au VIe siècle restent floues. Certains thèmes sont bien traités, d’autres ont du mal à emballer le lecteur. Parmi les points les plus intéressants figure celui sur l’alphabétisation féminine, mais qu’il faut mettre en regard avec le taux moyen d’alphabétisation (si l’on suit L. Shipley, comme ici). Il manque souvent des datations (pour les illustrations par exemple) et V. Izzet abuse de références plus tardives pour prouver ses dires. On peut aussi regretter que Charun soit qualifié de divinité p. 90, alors que c’est clairement un démon.
Mais ce qui reste le plus handicapant, c’est le système de références et de notes dans le texte (dit système Cambridge) qui empêche une lecture fluide, et qui, quand manquent les numéros de page auxquelles est renvoyé le lecteur, limite la reproductibilité scientifique. Et comme la bibliographie le montre, V. Izzet n’est pas avare en références …
(particulier cette disparition des plaques architectoniques domestiques après le VIe siècle p. 163 …6,5)