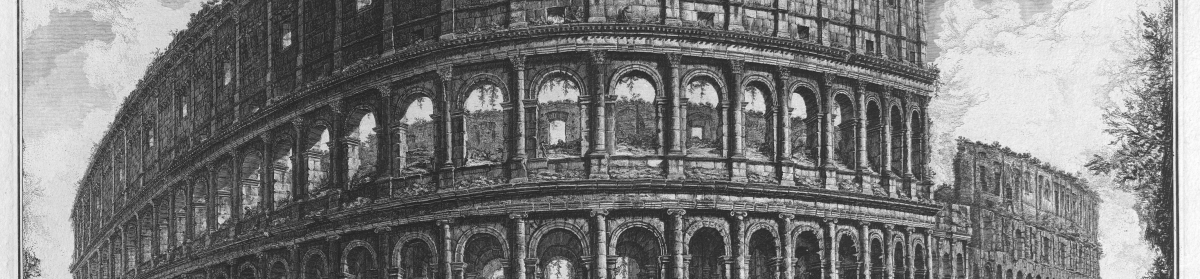Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome
Essai d’histoire des institutions antiques par Numa Denis Fustel de Coulanges.

L’homme peut bien dompter la nature, mais il est assujetti à sa pensée. p. 190
Parmi les classiques des sciences historiques il nous manquait encore La cité antique, un livre paru en 1864 et qui très tôt fit date dans l’Europe savante du dernier tiers du XIXe siècle. Deux caractéristiques sautent aux yeux du lecteur : la volonté de l’auteur de toujours parler en même temps de la Grèce et de Rome et la présence soutenue des références à l’Inde, conséquence de la l’installation du fait indo-européen dans la linguistique au milieu du XIXe siècle.
Pour l’auteur, tout dans la cité antique (et on remarquera ici aussi que le reste du pourtour méditerranéen n’est pas encore à l’ordre du jour), que ce soit ses magistratures comme ses subdivisions sociales, a pour origine la religion. Aussi le livre commence avec une première partie où Fustel veut décrire les anciennes croyances des Grecs et des Romains, répartis en quatre éléments : les croyances sur l’âme, le culte des morts, le feu sacré et la religion domestique. Pour l’auteur, ces éléments se dupliquent à chaque niveau de l’organisation de la cité et ainsi la cité elle-même forme une famille avec son culte des morts et son autel domestique (qu’il faut prendre ici au sens de pré-archaïque, au moment où se fondent les cités).
De ce fait, Fustel se voit obligé dans une seconde partie de décrire la famille antique, sa continuité, ses inégalités, le mariage, la propriété et la succession pour enfin s’attacher à la description de la gens. C’est l’occasion pour l’auteur de prendre position dans le débat sur la nature de la gens romaine et d’insister sur l’exclusion des cognats du culte et de la succession.
La partie suivante monte d’un étage avec la formation de la cité, avec l’étape précédente des phratries et des tribus. Fustel voit un changement théologique à l’origine de la cité, avec l’émergence de dieux de nature physique. La place du fondateur et la religion civique sont décrites sans trop de détails mais toujours en insistant sur le parallélisme gréco-romain puis l’on passe à la question de la royauté (roi-prêtre dépossédé de son pouvoir politique avec les changements de régime), des magistrats, de la loi, l’exil et l’étranger, les alliances et les colonies. Cette partie s’achève avec l’accent mis sur la différence irréconciliable entre les Anciens et les Modernes, sur l’absence de liberté individuelle et l’omnipotence de l’Etat gréco-romain, à remettre dans le double contexte du souvenir récent de la révérence révolutionnaire pour l’Antiquité et l’esprit libéral du XIXe siècle (Fustel vit dans « l’empire libéral » de Napoléon III quand il écrit son livre).
La quatrième partie quitte la présentation presque statique qui était faite jusqu’à présent pour explorer les révolutions (selon les mots de l’auteur) qui affectèrent le modèle. La première mentionnée est la fin de l’autorité politique des rois, que cela mène à l’aristocratie ou à la démocratie. La seconde est la disparition du droit d’aînesse et la redéfinition de la gens et de la clientèle. La troisième, toujours selon Fustel, est l’intégration de la plèbe dans la cité et en parallèle l’apparition de l’intérêt public et du suffrage, avec les tensions persistantes entre riches et pauvres.
La cinquième et dernière partie est ce que l’auteur appelle « la fin du régime municipal », ce qui dans un contexte romain est un peu malheureux, mais veut décrire la fin du système des cités comme conséquence de l’expansion romaine (le passage sur la population romaine a très très mal passé l’épreuve du temps p. 499-503 et 516) mais aussi des nouvelles idées de la philosophie (pas le passage le plus convaincant du livre) et, in fine, du christianisme. Comme de bien entendu, les notes, des annexes et un index complètent le volume.
Ce qui est très étrange et qui frappe très rapidement à lecture, c’est la grande rareté des dates. Tout flotte dans une sorte d’intemporalité qui est due en partie à l’utilisation non discriminée des sources, sans égard pour les contextes d’écriture et leur genre, mais aussi à la volonté de présenter les choses sur un plan indo-européen. Quelles sont les bornes que pose Fustel pour son état « ancien » ? Nous ne le saurons pas et les parties chronologiquement postérieures ne sont pas beaucoup plus précises de ce point de vue. Côté écriture, la manière a très peu vieilli, même s’il y aurait peut-être du volume à élaguer avec des redites qui donnent par moments l’impression de tourner un peu en rond. Il y a un sens pédagogique de la formule, comme par exemple aux p. 234-235 : « [la religion] gouvernait l’être humain avec une autorité si absolue qu’il ne restait rien qui ne fût en dehors d’elle » ou sur la comparaison entre les tribuns et l’autel (p. 411). Si le style est encore à notre sens passable pour le XXIe siècle, les supputations psychologiques sur la plèbe, assises sur rien, le sont moins (p. 369 par exemple). Il en résulte que la séparation entre le patriciat et la plèbe à Rome est présentée de manière artificiellement forcée. Mais ce genre d’écarts n’est pas le monopole de l’auteur et il faut sans doute voir ici là derrière l’objectif de l’auteur de dissocier Anciens et Modernes, ce qu’il ne parvient d’ailleurs pas toujours à faire (p. 384).
Il faut aussi signaler les très bonnes introductions de l’édition Flammarion qui donnent toute sa saveur au texte, et spécialement le passage sur la réception du livre (p. v-ix), mais qui ne parlent hélas pas de l’apport éventuel de Fustel dans l’élaboration de la pensée d’une « période axiale » par K. Jaspers, ce qui aurait été un point intéressant (et mineur, mais qui nous semble poindre à la p. 427).
Rigide peut-être, pédagogique avec quelques excès, mais aux parallélismes fondateurs et l’initiateur d’une nouvelle voie pour l’étude de la religion antique.
(un « livre embaumé » p. iii, toujours cité et rarement lu nous dit F. Hartog en introduction … 7 )