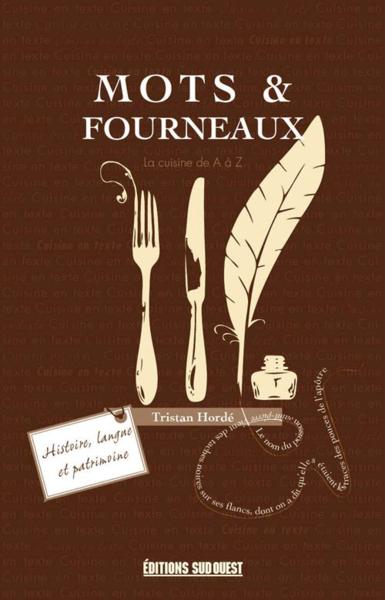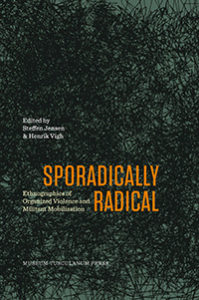Gestion des entreprises et traditions nationales
Essai de sociologie et d’anthropologie culturelle en entreprise de Philippe d’Iribarne.

Les entreprises ne peuvent être coupées de la société dans laquelle elles sont implantées, même si elles n’y ont pas de clients. Elles ne font pas qu’y baigner, elles sont aussi traversées par elle et les traits culturels qui l’anime, au travers des relations avec l’Etat (même si celui-ci est minimal) et de ses employés. Ces derniers ont des habitudes et des attentes qui peuvent être difficilement cernables par une hiérarchie qui n’arriverait pas s’adapter car, comme dans les exemples du présent livre, venue du pays où la multinationale a son siège. L’homo economicus est universel, mais ce n’est pas le même partout. S’il n’y a pas de dialogue selon les mêmes règles au sein de l’entité, cette dernière ne peut qu’aller mal même si la direction est fermement convaincue que la méthode est la bonne, parce qu’elle est la plus moderne et que d’autres disent l’avoir appliquée avec succès (mais ailleurs).
P. d’Iribarne a pu, au sein d’un même groupe industriel français, comparer trois usines fabriquant la même chose à l’aide des mêmes techniques : l’une en France, l’autre aux Etats-Unis et la dernière aux Pays-Bas. Pour chaque usine, l’auteur présente ses observations et le fruit de ses entretiens avec le personnel, de l’ouvrier au directeur, dans les secteurs de la fabrication et de l’entretien (le commercial et l’administratif sont exclus de l’étude). Puis, pour chaque pays, une fois arrivé à de premières conclusions au niveau de l’usine, l’auteur cherche à dégager ce qui dans l’histoire de chacun des pays, et donc dans sa propre culture, a pu conduire à des visions nationales différenciées en matière de gestion des relations humaines dans l’entreprise et dans la société. Enfin, pour chaque pays, l’auteur détaille les avantages et les inconvénients de chaque système tout en proposant des solutions pour « faire avec » aux personnes en responsabilité.
Le « faire avec » c’est accepter qu’en France, au centre des relations entre personnes se trouve l’honneur, que chacun défend son pré carré (et celui de son ordre, avec des références à Tocqueville p. 74 et Montesquieu p. 77) de toute ingérence en attendant de soi-même une attitude la noblesse (mais des autres aussi, selon leurs statut). La peur c’est de déchoir (devenir ignoble, comme par exemple devenir esclave du gain p. 34-35), de devenir serviteur au lieu de librement rendre service (p. 107). Ni les hérésies ni la Révolution n’ont réussi à faire passer la France d’une Liberté issue des coutumes à une Liberté procédant de la Loi (p. 86-87) …
Aux Etats-Unis, le contrat est central. On travaille librement pour quelqu’un, à l’image des Pères Pèlerins qui établirent leur organisation par contrat. Mais d’un autre côté, l’ancienneté dans l’entreprise joue un rôle premier pour tout un tas de choses (postes en cas de réorganisation, primes) et les rôles sont définis très précisément (rendant l’initiative et la responsabilisation plus compliquée). Direction et syndicat appliquent le contrat triennal. Aux Pays-Bas, c’est la concertation qui est le moteur des relations. Un contremaître y doit consulter toutes les parties, subordonnés comme supérieurs, et recueillir leur assentiment avant d’introduire des changements (ce qui peut être problématique en cas de changement rapide nécessaire). S’il n’y a pas de grève, que l’on élève très rarement la voix, l’opposition se manifeste par l’absentéisme.
Le livre a été écrit en 1989 et cela se sent un peu. Certains termes font un peu vieillis (contremaître déjà, « Silicon Valley » employé sans article défini p. 181) et on est revenu depuis un bon bout de temps de la nippomanie de la fin des années 1980 et du début des années 1990 (et parallèle du début de la déflation dans le pays, duquel il n’est toujours pas sorti). On y parle encore de computer … D’autres éléments n’ont pas perdu de leur force avec les années. La « Me Generation » des années 1970 n’a pas été qu’un bref épisode (p. 197) et la critique du court-termisme par l’auteur n’a pas besoin d’être actualisée pour faire effet en 2021 (p. 183). Il en est de même des gourous entrepreneuriaux (p. 194). On sent bien la présence de l’auteur dans le texte (rien d’anormal pour de l’ethnologie), avec par contre quelques petites redites qui pourraient être prises par moment pour un peu de délayage. Les traductions de l’anglais sont de plus souvent bancales (par exemple p. 193).
Un ouvrage terriblement éclairant sur la société française, la vie en entreprise et ses propres réactions.
(en France, la prédestination du talent couronnée par le concours a remplacé celle du sang, mais c’est toujours de la prédestination p. xxix … 8,5)