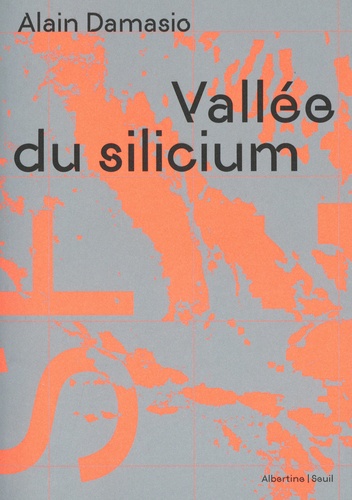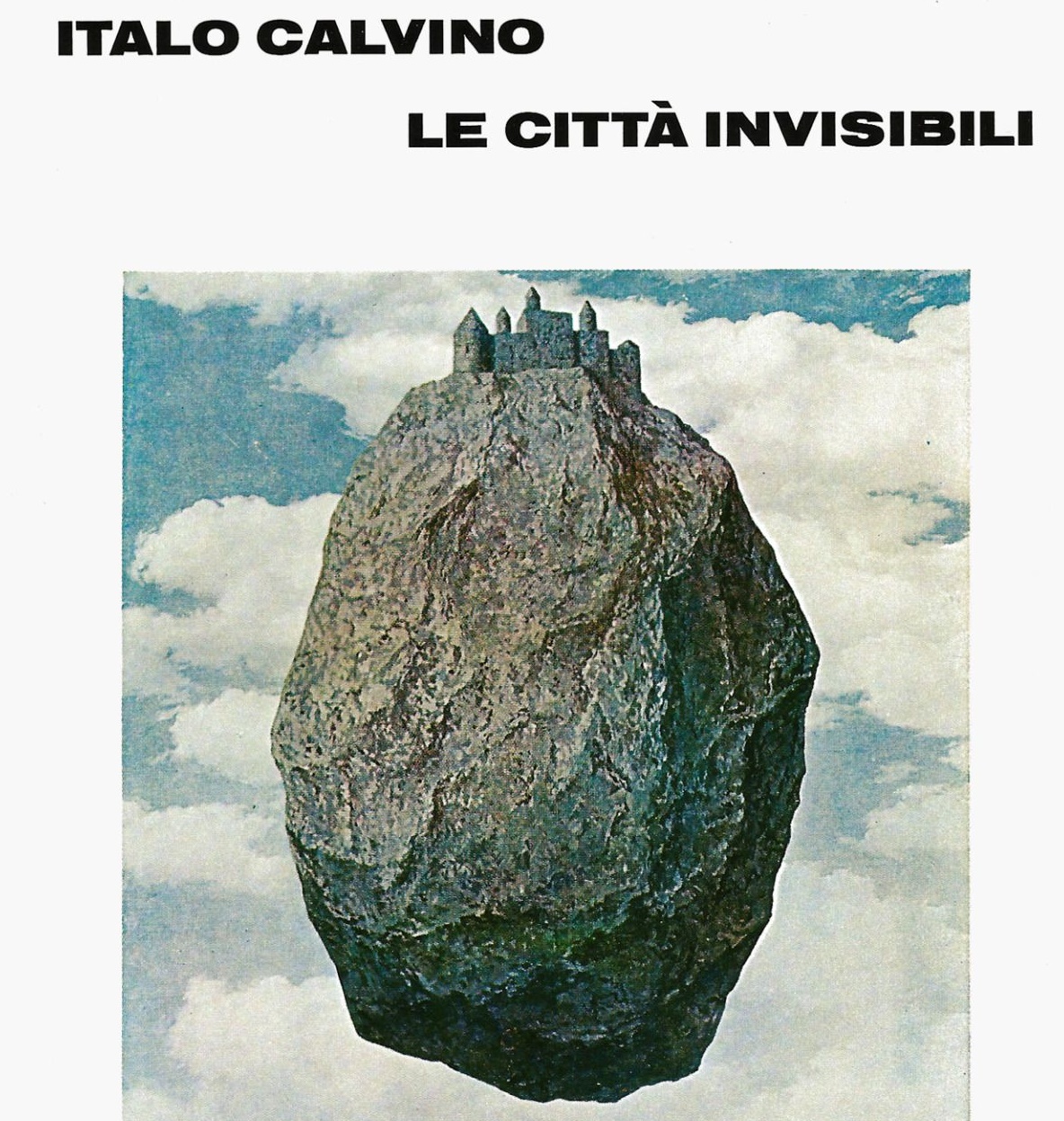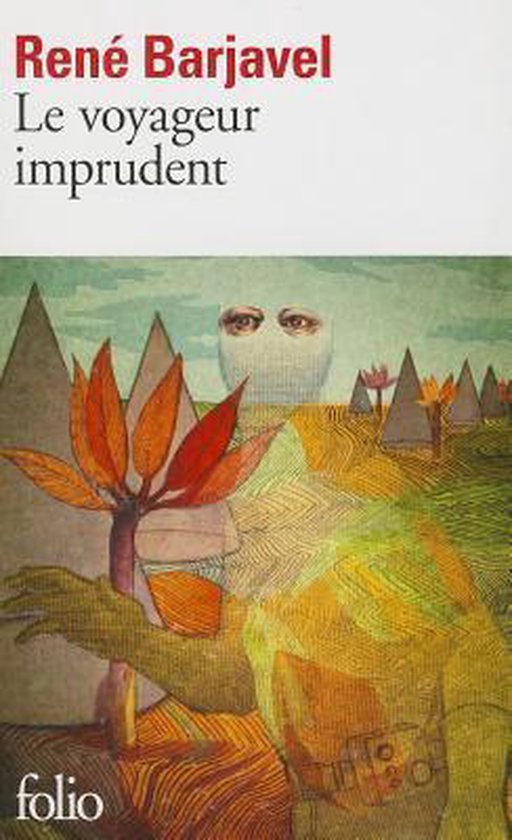Roman épistolaire fantastico-fantasy de Susanna Clarke. Publié en français sous le titre Piranèse.

Piranèse habite un gigantesque ensemble de salles et de vestibules qu’il appelle la Maison, sans doute plusieurs centaines sur trois niveaux et ornées de myriades de statues de marbre, toutes uniques. Au niveau inférieur, des salles envahies par l’océan. Au supérieur, par les nuages. Au niveau médian, hors Piranèse, il n’y a que des oiseaux et l’Autre, un homme plus âgé. L’Autre et Piranèse ne se rencontrent qu’à jours et heures fixes, pour parler de leur projet scientifique commun : la recherche du « Grand et Secret Savoir » Le reste du temps, Piranèse pèche, collecte de quoi faire du feu, recense les statues, relève les marées ou écrit dans son journal. Depuis quand est-il ici ? Il ne le sait pas. Il y est peut-être né. Ou pas. L’Autre l’appelle Piranèse mais lui-même ne pourrait dire quel est son nom. Un jour l’Autre l’avertit qu’un intrus pourrait vouloir lui parler pour le rendre fou et lui ordonne de se cacher si jamais il l’apercevait. Comment se peut-il qu’il y ait un autre habitant (dénommé Seize par Piranèse) dans ce gigantesque palais et qui n’a jamais été rencontré en tant d’années d’exploration ? Et si Seize n’était pas la seule personne que l’on puisse croiser dans les salles innombrables ?
S. Clarke ne cherche pas à cacher longtemps au lecteur pourquoi son héros se prénomme Piranèse : les salles cyclopéennes, l’omniprésence statuaire (dans le genre Canosa/Thorvaldsen, immaculées et allégoriques) et l’emprisonnement du héros conduisent naturellement à ce type de référence. Et c’est exactement cela qui nous a conduit à la lecture de ce roman. L’auteur n’est pas non plus avare de son talent, conduit son récit avec aisance, joue avec le lecteur de manière délicieuse et intelligente (une fin subtile), use de l’intertextualité (Narnia), de la typographie et du flou entre le livre que le lecteur a en mains et les journaux de Piranèse, avec parfois une pointe d’ironie (p. 147). Certains passages peuvent sembler illogiques, comme par exemple le manque de curiosité du héros à certains moments-clés, mais nous ne pouvons exclure que cela soit non pas seulement voulu, mais même désiré, tant la Maison est devenu le seul monde concevable.
S. Clarke écrit très peu de romans, mais à chaque fois c’est un évènement.
(la description statuaire dans toute sa diversité …8)