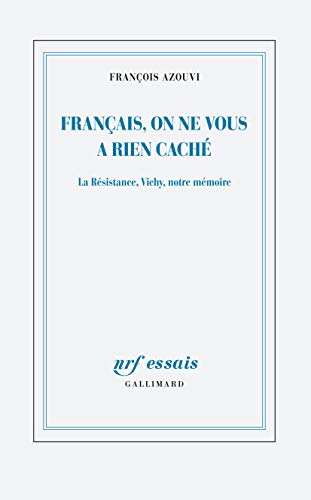Essai historique sur les crimes de masse perpétrés entre Berlin et Moscou de 1933 à 1948 par Timothy Snyder.
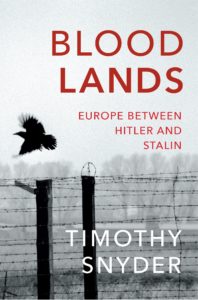
Hitler meant to undo all the work of Stalin. Socialism in one country would be supplanted by socialism for the German race. p. 163
En France il y eut Oradour pour symboliser l’éradication de tout un village par la Wehrmacht, les fosses ardéatines en Italie. Mais ce qui est exceptionnel à l’Ouest de l’Europe, et qui plus est en temps de guerre, est de la plus grande banalité dans ce qui est aujourd’hui la Pologne, les pays baltes, l’Ukraine et la Biélorussie entre 1941 et 1945. Mais l’anéantissement de villages ou l’exécution d’une balle dans la nuque de centaines de personnes ne se produit pas qu’en même temps (et non aux marges) que les combats qui opposent les armées soviétiques aux armées allemandes, ils sont parties intégrantes de politiques poursuivies par l’Allemagne nazie et l’URSS, avec des intensité diverses et des cibles semblables ou différentes, entre 1932 et 1948. Le malheur de ces « terres de sang » qui voient le meurtre de 14 millions de personnes (hors victimes de guerre) ? La double occupation, voire la triple, par les deux totalitarismes européens les plus meurtriers du XXe siècle.
Le livre ouvre sur l’Ukraine affamée du début des années 1930 (il y a bien sûr une introduction avant cela). Lénine, pour pouvoir exporter la révolution hors de Russie, avait fait la NEP, conséquence des distributions de terres aux paysans. Mais Staline considère que la pause dans l’avancée de l’URSS vers le communisme a assez duré. Pour le bâtir dans un seul pays (c’est tout ce qu’il reste), il faut plus d’ouvriers (les porteurs de l’Histoire) et donc il faut enfin industrialiser ce dernier élève de la classe européenne. Pour cela, il faut acheter des machines à l’étranger, donc avoir des devises, donc exporter. Qu’exporter, si ce n’est des produits agricoles en grandes quantités et le plus vite possible ? Pour y arriver, la collectivisation des moyens de production agricole est évidemment le meilleur moyen. Ordre est donné de le faire au plus vite, en réquisitionnant tout. L’Ukraine, plus gros producteur agricole d’URSS et bénéficiaire de la politique des nationalités de Lénine, est aux premières loges des demandes du Kremlin et de la concurrence des communistes locaux pour dépasser ces demandes. Et comme en plus la météorologie s’en mêle et fait chuter le rendement … La famine, instrument de contrainte du Politburo de Moscou, ravage les campagnes ukrainiennes et cause 3,3 millions de morts. A cela il faut ajouter les exécutions par le NKVD (la dékoulakisation définie par le stalinisme en parallèle p. 79), les condamnations au goulag ou les déportations vers la Sibérie ou le Kazakhstan où rien n’attend les déportés. Quand le goulag est plein, on exécute (p. 104).
Puis en 1937-1938, la répression reprend après quatre ans d’accalmie. J. Staline a complètement la main sur le Politburo du PCUS et commence une série de procès à grand spectacle pour purger le Parti. La répression ne se limite pas aux cercles dirigeants et aux administrations mais atteint des populations entières. Inquiet d’une possible alliance militaire nippo-polonaise, il est procédé à la déportation de Coréens résidents en URSS vers le Kazakhstan comme à l’élimination de citoyens soviétique ethniquement polonais (plus de 100 000 victimes) pour saper un éventuel soutien à une attaque, malgré le pacte de non-agression signé en 1932 et l’incapacité pour la Pologne d’être un danger pour ses voisins dans les années 1930. De son côté l’Allemagne, nazie depuis 1933, use peu du crime de masse. Les camps de concentration n’ont pas cet objectif et les exécutions sont en dessous des trois centaines avant 1939.
Mais la politique allemande change en 1939 et si c’est l’URSS qui extermine en masse avant 1939, l’Allemagne se met au niveau en 1939. L’invasion de la Pologne est marquée, dès le premier jour, par des exécutions de prisonniers de guerre et de civils, bientôt suivis par des tueries de masse visant les Juifs (d’abord sous couvert de lutte contre les partisans, comme certains soldats polonais, puis nommément). Les élites polonaises sont particulièrement ciblées dans ce qui doit être un territoire prêt à être colonisé. Quand les Soviétiques entrent eux aussi en Pologne pour rejoindre leur côté de la ligne Molotov-Ribbentrop, le NKVD est lui engagé dans l’élimination de toute personne susceptible d’opposer une résistance ou de la diriger. D’où, comme avec les Allemands, des massacres d’officiers (mais avec une organisation bien plus professionnelle, fruit de deux décennies d’expérience p. 77-78) comme c’est le cas à Katyn, mais pas que. De chaque côté de la ligne Molotov-Ribbentrop, les populations sont surveillées, classées et les éléments indésirables sont éliminés, déportés ou regroupés (des ghettos pour les Juifs où ils sont affamés et exploités).
L’étape suivante commence en juin 1941. L’invasion allemande de l’URSS (enfin, des territoires que l’URSS venait d’acquérir pour commencer) lance véritablement l’extermination systématique des Juifs à l’aide d’unités dédiées sur toute la ligne de front, aidées par des supplétifs locaux, volontaires ou non. Mais les armées allemandes n’atteignent pas Moscou, ni ne font tomber Léningrad, ni n’atteignent le Caucase. En 1942, l’échec est visible. Et plutôt que de continuer à faire mourir de faim des prisonniers de guerre soviétique (il en meure chaque jour plus que de prisonniers américains et britanniques pendant toute la guerre p. 181-182), et de prévoir l’élimination par la faim ou déportation du tiers des Slaves habitant la région, l’Allemagne se voit contrainte de faire travailler ces populations pour remplacer sa force de travail qui est au front. Mais pas les Juifs. Eux continuent de mourir en masse, puisque leur élimination est le dernier objectif atteignable par les Nazis. Si ceux qui se trouvent à l’Est de la ligne Molotov-Ribbentrop sont tués majoritairement par balle, ceux à l’Ouest de ladite ligne sont envoyés dans des usines de la mort (gardés par d’anciens prisonniers de guerre soviétiques ayant survécu) pour y être asphyxiés à l’aide de gaz d’échappement puis à l’aide de monoxyde de carbone produit à partir de granulés (comme le furent les handicapés en Allemagne entre 1939 et 1941, avec les mêmes « médecins », les massacres hors d’Allemagne permettant ceux dedans, p. 256-257). Auschwitz est le dernier créé de ces camps d’extermination, mais aussi le plus connu parce que ses survivants ont été les plus nombreux (et de nombreuses victimes provenant de l’Ouest, alors qu’aucun de ces camps n’est découvert par une armée occidentale). Ceux du camp de Treblinka dépassent à peine la centaine.
En parallèle de la mise à mort industrielle, la guerre de partisans et la contre insurrection font aussi de nombreuses victimes, surtout par l’impossible neutralité entre forces allemandes, supplétifs locaux, Armée de l’Intérieur polonaise, partisans soviétiques (dirigés ou non par Moscou, qui par ailleurs se moque complètement des victimes civiles p. 238-239) et nationalistes ukrainiens. Rejoindre un groupe ou un autre est une affaire de chance, le plus souvent une question de survie. Système nazi et système soviétique se confondent en Biélorussie, ce n’est plus que de l’exploitation violente. Le bilan pour la Biélorussie à la fin de la guerre, c’est 50 % de la population déportée ou liquidée (p. 249-251). Et il y a des soulèvements, celui du ghetto de Varsovie (de avril à mai 1943, soutenu modérément par la résistance polonaise) et celle de Varsovie (entre août et octobre 1944) alors que les troupes soviétiques sont proches de la ville. Ils sont réprimés très durement, avec à chaque fois des dizaines de milliers de victimes, surtout non combattantes.
La fin de la guerre ne signifie pas la fin des exactions. La puissance soviétique remodèle à sa façon ses conquêtes, en éliminant des individus ayant fait preuve de trop d’autonomie et en simplifiant l’enchevêtrement ethnique local. Les Allemands sont expulsés vers l’Ouest (pas toujours avec douceur), mais ce ne sont pas les seuls à devoir se trouver sans ménagement un autre toit. Les Polonais de l’Est sont envoyés dans l’Ouest, puisque c’est toute la Pologne qui est décalée. Mais des Polonais sont aussi chassés d’Ukraine, par les nationalistes ukrainiens comme les communistes (chacun d’eux souhaite un Etat-nation homogène mais pas la même direction). Avec la paix venue, la spécificité juive passe cependant mal en URSS et un antisémitisme officiel stalinien se fait jour, qui pourtant ne mène pas aux crimes de masse de la Grande Terreur (p. 350-351).
La dernière partie est une mise en perspective de tout ce qui précède. De simples comparaisons permettent ainsi d’approcher une compréhension des tourments que connurent ces territoires et la signification politique des morts, hier comme aujourd’hui. (p. 385) Un Juif né en Pologne, citoyen soviétique depuis quelques mois quand il est exécuté, est-il un mort soviétique ?
L’index est précédé de 80 pages de bibliographie et de notes.
Le livre, à la grande différence de Black Earth du même auteur, ne démarre pas par les soubassements philosophiques ou théoriques d’un phénomène, mais directement par la famine orchestrée par l’URSS en Ukraine. Le lecteur est ainsi, sans préparation, littéralement jeté dans une piscine d’eau froide. Rien ne lui est épargné, tant les statistiques que les témoignages de victimes ou d’exécuteurs. De ce point de vue, le Livre noir du communisme, avec ses millions de victimes supplémentaires, était bien plus facile à lire du fait de sa déréalisation. Ici il n’est pas question des camps de concentration en Allemagne où l’on a des films faits par les troupes étatsuniennes, mais bien de meurtres de masse, cachés ou non. Devant tant de faits peu plaisants, devant la répétition des atrocités, le talent d’écriture de T. Snyder est éclatant et permet de ne pas reposer le livre aussi facilement que si cela avait l’intérêt d’une liste de courses. Et si quelqu’un croyait encore à la Wehrmacht innocente de tout crime, ce croyance ne dépasse pas la p. 172. Il est difficile de trouver un défaut à ce livre. Il y a des cartes, une très bonne contextualisation, un bon mélange entre faits et analyse et une conclusion qui offre de bonnes perspectives tant historiographiques que politiques, y compris des plus actuelles. Un classique.
In fine, le but de l’auteur est de ne pas se faire dicter l’histoire des terres de sang par Hitler et Staline (p. XVIII).
(une journée de la fin 1941 fait plus de victimes que tous les pogroms russes impériaux additionnés p. 227 … 8,5)
All resistance to fascism was by definition led by communists ; if it was not led by communists, then it was not resistance p. 355.