Ve – VIIIe siècle
Essai d’histoire alto-médiévale de Bruno Dumézil. Existe aussi en format poche.
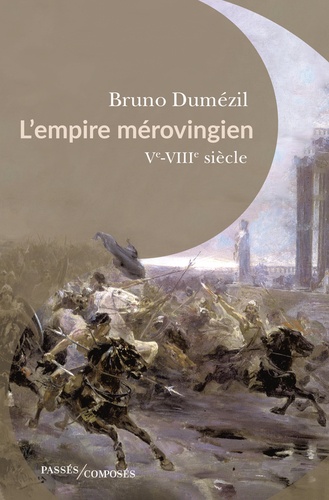
Est-il des souverains moins bien servis dans l’Histoire de France telle qu’elle est enseignée ? Assurément peu. Les Mérovingiens cumulent il est vrai les handicaps : une documentation majoritairement en papyrus quasi intégralement disparue, des successeurs carolingiens qui ont des buts propagandistiques très marqués et plusieurs rois qui règnent en même temps, ne favorisant pas la simplicité (au contraire des premiers Capétiens). Et pour couronner le tout, une image de barbare débarqué des sombres forêts de Germanie qui leurs collent historiographiquement à la peau depuis trois siècles, pour le meilleur (la liberté germanique) comme pour le pire (l’origine de l’aristocratie oppressive et allogène), mettant fin à une romanité elle aussi vue comme intangible (arrêtée au siècle d’Auguste) et monolithique.
B. Dumézil, pédagogue de tout premier ordre, met les choses au clair avec ce livre en procurant au lecteur une base solide, sans masquer les discussions en cours (ou passées), diffusant les apports récents d’autres chercheurs et faisant passer au lecteur un très agréable moment parmi les trois siècles de règne de la dynastie.
Pour inaugurer la progression chronologique, l’auteur se propose de commencer avec quelques notions sur ce qu’est un empire, l’état de la documentation, quelques combats historiographiques passés. Viennent ensuite les quelques informations sur les Francs qui nous sont parvenus du IVe siècle, sur comment une fédération de peuples très divers a donné naissance à une entité connue sous cette dénomination et comment un royaume est né. Tout en sachant que déjà pour Grégoire de Tours, au VIe siècle, il n’est pas possible déterminer qui fut le premier roi (p. 33) … Toujours est-il que Clovis est roi des Francs peu après 480 p.C., agrandit son royaume initialement situé autour de Tournai vers Paris. Son mariage avec la Burgonde Clotilde ne semble pas être de grande importance et il entretient des relations avec la noblesse gauloise du Nord de la France actuelle. Après 500, Clovis fait le choix de se convertir au catholicisme romain, mais semble-t-il sans que cela intéresse beaucoup les évêques gaulois (p. 50). Vers 508, Constantinople a remarqué Clovis en même temps qu’il prend sous sa coupe le reste des roitelets francs des bords du Rhin. A sa mort en 511, Clovis a considérablement agrandi les terres du royaume et bénéficie d’une influence dans toutes les Gaules. Parallèlement, le pouvoir franc, d’abord d’ordre kleptocratique, se bureaucratise peu à peu à l’instar des autres royaumes post-romains méridionaux (en premier lieu Ravenne, p. 54).
Le royaume est divisé entre les quatre fils survivants. Cette pratique, présentée comme le comble de la barbarie par les historiens habitués à un royaume plus monolithique, reprend une pratique romaine qui a déjà cours au IIIe siècle sous la direction de Dioclétien. Chaque sous-royaume (Teilreich en allemand) a des terres au centre du royaume et des marches militaires, domaines de conquête et de tribut (surtout à l’Est, mais aussi au Sud jusqu’aux possessions byzantines en Italie). Des divisions territoriales sont donc crées, mais elle sont temporaires et chacun, c’est à dire la noblesse des leudes, a conscience d’un ensemble supérieur. L’incohérence des blocs renforce cette idée en plus de les soumettre tous à des menaces extérieures (p. 62). Quand Clodomir meurt en 524, les frères survivants se partagent ses possessions (au détriment des trois fils de Clodomir par ailleurs). En 558, il y a de nouveau un royaume unique. Trois ans plus tard, à la mort de Clotaire Ier, un nouveau partage a lieu.
Le troisième chapitre porte un regard acéré sur l’administration des royaumes. Au sud des Gaules, les familles sénatoriales proposent leurs compétences aux rois francs tandis qu’au nord apparaissent des comtes et d’autres personnes en charge du maintient de la paix, aux pratiques sans doute plus basées sur les coutumes provinciales gauloises que le droit savant romain qui avait encore cours au sud de la Loire (p. 88). L’organisation des cités romaines survit et les rois s’appuient sur des élites qu’il s’agit de fidéliser (on peut suivre une carrière, recevoir des honneurs), au-delà de critères ethniques, par ailleurs peu clairs et mouvants. L’administration se centre dans un palais, qui n’est pas forcément le lieu de résidence du roi, abritant une chancellerie qui produit des masses d’écrits.
Le chapitre suivant s’interroge sur la chrétienté du royaume. Clovis lui-même avait peu de temps avant sa mort convoqué un concile et le roi mérovingien nomme les évêques dans le royaume. Pour Byzance, les Francs sont de bons chrétiens, sans aucune différence doctrinale avec eux. Peu bâtisseur lui-même, le roi finance en conjonction avec les leudes des monastères, dont certains sont appelés à devenir très puissants (Corbie) ou avoir une longue relation avec la royauté (Saint-Denis).
Mais il arrive aussi que la succession ne se passe pas de manière souple, avec des leudes qui arrivent à faire passer leurs intérêts tout en plaçant en clef de voûte un membre de la famille mérovingienne. En 568 débute une guerre civile qui va jusqu’au fratricide. Les conflits internes, jusqu’en 613, conduisent à une perte de maîtrise de nombreuses régions périphériques par le centre, y compris du pourtour méditerranéen. Le VIIe siècle est pour l’auteur un monde nouveau (sixième chapitre), où Byzance délaisse l’Italie, arrête ses versements d’or aux Francs et se tourne vers l’Orient. Le monachisme irlandais tel que professé par Colomban est à la mode et devient iro-franc, la noblesse se stabilise (et transmet sa situation à ses enfants bien plus qu’au siècle précédent) en même temps que les identités se recomposent (et que les histoires sur l’origine troyenne des Francs se répandent, avec une traduction onomastique p. 184).
Quand Clotaire II devient roi unique, il lui faut tenir compte de la puissance de la noblesse et de ses aspirations. Quelques petites réformes ont lieu mais beaucoup de la législation (surtout fiscale) des années de guerre civile reste en place. Plus bizarrement, il y a coexistence de différents palais, un par sous-royaume disparu. Malgré ces volontés d’autonomie que le roi doit prendre en compte (mais surtout avec des questions de carrière en arrière-plan), ce dernier reprend sous son contrôle de nombreuses cités grâce à la nomination d’évêques qui lui sont loyaux, plutôt dans les réseaux du monachisme iro-franc que soutient Clotaire II. Il accueille à la cour de jeunes gens qu’il va pouvoir par la suite placer (p. 194) dont le célèbre Eloi, futur héros de chanson. Néanmoins, la circulation des titulaires d’offices est amoindrie. Ceux-ci sont maintenant nommés là ils sont possessionnés, mais ils deviennent par contre justiciables sur leur propre patrimoine en cas de manquement. En 629, à la mort de Clotaire II, lui succèdent Dagobert Ier, qui reçoit la plus grande part du royaume, et Charibert II dont les possessions au sud de la Loire doivent le conduire à aller guerroyer contre les Wisigoths.
Les ennuis commencent à la mort de Dagobert (qui entre temps était devenu seul roi). Les duchés extérieurs se détachent et les rois ne sont pas majeurs, signant le retour des reines-mères sur le devant de la scène. De recomposition en recomposition, la présence de Mérovingiens est toujours indispensable, mais leur pouvoir effectif est de plus en plus réduit, passant à certains de leurs officiers, plus ou moins puissants, peut-être par faute de menace extérieure (p. 256). Mais il ne faut pas voir ici l’inexorable marche des Pippinides vers l’usurpation. D’autres grands ont aussi beaucoup d’influence (les Robertiens poindraient-ils déjà p. 250 ?) et jusqu’à l’onction de Pépin (voir même après), rien n’est assuré pour l’auteur (p.282). Néanmoins l’action de Charles Martel est réelle et avec lui le royaume franc retourne vers des frontières qu’il avait quitté des décennies auparavant (avec une action en interne en mettant la main directement sur des évêchés et en soutenant la mission de Boniface). Au Danemark, en 726, on bâtit même un mur barrant le Jutland pour se prémunir du danger sudiste. En 751, le grand saut est fait. Prétextant une reconnaissance de Rome (et non plus de Constantinople p. 280), Pépin est consacré, un acte que la propagande carolingienne va justifier de nombreuses façons par la suite. Pour effacer l’usurpation d’un royaume, fallait-il ensuite faire advenir un empire ?
Une conclusion de très haute volée clôt de beau volume de 285 pages de texte (suivi des notes et d’un bibliographie que l’auteur a sans doute souhaité limiter). Mais quelle maestria dans ce livre qui se place à plusieurs niveaux interprétatifs, autant que le permettent des sources parfois très rares. Quelques petites touches de débats politiques récents viennent parfois faire un contrepoint, sans envahissement ni leçons de morale, en aérant un propos très bien agencé et de lecture très facile. Un peu d’humour (une référence à Highlander p. 276 par exemple) est mis au service de la pédagogie dans les plus belles traditions médiévistes. Quelques cartes et arbres généalogiques en plus auraient encore augmenté notre bonheur, mais tout ne peut être parfait. Il y avait déjà généreusement de quoi étancher notre soif de belle science historique moderne.
(au tout début du VIIIe siècle, la vacance du trône est un problème pour les Pippinides … 8,5)

