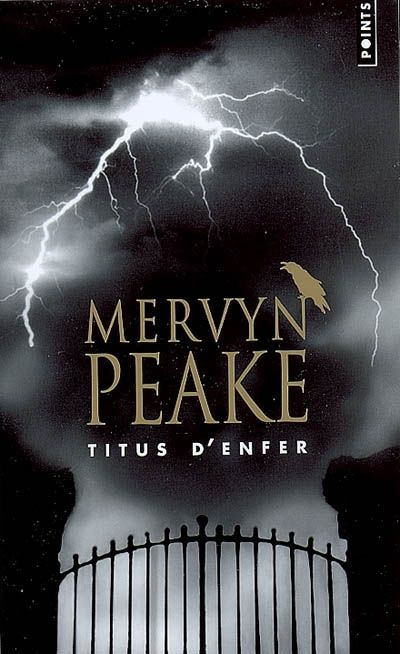Biographie de Dante Alighieri par Alessandro Barbero.
Existe en français sous le même titre.

Tu proverai sì come come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ‘l salire per l’altrui scale.
Tu sauras comme a saveur de sel
le pain d’autrui, et comme est dur chemin
la descente et la montée des escaliers d’autrui.
(Paradis, XVII, 20)
Les personnages marquants de l’Histoire ne flottent pas dans leur temporalité. Socrate l’Athénien était avant tout un citoyen, servant sa cité comme hoplite (dans la Guerre du Péloponnèse), avant d’être philosophe. Dante lui aussi ne s’est pas limité à être un poète et a combattu, comme cavalier, à la bataille de Campaldino de 1289 (et vraisemblablement pas que celle-là), sous haubert et épée à la main, en première ligne même. De même, ces personnages marquants ne sont pas nés vieux. Chez Dante, ce point est particulièrement important, puisque l’un des évènements les plus importants de sa vie intérieure a eu lieu alors qu’il avait neuf ans, quand il vit Béatrice dei Portinari (huit ans, plus ou moins une voisine) pour la première fois et en tomba amoureux (la deuxième fois neuf ans plus tard, il rêve d’elle nue la nuit suivante p.76). Et la Divine Comédie sans Béatrice …
Le livre commence avec cette susdite bataille de Campaldino qui oppose les Guelfes florentins aux Gibelins arétins. Dante y est cavalier, parce que ses revenus le lui permettent (mais pas adoubé, p. 16). Mais plus encore, il est en première ligne pour recevoir la charge des Arétins, avec d’autres cavaliers désignés par les capitaines de sextiers (les quartiers de Florence). Les Florentins sont victorieux. Après cette entrée en matière violente mais qui a le mérite de poser le décor et de donner le ton du livre, A. Barbero s’attache à définir l’environnement familial de Dante, à commencer par son trisaïeul Cacciaguida (né à la fin du XIe siècle), qui semble avoir été chevalier. Puis l’auteur passe à ses ascendants plus directs et comment la famille se gagne un nom de famille (et pas seulement un prénom et un patronyme au sens strict) grâce à son élévation dans la hiérarchie sociale florentine, sans pour autant atteindre les cercles les plus restreints, dit des magnats. Dante est le premier de sa famille à pouvoir vivre de rentes, dans un idéal aristocratique, fruit de l’activité de changeurs de ses ancêtres. Mais Dante n’a pas attendu d’être majeur (et en possession de son patrimoine) pour participer à la vie littéraire florentine. Il échange très jeune des sonnets avec d’autres apprentis poètes et c’est ainsi qu’il se constitue un réseau parmi les cercles dirigeants de la ville (peut-être la plus riche d’Italie, forte de 100 000 habitants). Sa fratrie n’est pas oubliée, comme ses cousins, oncles et tantes. Son éducation se fait auprès de Brunetto Latini, avant d’aller quelques temps à Bologne pour parfaire ses dons (ou pas, puisque qu’il semble que cela ne lui a pas trop plu sur place).
Comme tout homme qui ne se destine pas à la prêtrise ou au monastère, Dante se marie (pour l’auteur en 1292, à l’âge de 28 ans, mais les avis sur la date du mariage sont très divergents parmi les spécialistes) avec Gemma di Manetto Donati. C’est un mariage au-dessus de sa condition qui lui donnera trois fils (Pietro, Giovanni et Iacopo, des prénoms qui ne sont pas dans la tradition familiale) et une fille prénommée Antonia mais qui prendra l’habit sous le nom de … Béatrice.
En matière de politique, là encore rien d’anachronique chez Dante. Comme beaucoup d’hommes florentins (du moins ceux qui n’en sont pas exclus par idéologie ou statut par le gouvernement dit populaire), Dante participe au gouvernement de la ville au travers de sa participation à de multiples conseils et assemblées. Mais un engagement plus poussé lui permet de devenir l’un des douze prieurs (la fonction suprême à Florence) de l’année en 1300. Comme dans toute l’Italie mais pas que, la politique est un sport dangereux et Dante est exilé en 1301 à la faveur de la prise de pouvoir par les Guelfes Noirs (il est du parti des Blancs). C’est le début de vingt ans d’exil. Il ne reverra plus l’intérieur de la ville.
Dans les premiers temps, il milite et combat pour le retour des Bancs au pouvoir. Mais après quelques années, lassé par la compagnie des autres exilés (certains Florentins sont en exil depuis plus de 30 ans !) ou pessimiste sur les chances de succès, il se détache du parti Blanc et cherche la protection de seigneurs à Forli, Pise, Vérone (chez des seigneurs dans les montagnes, puisqu’il est peu en sûreté dans les cités des plaines p. 206), auprès de l’empereur Henry VII venu se faire couronner à Rome, voyage peut-être à Paris, pour finalement s’établir à Ravenne en 1318. A chaque fois il met à leur service sa grandissante gloire littéraire (il est connu dans toute l’Italie à sa mort) mais surtout ses compétences en matière d’écriture politique. Il meurt en 1321, non sans avoir réussi à mettre à l’abris du besoin ses enfants grâce à ses appuis bolognais et ravennates.
Comme nous venons de le voir, cet ouvrage n’a pas pour but de montrer le génie de Dante ni comment il a écrit son œuvre et quelles furent ses sources. A. Barbero veut replacer, comme historien, le Florentin dans son temps et son espace. Et il réussit particulièrement bien, apportant le regard, acéré et parfois avec humour, un peu extérieur de celui qui est certes médiéviste, mais pas spécialiste ni de Dante ni de la Toscane (étonnante diplomatie des reines et comtesses p. 234). Ce qui lui permet aussi avec maîtrise de faire part au lecteur des controverses historiographiques, et ainsi d’expliquer les choix faits. Et cette biographie n’est pas une hagiographie, ne cherchant pas à ajouter une pierre à la statue de l’inventeur de la littérature italienne (et de l’autofiction ?). Dante a-t-il cherché, loin d’un idéal de pureté et de dédain princier, le pardon de Florence pour pouvoir rentrer ? C’est fort possible (p. 202-205, avec une de ses chansons sur ce thème déjà connue du public en 1310). A-t-il fait de l’abus de bien social en tant que prieur ? L’Enfer (chants XXI-XXIII) peut être un aveu, avec des démons tourmenteurs des corrompus qui le poursuivent. De plus, Dante peut varier dans ses choix idéologiques, ou pour le moins dans ses écrits (p. 231).
Et puis il est des choses qui restent traditionnelles en Italie, même avec les siècles qui passent. Ainsi le campanilisme n’est pas mort quand il s’agit de savoir où Dante a séjourné dans ses années d’exil, facilité par le manque de documents (p. 249). Et il peut, comme au XXIe siècle, avoir beaucoup voyagé (p. 252).
Un très bon livre qui se lit avec avidité, une excellente commémoration pour le 700e anniversaire de la mort du poète.
(deux de ses fils commentent son œuvre …8,5)