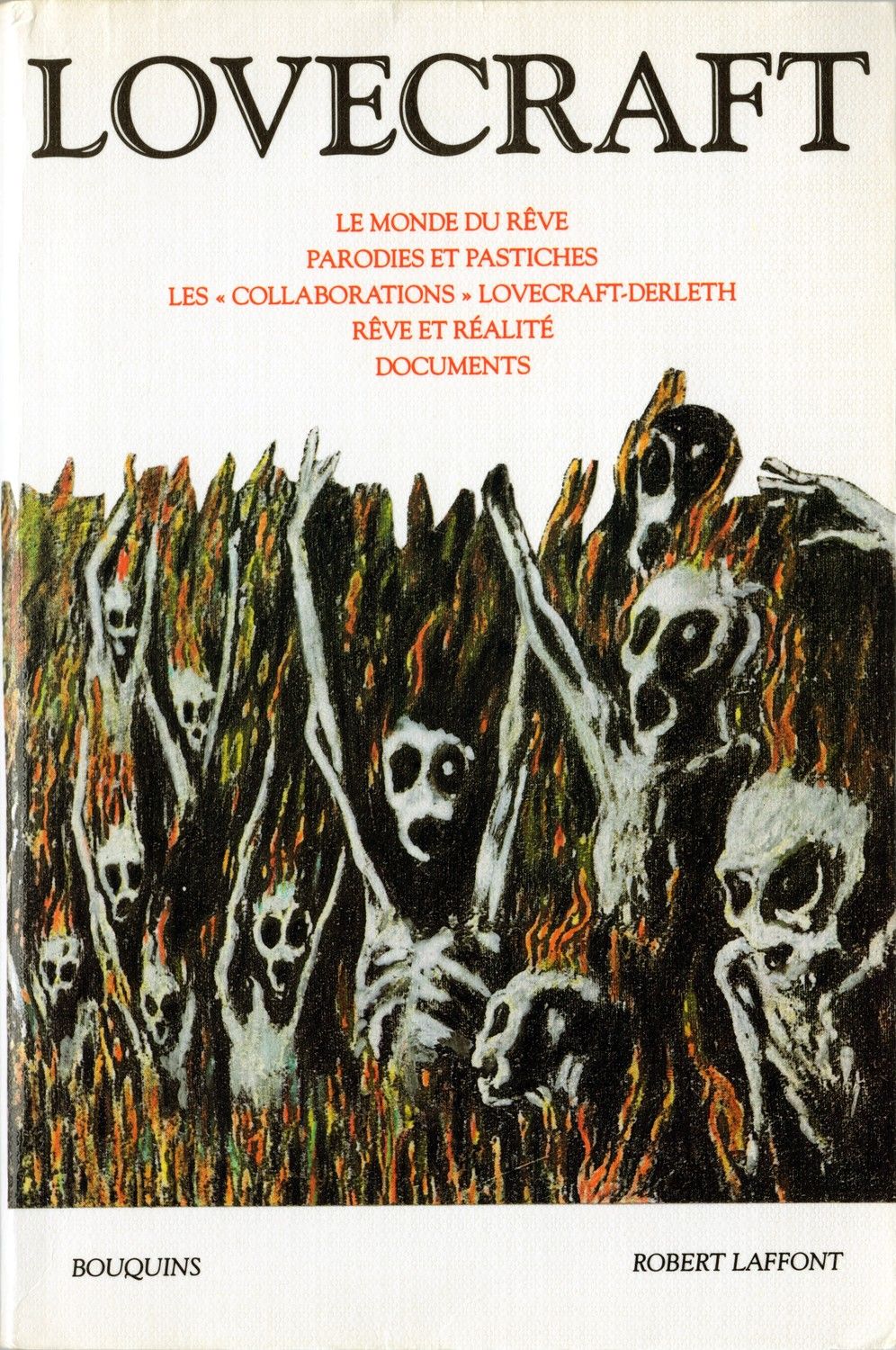Les aventuriers francophones du Nouveau Monde
Essai d’histoire des marges et des aventuriers francophones en Amérique septentrionale par Gilles Havard.

Une fois que l’on s’est échangé des objets entre Français et Indiens (comme l’explique admirablement L’Histoire de la Nouvelle France de Laurier Turgeon), on commence à se parler. Et pour se parler, comme aucun de deux groupes ne devient totalement bilingue, il y a la nécessité d’avoir des traducteurs, des médiateurs, au point de jonction des deux cultures. Ceux qui canalisent le troc des peaux de castor en vivant au sein des groupes indiens sont les plus indiqués pour occuper ces fonctions, mais les profils se diversifient assez vite, entre le jésuite missionnaire et le captif qui revient vers les établissements du Saint-Laurent après avoir appris la langue de sa nouvelle famille (en fuite ou ayant accepté son nouveau statut d’Indien).
Le commerce des peaux reste central pour les francophones, français comme canadiens, qui sont en contact avec les groupes indigènes et qui s’aventurent de plus en plus loin, en remontant le Saint-Laurent, navigant sur les Grands Lacs, descendant le Mississipi, le Missouri et cheminant des mois durant dans la Prairie. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les coureurs de bois qui parcourent le monde indien, les marges de la « civilisation » en Amérique du Nord, parlent le français et c’est ce que montre G. Havard (CNRS) dans ce livre en se basant sur dix portraits d’hommes aux parcours contrastés mais semés de privations, de souffrances, de dangers, de morts, de rencontres, de cadeaux, de rites et de choix de vie.
L’introduction raconte comment l’idée de ce livre est venu à l’auteur. En mars 2007, dans la réserve de Fort Berthold au Dakota du Nord, l’auteur reçoit une ceinture de perle (un cadeau traditionnel) de la main d’un Indien arikara appelé John Morsette, « de Français à Français » (p. 12). C’est là le signe de deux faits culturels distincts et divergents : en France, la vision d’une Amérique du Nord modelée par l’industrie étatsunienne du divertissement, peuplée de cow-boys anglophones de tous temps (en fait, une mythologie de la fin du XIXe siècle, voire début du XXe) et en Amérique du Nord, une topologie et des mémoires familiales qui montrent une prégnance très forte d’éléments français, entre Saint-Laurent et Rocheuses. Et pour montrer l’importance primordiale desdits éléments dans ces très vastes territoires jusqu’au milieu du XIXe siècle et les mondes dans lequel ils s’insèrent, G. Havard se base sur les biographies de dix hommes d’aventure, entre 1564 et le dernier quart du XIXe siècle.
Les premiers cas (Pierre Gambie, Etienne Brûlé, Pierre-Esprit Radisson et Nicolas Perrot) sont nés en France mais sont actifs en Amérique du Nord (en Floride pour le premier, avec une expédition de colonisation décidée par l’amiral de Coligny entre 1562 et 1564). Ils sont principalement des interprètes (des « truchements ») mais gagnent aussi leur vie en faisant commerce. Leur émigration n’est par ailleurs à cette époque (et ce jusqu’au début du XVIIIe siècle) pas un billet sans retour. L’Atlantique n’est pas une barrière et Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, traverse cet océan à 27 reprises entre 1599 et 1627 (p. 61). Les biographies suivantes sont celles de personnes nées en Amérique (le plus souvent au Québec) et qui n’ont plus de liens familiaux avec le royaume, en plus du fait que le traité de Paris (en 1763), faisant suite à la Guerre de Sept Ans, les rend sujets britanniques. Mais en fin de compte, aucun royaume ni aucune république n’exerce sa souveraineté jusqu’au milieu du XIXe siècle dans le Haut-Missouri et les Rocheuses, malgré les prétentions (de toutes façons incomprises des Indiens, p. 193 et p. 414). Celui qui ne s’est pas placé sous la protection d’un groupe en y intégrant une famille (ce qui peut se faire de plusieurs manières) est constamment en danger en pays indien. La guerre elle-même est faite dans le but d’accroitre sa famille (et de montrer son courage), soit par l’adoption des captifs, soit par l’accaparement des femmes (p 102). Et la volatilité de la politique indienne n’aide pas à garder ses possessions ou sa vie …
L’auteur parvient aussi à replacer les expériences de ces coureurs de bois ou de plaines dans la trame de leur époque. Si certains anciens captifs des Indiens écrivent des relations, c’est aussi le cas de ceux qui ont pu quitter leurs ravisseurs du Maghreb au XVIIe siècle (p. 90, dans le cas de Radisson) et si certains actes de soins corporels ritualisés ou l’animisme (des Hurons par exemple, p. 57) nous semblent aujourd’hui étranges, ils étaient beaucoup moins éloignés de ceux que connaissaient des Français ou des Canadiens de l’époque moderne (p. 187 et p. 210).
G. Havard réaffirme à plusieurs reprises que cet effacement de l’héritage français au cœur de l’Amérique du Nord doit beaucoup à la volonté étatsunienne, dont la Destinée Manifeste ne s’accommode pas de prédécesseurs qui n’ont pas le bon goût d’être anglophones. Sans les Indiens et leur guide français Toussaint Charbonneau, jamais Lewis et Clark n’auraient atteint le Pacifique et pour l’auteur, c’est un ressentiment présent à Washington. Dans la culture populaire, ce même T. Charbonneau n’a pas le plus beau rôle (p. 341). Est-ce la jalousie ? T. Charbonneau a voyagé avec sa femme indienne tout du long (p. 353) … L’auteur détaille aussi à de nombreuses reprises les effets sur les populations et la faune de l’expansion vers l’Ouest et du commerce des peaux : la baisse du nombre de bisons est constatée par les praticiens du pays indien (après le castor) et n’a rien d’un phénomène soudain (p. 431) tandis que la population indienne disparait à 90% à cause des épidémies (p. 315).
Cette galerie de personnages permet à l’auteur de s’interroger sur la conception de la virilité des coureurs de bois (une thématique présente dans chaque chapitre) et comment l’Ouest permet une démocratisation de l’équitation (d’autant plus recherchée par les Indiens que cela rencontre l’idée d’élévation des chefs en plus d’un démultiplicateur de locomotion, p. 311). Les derniers chapitres montrent le déclin de la langue française dans l’Ouest, puisqu’il semble que Saint-Louis-des-Illinois ne parle plus français majoritairement en 1850, sur fond de mouvement nativiste (p. 445). Il y a sur place une claire fossilisation folklorique dès 1847 (p. 467). Dans la Plaine, le français reste la lingua franca encore quelques années (les caravanes de marchands dans les Rocheuses le sont à 90% en 1834, p. 426).
Le volume est doté d’un cahier central d’illustrations en couleurs en plus de nombreuses illustration monochromes dans le texte. Une carte, essentielle, ouvre chaque nouveau chapitre. Un glossaire des peuples autochtones, les notes fournies, une bibliographie conséquente et un index rajoutent du poids à 500 pages de texte très renseignées. Si parfois certaines informations sont « éclatées » entre différents passages (sur le fonctionnement des bateaux à vapeur sur le Missouri et leurs voyages de deux mois par exemple p. 440), l’auteur réussi à merveille à rendre vivants ses personnages, parfois peu sourcés directement, en abreuvant avec constance et à propos le lecteur d’informations permettant de comprendre et l’homme et son monde, une quantité que nous ne pouvons que très imparfaitement rendre ici. Que de gens aux parcours virevoltants et parfois même improbables, comme Jean-Baptiste Charbonneau (le fils de Toussaint), métis indien et filleul de W. Clark, locuteur d’au moins six langues, éduqué en Europe et chasseur dans les Rocheuses !
Une réussite qui se dévore comme les meilleures parties d’un castor après deux semaines de voyage sans nourriture sous la neige.
(il y a une certaine émotion dans cette introduction … 8,5)