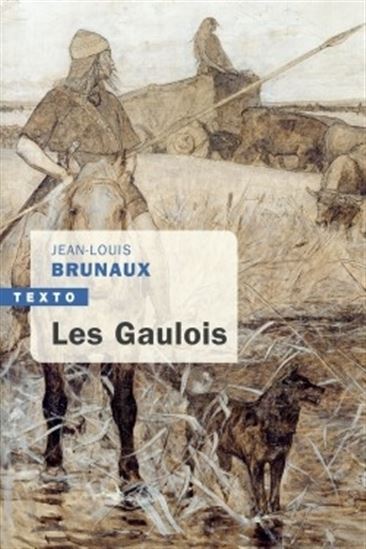Essai d’histoire antique, d’historiographie et de linguistique par Bernard Sergent.

La question des origines étrusques, un sujet très fortement débattu par les savants du XIXe siècle au milieu du XXe siècle (et à la suite des Romains et des Grecs), était sorti du devant de la scène étruscologique. L’archéologie avait fini par ouvrir d’autres perspectives, entre sanctuaires portuaires (Pyrgi), villes évanouies (La Doganella), palais ruraux (Murlo), les lacs dévotionnels (Monte Falterona, Monte Bibele), établissements lagunaires (Spina) et nécropoles diverses. Etait-ce pour autant une thématique totalement oubliée ? Pas non plus, puisque plusieurs études portant sur du génome ancien et contemporain (à Murlo justement) avaient à partir des années 1980, puis plus récemment en 2017 et en 2021, tenté de régler la question. Malheureusement, les études se contredisent, entre origine anatolienne et ADN identiques aux Latins … Qui parlait de sciences exactes déjà ? B. Sergent ne trempe pas dans ce genre de marécage. Mythologiste comparatif et linguiste, il reprend l’ascension par le versant des sources anciennes, de la linguistique et de la logique pour proposer au lecteur un développement en plusieurs étapes géohistoriques, passant des Etrusques aux Tyrsènes aux migrations mesopotamo-caucasiennes du second millénaire avant notre ère.
Le premier objectif de l’auteur est de faire aux yeux du lecteur revenir les Etrusques dans l’ensemble des Tyrsènes dont la présence est attestée dans de nombreux endroits du pourtour méditerrannéen. A l’île de Lemnos, bien connue par sa stèle en langue « etruscoïde » (l’auteur la commente longuement), il faut ajouter la Crète, l’Attique, la Laconie ou l’Anatolie. Après un petit excursus sur Pythagore, le plus célèbre des Tyrsènes, B. Sergent veut démontrer la communauté de culture entre les Etrusques et les Tyrsènes en abordant plusieurs thèmes : la navigation, les jeux, la prévalence de la fédération, la place des femmes, entre autres. Le second objectif est ensuite de démontrer, principalement à l’aide de la logique, que le mouvement étrusque ne s’est pas déroulé d’Ouest en Est (si l’on considère la stèle de Lemnos datée de la fin du VIe siècle a.C. comme un dialecte étrusque) mais d’Est en Ouest, de l’Egée vers la Tyrrhénienne.
Le troisième objectif, une fois la connexion orientale acceptée (bien au-delà de la période dite orientale de l’art étrusque), c’est de mettre en relief les traits orientaux des Etrusques, tant ses aspects grecs (céramiques, masques funéraires) qu’anatoliens (brontoscopie, lituus, vêtements) ou encore mésopotamiens (hépatoscopie, démonologie, vierges rituelles ou musique, parmi d’autres).
Ceci fait, B. Sergent s’attaque à la migration vers l’Italie. Les Etrusques firent-ils partie des Peuples de la Mer qui attaquent l’Egypte ? Sont-ils les Phéaciens de l’Odyssée ? Que pensèrent les auteurs antiques de la migration étrusque ? L’Énéide est-elle une épopée étrusque (p. 276) ? Et par là même, les Dardaniens d’Homère ? Telles sont quelques unes des questions que se pose l’auteur, et auxquelles, la plupart du temps, il aurait des réponses. Et des questions il en a aussi à présenter aux savants qui interprètent la culture villanovienne comme pré-étrusque, auxquels il reproche de ne pouvoir expliquer les différences d’aires où les deux cultures sont présentes et comment se fait le passage des tombes à caissons aux tumulus monumentaux. Pour B. Sergent, la thèse de l’autochtonie ne tient pas et les Tyrsènes ont conquis la Toscane à la fin du Xe ou au IXe siècle (le premier siècle étrusque ne commence-t-il pas en 967 a.C. selon ce que nous dit Censorinus, De die natali 17, 6 ?), dominant et repoussant les populations indo-européennes (peut-être déjà ombriennes), pour devenir les Etrusques.
Le point d’arrivée étant déterminé, quel était alors le point de départ ? Dans le dernier chapitre, B. Sergent retrace une migration des Tyrsènes (aux dénominations et sous-groupes mouvants) sur plusieurs siècles et en plusieurs vagues à l’aide de la linguistique, qui serait partie du Caucase oriental, avec une période de contact prolongé avec la Mésopotamie, une lente traversée de l’Anatolie (avec indo-européanisaton partielle) et une dernière étape en Lycie et en Crète (p. 432). Les seize raisons pour une origine anatolienne des Etrusques finalement listées par l’auteur dans la conclusion (p. 427-430) emporteront-ils l’adhésion de tous ?
Le ton est donné dès l’introduction : B. Sergent a choisi l’offensive. Et cette coloration assertive, l’auteur la tient de bout en bout. La prudence, la possibilité que les choses ne soient pas comme on aimerait qu’elles soient, tout cela n’aura pas droit de cité dans ce livre. Surtout, l’auteur poursuit de sa vindicte les « fixistes », les savants qui selon lui refusent la possibilité d’une migration étrusque et adhèrent cœur et âme à la thèse de l’autochtonie exposée par Denys d’Halicarnasse (tous dans le même sac faut-il ici ajouter). Les fixistes, c’est même une fixette.
Au delà du ton (et des bons et mauvais points allégrement distribués comme aux p. 62-63), B. Sergent propose de beaux défis, de ceux qui poussent le lecteur à se poser de bonnes questions. Parmi celles-ci, il y a au tout premier plan la raison de l’émergence de sépultures monumentales, seulement comparables à l’Egypte. Mais on peut aussi se poser la question du pourquoi du passage au plan droit des maisons en Italie à la période archaïque … Les arguments de B. Sergent sont malheureusement de temps à autres amoindris par des erreurs factuelles qui font très mal aux yeux, des énormités parfois, dont nous pensons que la présence dans le texte est due à deux facteurs. Le premier est une absence de relecture professionnelle et indépendante, qui a aussi laissé passer un peu partout des phrases sans signification ou des entrées bibliographiques qui doublonnent. Le second est que B. Sergent, s’il est sans conteste un linguiste chevronné et un antiquisant d’expérience (ah ces translittérations « dures » !), n’est pas un étruscologue. Et du coup, entre autres choses, Cosa (colonie romaine fondée en 273) se retrouve comme port de Vulci p. 92 et Volterra accueille le sanctuaire fédéral p. 75. Plus grave, la méconnaissance de la présence d’inhumation et de crémation en Etrurie invalide des développements.
La trop grande confiance accordée à Théopompe (l’auteur athénien qui affirme que les femmes étrusques ne connaissent pas les pères de leurs enfants à cause des orgies, alors que l’on a des exemples de généalogies étrusques qui courent sur des siècles) est un choix d’analyse de l’auteur mais l’ignorance des cas de changements de sexe ou d’âge chez certaines divinités étrusques (sur ce point N. Thomson De Grummond ici par exemple) pourrait être opposable à un spécialiste revendiqué. Certaines références manquent aussi en notes (Plaute p. 102) …
Il y a donc des choix d’analyse que tous ne suivront pas. Mais si l’on s’éloigne de l’Italie et des artefacts archéologiques, le lecteur est renseigné de manière précise sur les relations entre les mots Tyrsènes et Tusci (p. 128-129), sur la ville comme templum (p. 202-203), les Phéaciens comme peuple idéal (p. 228-235) ou sur la démonologie mésopotamienne (p. 187). Même si certaines filiations à plusieurs siècles de distances entre deux cultures peuvent paraître tirées par les cheveux (p. 148-149), les similarités peuvent interpeller, comme la toponymie tyrsène en Crète. Le linguiste montre aussi toute sa force avec les hydronymes toscans (p. 325) mais nous ne partagerons pas toutes les conclusions avec la même ferveur.
B. Sergent a pu montrer une chose avec ce livre stimulant contant les ellipses des Tyrsènes sur toutes les côtes méditerranéennes, rappelant des questions perdues de vue, avec ses pépites, ses chaînes causales fragiles et ses erreurs flagrantes : l’étruscologie a encore un avenir et encore beaucoup de choses à découvrir. Toute aide est bienvenue.
(dans ce livre, absolument tout doit faire sens et pointer dans une direction … 5,5)