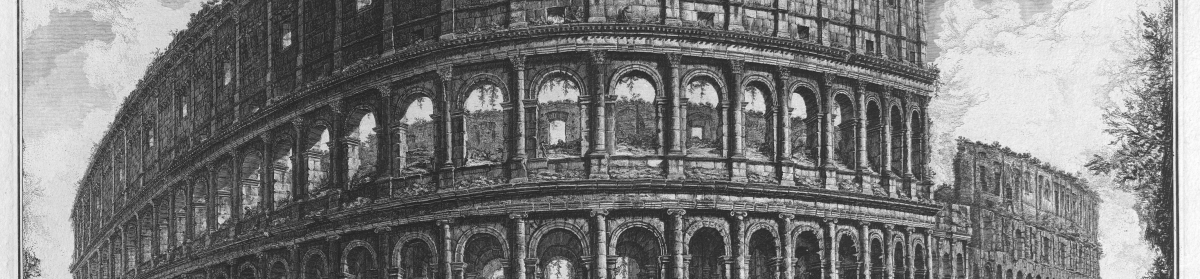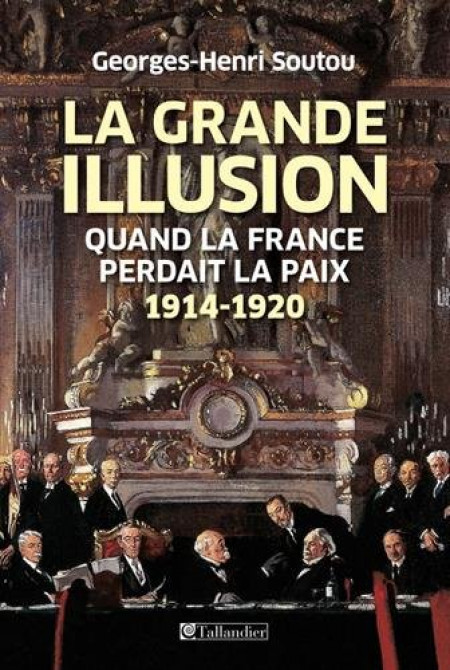Early Arab-Israeli Negotiations
Essai d’histoire diplomatique d’Itamar Rabinovich.
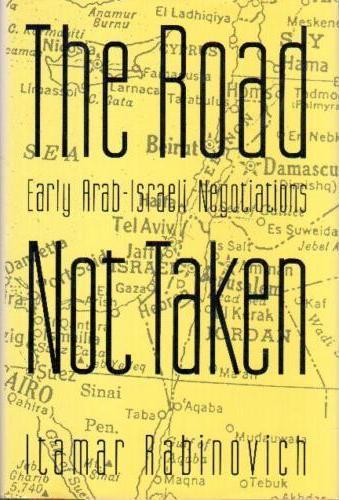
La première guerre israélo-arabe, celle qui va de 1947 à 1949 avec en son milieu la déclaration d’indépendance israélienne, s’achève par une victoire israélienne. Les armées égyptiennes, transjordaniennes, syriennes et irakiennes sont mises en échec et des armistices sont conclus. Le nouvel Etat est le seul constitué sur la partie occidentale de la Palestine Mandataire et il a pris possession de territoires lui permettant de jouir d’une continuité territoriale, même si certaines parties sont peu vastes et difficilement défendables. Si la Mer Rouge est atteinte au sud du Negev à Eilat, Jérusalem n’est que très partiellement sous contrôle israélien et la Vieille Ville ne l’est pas du tout, comme la Judée-Samarie. Les différentes parties en présence se posent alors la question de la pérennisation de l’état de guerre (les armistices conclus à Rhodes) ou de l’établissement consenti d’une nouvelle normalité consacrée par un traité de paix. Les puissances extérieures seraient favorables à un règlement global sanctionné par l’ONU, mais les adversaires prennent contact les uns avec le autres en attendant la réunion de Lausanne, au travers de canaux de communication qui pour certains existaient déjà dans les années 1930. Peut-être y-a-t-il moyen de trouver un meilleur arrangement en agissant plus tôt et de faire accepter sa vision du compromis au dépend d’autres …
Laissant de côté les Irakiens qui ne sont pas en contact direct avec les forces israéliennes, I. Rabinovich bénéficie de l’ouverture des archives israéliennes et occidentales dans les années 1980 (l’aspect majoritairement partiel des sources n’est évidemment pas nié par l’auteur) pour détailler les contacts, les échanges de vues et les débuts de négociations entre Israël et les pays arabes limitrophes. La première partie est consacrée aux discussions avec la partie syrienne, intéressée par des changements de frontières du côté du lac de Tibériade mais qui n’est pas hostile à accueillir des centaines de milliers de réfugiés arabes. Mais les soubresauts de la politique intérieure syrienne, dont les coups d’Etat à peu d’intervalles ont des répercussions sur la politique extérieure, empêchent cet arrangement : Housni Al-Zaim, premier militaire à prendre le pouvoir au Moyen-Orient, ne reste à la tête de la Syrie que quelques mois en 1949.
La situation est différente en Transjordanie, royaume aux mains de la dynastie hachémite. Le roi Abdallah connaît les dirigeants du Yichouv depuis de nombreuses années (p. 45-46) mais il est aussi guidé par une politique dynastique visant à la constitution d’une Grande Syrie et à chasser les Saoud d’Arabie. Si le roi veut par traité la reconnaissance de l’occupation jordanienne de Jérusalem et de la Judée-Samarie (en plus d’un port sur la Méditerranée et sa voie d’accès), il est en décalage avec les vues de son gouvernement, plus aligné sur les positions de la Ligue Arabe. Les Israéliens pensant avoir à faire avec un potentat absolument omnipotent en sont pour leurs frais (p. 133). Mais de l’autre côté, la Cisjordanie, de facto intégrée au royaume, n’est pas qu’une marche pour avancer en Syrie, elle fait entrer dans le jeu politique jordanien plus de Palestiniens encore (ils sont déjà nombreux au début des années 1940) et rajoute de l’instabilité (p. 150). Le prix de la paix est finalement trop élevé pour toutes les parties …
Dernière partie et dernier pays considéré, l’Egypte. C’est clairement la plus grande puissance régionale et de loin la plus peuplée. Pendant la guerre, elle a pu s’emparer de Gaza, mais elle aussi a de grandes difficultés à définir une politique, partagée entre sa volonté d’hégémonie et donc de consensus au sein de la Ligue Arabe et celle de ne pas s’engager trop dans ce conflit, finalement lointain et distrayant le royaume dans son conflit avec le Royaume-Uni (et ses problèmes internes, notamment socialistes et islamistes). Gaza n’est par exemple jamais rattachée au royaume, juste administrée. L’Egypte souhaiterait le Negev, surtout pour qu’aucune base britannique ne puisse s’y installer (sous couvert du traité avec la Jordanie et devant participer à la défense de la région contre l’URSS et proche de Suez). Au moment du coup d’État de 1952 qui porte Nasser au pouvoir par la suite, les discussions avaient déjà été abandonnées et les termes de l’armistice continuent de régir les relations israélo-égyptiennes, à la satisfaction de tous, et laissant les acteurs privés libres de leurs mouvements. Et la Palestiniens dans tout cela ? Pour tous les pays arabes les Palestiniens n’existent pas et les territoires qui auraient été les leurs sont des proies pour leurs voisins. Ni l’Egypte ni la Jordanie ne veulent entendre parler d’une Palestine (p. 191). Les réfugiés le restent non parce que les gouvernements le souhaitent absolument mais parce que les opinions publiques sont bien plus en faveur de la guerre que ne le sont les gouvernants. Si Israël dit accepter un retour (dans le cadre de concessions pour un accord de paix), c’est surtout pour donner des gages aux Etats-Unis, en pointe sur le retour des populations. Israël, qui souhaitait la paix pour pouvoir favoriser l’immigration et l’intégrer, obtient une paix armée et si les gouvernements arabes pensent au « match retour », celui-ci n’a lieu qu’en 1967. Chaque acteur a alors mis à profit les vingt ans entre les deux conflits pour se renforcer et le conflit de 1967 n’accouche pas d’un résultat aussi équilibré qu’en 1949.
Cet ouvrage est l’œuvre d’un praticien. I. Rabinovich a dirigé les négociations de paix avec la Syrie pour la partie israélienne au début des années 1990 avant d’être ambassadeur aux Etats-Unis, le tout en parallèle d’une carrière universitaire. Il sait l’avantage de connaître ses interlocuteurs (ce qui manque au début des années 50, p. 177). Aurait-il pu écrire un livre différent 35 ans après la publication ? C’est assez peu probable, puisque les sources du côté arabes ne semblent pas aujourd’hui plus accessibles qu’à la fin des années 1980. Avec le matériel à disposition mais aussi en se plaçant dans le débat historiographique israélien (qui n’a pas attendu le XXIe siècle pour voir apparaître des analyses très critiques de la politique israélienne, p. 9), l’auteur peut tout de même décrire les différentes étapes des négociations, alors qu’au tout début des années 50 le gouvernement israélien croit tout a fait possible une paix prochaine avec ses voisins, y compris au prix de quelques concessions territoriales mineures. Si les pays arabes ne sont pas unis, les différents groupes participants aux décisions du gouvernement israélien ne sont pas non plus tous sur la même longueur d’onde, le Ministère des Affaires Etrangères étant parfois le dernier au courant de ce qui se discute (p. 36-42).
Les notes sont assez peu nombreuses, la bibliographie plutôt courte et une petite carte sur la situation des forces sur le terrain en 1949 avec les différentes propositions d’accords n’aurait pas été de refus. Néanmoins, et malgré la sécheresse difficilement évitable de ce genre de récit, la lecture est assez aisée sans devoir être préalablement un spécialiste du sujet. Si les positions britanniques et étatsuniennes sont expliquées et commentées, il est peu de choses sur la politique française qui pourtant gagne en influence dans les années 1950, au point d’organiser conjointement l’opération sur Suez en 1956. Mais là encore, les sources …
Il est des situations qui conviennent à tout le monde. Enfin, ceux qui ont un pays.
(Abdallah et Ben Gourion s’écrivaient en turc … 7,5)