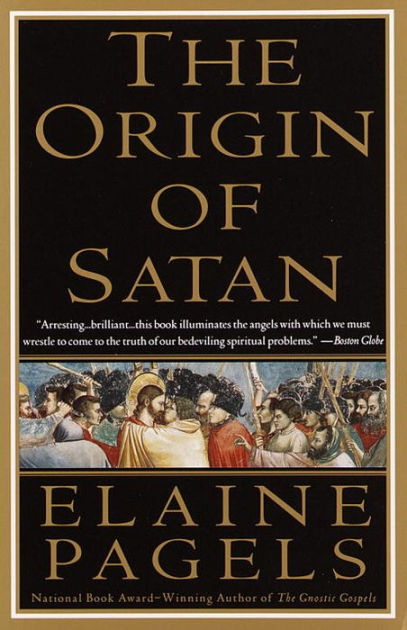Essai d’histoire de l’art de Norbert Wolff.

La grande majorité des confessions chrétiennes, tant en nombre d’églises qu’en nombre de croyants, admettent l’existence de saints en tant que personnes exemplaires dans la Foi ou comme auteurs de miracles et intercesseurs. L’apparition de la représentation graphique de ces saints est très ancienne elle-même, tout en ayant à l’esprit que les tendances à l’aniconisme (existant chez tant d’autres religions antiques) sont présentes depuis le début et réapparaissent en pleine lumières de temps à autres : crise iconoclaste (et pas uniquement dans le christianisme oriental p. 109), Réforme, Révolution française.
Sur une période aussi longue, il est bien naturel que les sujets et la manière de les représenter évoluent, parallèlement aux différents types de saints qui émergent. Certains éléments cependant restent constants sur presque toute la période considérée dans leur représentation : tremendum et fascinans. Les saints ne sont plus uniquement créatures terrestres et à ce titre, en même temps, ils fascinent et sont craints.
Le présent livre suit un déroulement chronologique mais ses premières pages sont consacrées à quelques réflexions sur la sainteté et sur sa place dans une sorte de hiérarchie divine. Puis l’on passe à des figures saintes aussi dissemblables dans les premiers siècles du christianisme que Pierre et l’empereur Constantin (accompagné de sa mère Hélène). Ceci permet de rencontrer la première catégorie de saints, parmi toutes celles que ce livre présente : le saint pape (avec les grands évêques et théologiens). Il y a certes Pierre, mais la liste est plutôt fournie allant de Grégoire le Grand à Jean-Paul II.
La catégorie suivante, très présente aux débuts du christianisme mais qui persiste de nombreux siècles (et peut-être même jusqu’à nos jours), est celle des martyrs. L’auteur détaille en particulier Laurent, Stéphane et Ursule. Cette dernière lance toute une économie à Cologne, due aux milliers de martyrs qui auraient accompagné cette dernière et qui y seraient morts. Les moines forment une autre catégorie (Patrick, Bernard de Clairvaux) abordée par N. Wolff, y compris ceux vénérés à Byzance dont les fameux stylites à l’érémitisme vertical.
Suivent les saints empereurs (Otton III) et les saints nationaux, personnages de rang royal qui en général établissent ou introduisent le christianisme dans leur pays et l’unifient par ce moyen. Les scandinaves (Knut, Olaf, Erik) sont assez connus mais Venceslas en Bohême et Stéphane en Hongrie leurs sont antérieurs. Charlemagne et Louis IX (concept de sainteté du sol du royaume de France p. 129) ne sont pas oubliés.
Le saint chevalier bénéficie aussi de nombreux exemples expliqués dans le livre (Maurice, Théodore et bien sûr Georges), comme son pendant féminin redistributeur (Elisabeth de Thuringe). Les mystiques (Hildegarde, Catherine de Sienne ou encore Brigitte de Suède) sont étroitement associés aux villes en plein développement au milieu du Moyen-Age (qui elles mêmes se cherchent des saints-patrons dans le but de s’affirmer politiquement p. 189), comme les saints fondateurs des ordres mineurs.
N. Wolff évoque aussi la privatisation des saints (p. 223), avec des saints aux vies irréalistes mais aux pouvoirs dits protecteurs (encore aujourd’hui …) comme Christophe. La Réforme vient secouer tout cela, mais la cassure n’est pas toujours si nette, puisque certains libelles luthériens parlent des capacités ignifuges de portraits de Luther brûlés par ses ennemis (p. 239). Le genre de miracles opérés justement par des images de saints … Néanmoins la Réforme met un coup d’arrêt aux canonisations (processus presque totalement sous contrôle du Saint-Siège à cette époque), puisqu’il n’y a aucune nouvelle canonisation entre 1523 et 1588. Il y aurait sans doute eu matière, les guerres de religion ayant produit pas mal de martyrs, a priori candidats à la canonisation. Ces derniers ne seront que deux jusqu’en 1767. La Contre-réforme se traduit aussi en terme de sainteté par la canonisation de jésuites (Ignace de Loyola, François-Xavier), ces derniers utilisant tant le média graphique que le théâtre à fin de mission.
La fin de la période moderne voit un renouvellement de la représentation de saints sur fond de baroque. L’auteur s’attarde particulièrement sur Florian, Jean Népomucène mais aussi la construction de « paysages sacrés » avec sculptures dans des parcs. Le XIXe siècle voit le romantisme atteindre aussi la représentation des saints et une réinterprétation sur ces mêmes thèmes de l’esthétique médiévale (préraphaélisme), sans la fascination et la peur, dans une nouvelle Arcadie bordant à la muséalisation (Jeanne d’Arc d’Ingres p. 326). Enfin, le XXe siècle va remplacer progressivement le saint par l’artiste, couplé à des représentations beaucoup plus critiques, que ce soit à l’encontre des saints eux-mêmes ou de l’Église. Le volume s’achève sur des commentaires (il n’y a pas de notes et les citations sont attribuées sans références dans le texte) et un index.
Ce livre souffre de sa première qualité. Vouloir conduire une étude sur une aussi grande étendue chronologique amène forcément à passer très rapidement sur beaucoup de choses si l’on veut rester dans un nombre de pages raisonnables pour un public lettré mais pas spécialiste (il y a 340 page de texte). Sur beaucoup de sujets (les jésuites par exemples, mais de manière plus générale la période moderne), on sent que l’auteur se freine. Autre qualité, mais sans inconvénient cette fois-ci, le livre est très richement illustré et presque chaque œuvre dont il est question en détail est illustrée, en noir et blanc ou en quadrichromie.
Le livre est européocentré et il aurait été intéressant d’avoir plus d’exemples tirés du christianisme oriental, africain ou américain. L’auteur a aussi quelques difficultés avec l’Antiquité, où Rome n’est pas toujours la capitale de l’Empire romain (p. 33) et où Néron est toujours l’incendiaire (p. 274). Qu’il y ait 50 % d’urbains en Italie et en Flandres au XIe-XIIe siècles est douteux aussi (p. 188). Il y a donc quelques erreurs, contrebalancées par de très bonnes analyses iconologiques.
Une balade plaisante, pas très structurée, mais avec de très nombreux belvédères et des cristaux de roches de-ci de-là.
(Catherine de Sienne, brut de décoffrage p. 199 …7)