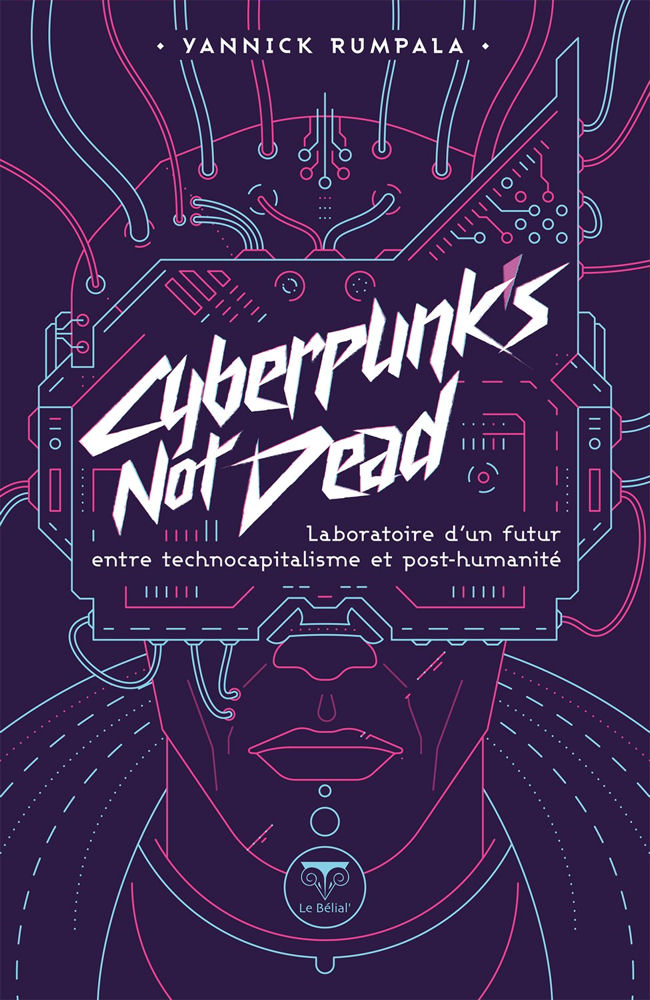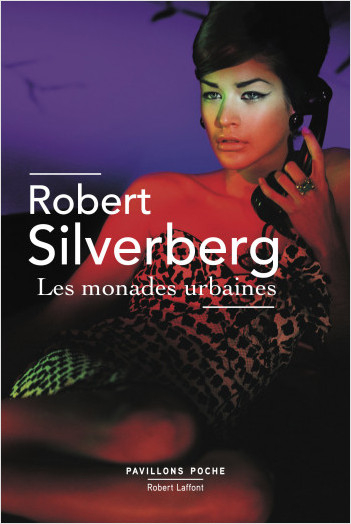Rapport final de prospection archéologique pluriannuelle constantinopolitaine par Ken Dark.

Une ancienne capitale impériale recèle toujours de grandes quantités de restes de bâtiments disparus et Istamboul ne fait pas exception à cette règle. Ken Dark et Ferudun Özgümüş (et leur équipe avec eux) ont donc parcouru les rues et les places de l’ancienne Constantinople à la recherche d’artefacts romains et byzantins pour documenter leurs trouvailles et ainsi augmenter la connaissance urbanistique de la Seconde Rome. Jusque-là les archéologues, du cru comme étrangers, s’étaient attelés à l’étude de monuments bien précis mais pas à toute une aire urbaine. Leurs campagnes de prospections, entre 1999 et 2004, sont une première pour Constantinople. Le centre ancien, à l’intérieur des murs de Constantin étant le mieux connu et ayant déjà été parcouru par bouts, le projet s’est donné pour limites la zone entre les murs, entre celui de Constantin (IVe siècle) et celui de Théodose II (Ve siècle). La zone n’est pas petite mais contient encore aujourd’hui, bizarrement, quelques champs (le projet a donc effectué la toute première prospection agreste constantinopolitaine !).
L’auteur propose tout d’abord au lecteur une introduction dans son premier chapitre portant sur les différentes phases de l’archéologie du tissu urbain à Constantinople (et l’importance du terrassement dans le tissu urbain). Ensuite est présenté le projet dont le présent livre est le rapport final : son histoire, son organisation et les méthodes employées (le problème de la datation des artefacts et de la caractérisation des activités humaines laissant des traces y est bien sûr abordé). Le troisième chapitre est le premier de l’étude proprement dite, avec la partie sud de l’espace intermural. Cette partie méridionale est elle-même réparties en deux rues principales, nord et sud. Cette dernière reliaient la Porte Dorée de Constantin à la Porte Dorée de Théodose, dans ce que l’auteur pense être une extension du Mese, la voie monumentale du centre de Constantinople. La monumentalisation y est très prononcée, entre églises et constructions impériales (p. 46) et doit impressionner le visiteur. Le chapitre suivant poursuit assez logiquement l’analyse avec la partie nord de la zone étudiée par le projet, y compris dans le très connu monastère de Saint Sauveur in Chora.
K. Dark porte ensuite une attention plus prononcée sur deux lieux importants de la Constantinople byzantine dans les deux chapitres finaux de son livre. Le cinquième chapitre passe en revue les découvertes faites au palais de Blachernes, collée à la Corne d’Or et donnant sur les fortifications de la ville. Le palais de Blachernes a pour origine l’église de la Vierge de Blachernes, important lieu de pèlerinage hors les murs abritant entre autres reliques la ceinture de la Vierge. Cet établissement religieux est intégré dans les défenses de la ville et un complexe impérial est bâti à coté. Ce palais est est le principal palais impérial dans les 500 dernières années de la période byzantine. Et malgré sa réputation, tout est très loin d’être clair dans l’organisation des lieux et ce à quoi pouvaitt ressembler les différents édifices de la zone. L’auteur tente d’apporter son aide sans pouvoir définitivement trancher la question à l’aide d’artefacts non encore publiés et d’analyses détaillées. Le second lieu scruté plus en détail dans ce livre, au même niveau symbolique, est l’église des Saints-Apôtres. D’abord mausolée de Constantin, une église lui est adjoint par son fils Constance II et cette église devient le lieu d’inhumation des empereurs jusqu’au XIe siècle (et son symbolisme s’exporte jusqu’à Paris …). L’église est détruite en 1461 (elle était déjà partiellement ruinée) pour permettre la construction sur le site de Fatih Camii, la mosquée du conquérant, dans laquelle Mehmet fera construire sa tombe (et se désignant ainsi comme successeur des empereurs). L’auteur entreprend de retrouver les traces encore visibles des églises sous la mosquée et sur la terrasse afin de prouver la reprise du plan et des fondations (p. 94) par les constructeurs ottomans. Un puits sacré byzantin y est même encore en usage aujourd’hui (p. 96,le seul autre cas connu dans une mosquée à Istamboul étant Sainte Sophie).
Le dernier chapitre est une prise de hauteur, une systématisation des découvertes faites lors des prospections. L’auteur y analyse la densité possible du bâtit à partir des résultats de la prospection dans la zone considérée, concluant à de fortes disparités entre rues animées et cimetières. La présence de citernes, le type de construction collective le plus commun à Constantinople, n’est pas forcément antérieur à une densification d’une zone. Les citernes à ciel ouvert, dont certaines sont juste gigantesques, devaient avoir une fonction agricole (p. 103). Les établissements religieux de tous types sont bien plus structurants dans ce qui devient une sorte de seconde Jérusalem.
Le volume est complété par deux appendices sur la première phase de la construction de Fatih Camii et sur l’église de Zoodochos Pege, avant de laisser place au catalogue des découvertes faites dans le cadre du projet, aux cartes localisant ces découvertes, à une bibliographie massive et un index.
Fatalement c’est aride comme lecture et demande une très grosse base de connaissance en byzantinologie. Méthodologiquement, c’est très intéressant et la manière dont l’auteur se confronte au problème d’un site « trop connu » par les sources littéraires (biais de confirmation) est fort intéressant. C’est aussi de la prospection urbaine que l’on ne peut bien évidemment pas faire partout. Les participants au projet passent dans toutes les rues, parlent aux habitants, sont conduits à des artefacts ou ne peuvent voir ces derniers qu’en coup de vent dans des conditions pas faciles. L’aspect légal et de conservation revêt aussi une grande importance dans le livre. Ce dernier rappelle aussi que de nombreuses églises constantinopolitaines ont été construites après 1453. Pour le côté formel, une relecture supplémentaire aurait fait le plus grand bien à l’ouvrage et l’absence de cartes de situation (ou de schémas) au début des chapitres descriptif se fait cruellement ressentir. Quelques photos dans le texte auraient grandement aidées à la compréhension des descriptions.
Le titre du livre est légèrement mensonger (nous aurions eu quelque chose de vraiment plus gros entre les mains) mais apporte beaucoup au lecteur déjà intéressé qui y trouvera des apports méthodologiques de première importance.
(le bain byzantin de Sofular Hamamı est toujours en usage en 2013 p. 50 … 6,5)