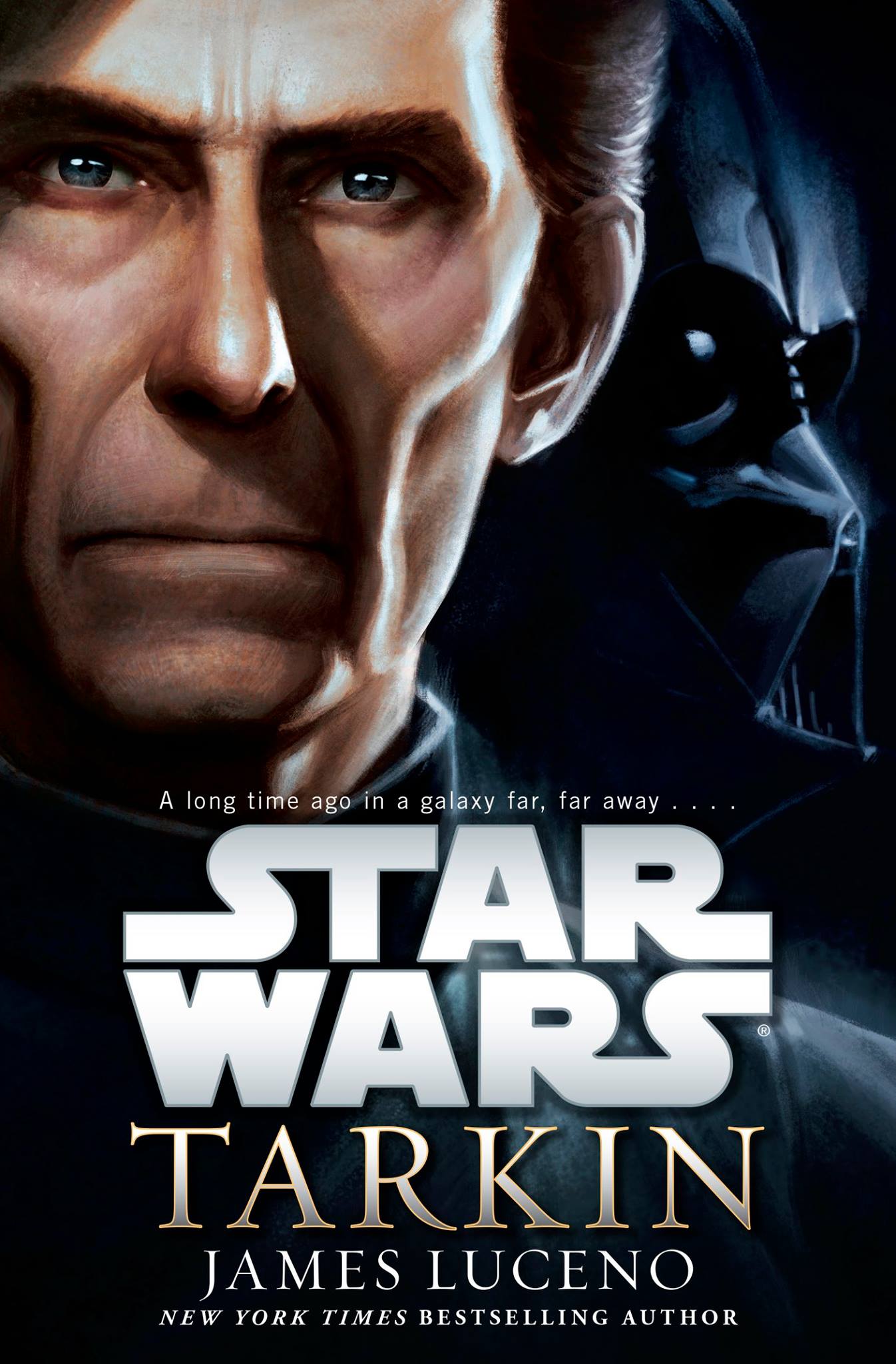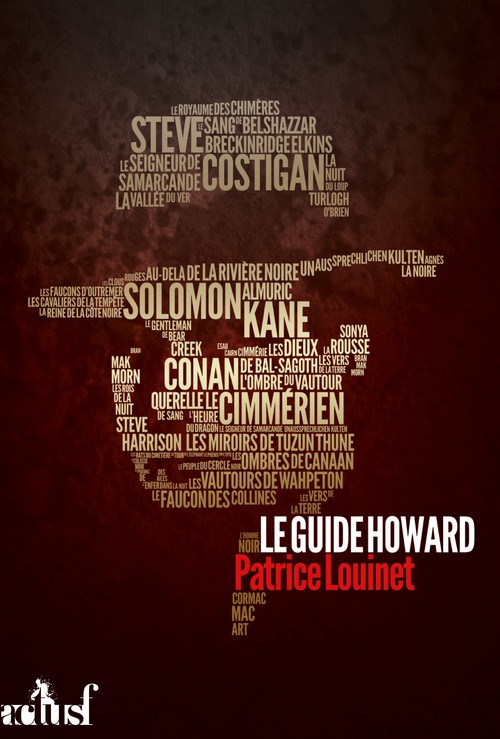Avatars d’une légende d’argile
Catalogue de l’exposition du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme de Paris sous la direction d’Ada Ackermann.

Avec la créature de Frankenstein, le golem est indéniablement le personnage fantastique le plus connu de la culture populaire. Remis au goût du jour au début du XXe siècle par le roman de l’autrichien Gustav Meyrinck et porté très vite à l’écran par Paul Wegener dans une trilogie cinématographique (en 1915 pour le premier, entre 1915 et 1902 pour le second), il a depuis rejoint le monde de la bande dessinée ou des arts plastiques au travers de multiples œuvres. Ce motif n’a cependant jamais perdu son lien avec le judaïsme (chez G. Meyrinck c’est un rabbin de Prague qui est son créateur), et il est déjà question de créer un golem dans le Talmud. Comme figure protectrice, il est parfois après 1960 l’expression d’une résistance juive face à l’Holocauste.
Ce catalogue rassemble de nombreux articles unis par la couleur de l’argile. Il débute par une introduction oxymorique intitulée « Le Golem nous parle ». Oxymorique, puisque traditionnellement, un golem ne parle pas. Puis il se découpe en six parties.
La première partie s’interroge sur ce qu’est le golem. Cette partie s’ouvre avec le poème Le Golem de Jorge Luis Borges (écrit en 1958), précédé de son analyse. Puis suit un article sur les origines du golem puis une étude des illustrations faites en 1916 par Hugo Steiner-Prag pour le roman de G. Meyrinck. L’illustrateur, natif de Prague à la différence de G. Meyrinck, y reproduit les impressions du quartier juif de Josefov avant sa rénovation de la fin du XIXe siècle (qui était un lieu de tourisme folklorique, p. 47) et y campe un golem aux traits asiatiques, fidèle en cela au texte.
La seconde partie explore les différents visages du golem. Elle est inaugurée par un extrait des Oliviers du Négus écrit par Laurent Gaudé, où le golem apparaît comme un esprit de la Terre (une idée reprise à Gershom Sholem), qui se venge à travers lui des blessures qui lui infligent les hommes lors de la Première Guerre Mondiale (p. 57). Dans cette partie, l’antagonisme intrinsèque du golem est dévoilé. Celui qui est une masse informe (et c’est ici l’une des étymologies du mot, comme il en est question plus loin dans le volume), faite d’argile et d’eaux, s’anime quand on inscrit le mot émet (vérité en hébreux) sur son front et redevient de poussière (ou inactif) quand le « e », (qui est un a, alef, éminemment symbolique en hébreux) est effacé pour former le mot « met » (signifiant mort). La première face du golem est sa face protectrice, très présente et même majoritaire aujourd’hui dans les comics, la sculpture, les jeux vidéo comme il l’était dans les films de la première moitié du XXe siècle. Mais le golem peut aussi être un monstre (p. 67), double non plus bénéfique mais maléfique de son créateur, et qui dans certaines représentations peut avoir une connotation antisémite. Mais il peut aussi être un symbole de l’hybris, de la prétention à dépasser Dieu, ou même de la vanité de l’artiste prétendant pouvoir créer un double de lui-même. Cette partie est close par la très intéressante étude d’un tableau de Gérard Garouste inspiré par F. Kafka (et peint en 2011), mettant en scène six personnes léchant un golem sortant d’un baquet.
La partie suivante a pour objectif de faire porter le regard du visiteur et du lecteur sur la plasticité du golem. Elle s’ouvre sur un extrait de texte de Manuela Draeger (La Shaggå du golem presque éternel)où le golem non seulement parle, mais surtout se sent prisonnier de son créateur. A cela s’ajoute que le golem chez M. Draeger devient le gardien du mot qui l’anime mais se révèle en plus être une figure féminine (p. 84). Le cœur de la partie est formé par un article détaillant les formes du golem dans les arts plastiques mais aussi sa relation à l’artiste, entre force déchaînée et transmutation (p. 88). L’inanimé qui s’anime est aussi un thème qui se retrouve exprimé sous forme de golem, avec l’utilisation de vêtements, de poussière, de sang ou de métal ressemblant à du papier déchiré. Mais l’artiste lui-même peut être le matériau de son œuvre (photographique, vidéo), dans l’optique de créer un Doppelgänger, un double (p. 100). L’artiste ou un modèle peut ainsi s’enduire de terre, sortir de terre et parfois ne faire plus qu’un avec sa création.
La quatrième partie reste dans la contemporanéité mais se concentre sur la mutation en s’intéressant à la descendance du golem. Introduit par un extrait commenté du Leviathan de John Hobbes, c’est la machine qui est le thème central (ce qui n’est pas évident à la lecture de l’introduction). Dès les débuts de la cybernétique, le golem est présent comme figure tutélaire et le premier ordinateur israélien est baptisé Golem I (p. 117). N’ont-ils pas le silicium, la bonté et la puissance en commun ? Le robot est indéniablement le fils le plus connu du golem, et lui aussi est porteur de l’ambivalence aide/angoisse, sur laquelle jouent plusieurs artistes. Et rôde le transhumanisme, abandon au aux pouvoirs de l’artifice … Quelques œuvres commentées de Zaven Paré complètent cette partie.
Assez illogiquement, la partie consacrée au lien entre le golem et l’écrit prend place à ce moment-là dans le livre. Encore une fois, un court texte en forme l’introduction, ici un poème de Paul Celan. Puis, l’étymologie du mot golem est mise à contribution (il y a trois occurrences dans la Bible, en II Rois 2, 8, Ezéchiel 27, 24 et Psaumes 139, 16). Le lecteur est entraîné vers un golem comme figure du désir, mais aussi porteur d’une double identité, technique et littéraire. La gematriah (où chaque nom a une équivalence numérique, technique kabbaliste classique) est mise à contribution pour mettre sur un même plan les mots golem, sagesse et l’addition Halakhah + Aggadah (la Loi et le Récit, p. 146). De même, le tserouf (combinaisons de lettres, autre technique kabbalistique) permet aussi à l’auteur de l’article Marc-André Ouaknin de se transporter dans différentes directions, vers Victor Hugo entre autres. La présentation d’une œuvre d’Anselm Kiefer met un point final à cette partie virevoltante.
La dernière partie de ce livre est constitué par les appendices. On y retrouve des repères biographiques, un glossaire fort utile au lecteur peu formé à la mystique juive, une liste des œuvres de l’exposition, une bibliographie et un index. Le texte du catalogue est en outre encadré par deux extraits de bandes dessinées signées Yoan Sfar et Dino Battaglia.
Ce très beau catalogue s’approche grandement de l’exhaustivité, aucune activité humaine liée au golem ne semble avoir été oubliée. Certes, pour des raisons assez évidentes, l’accent est mis sur la peinture et la sculpture et la mystique juive proprement dite n’est que l’arrière-fond, mais cet arrière-fond sait de temps en temps se mouvoir vers le devant de la scène. Les articles sont méthodologiquement bien étayés, et les textes sont, à de très rares exceptions, d’une grande facilité de lecture, avec très peu de redondances (un catalogue ne se lit de toute façon pas comme un roman). Les illustrations, en couleurs, sont d’une grande variété et d’une grande qualité, sourcées comme il se doit.
Cette exposition, et donc conséquemment catalogue, réussit pleinement à montrer la contemporanéité de la figure du golem, même si le contexte qui a fait naître mythe à l’époque moderne (s’inspirant de textes médiévaux, eux-mêmes faisant référence à la Bible et à la Mishnah) est totalement dépassé. Il est peu probable que, avec les évolutions constante de l’intelligence artificielle, la figure de la création humaine s’autonomisant de son concepteur soit amenée à disparaître.
(D. Trump comparé au golem par des journalistes étasuniens p. 23 …8,5)