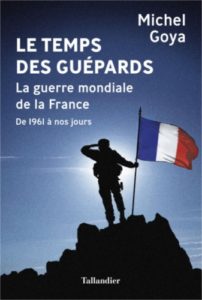Scénarios d’anticipation militaire par l’équipe Red Team.

Dans les simulations militaires, l’adversaire (dénommé Rouge) est appelé à faire preuve de beaucoup d’imagination pour permettre aux Bleus de se préparer au non planifié. Reprenant l’esprit et les noms (tiens, il n’y a plus de loi Toubon?), le Ministère français des Armées a proposé à une équipe de militaires, d’écrivains et d’illustrateurs de réfléchir à divers scénarios prenant place dans les quarante ans à venir. Ces scénarios ont pour cadre des développements dans l’environnement géopolitique de la France, où les forces armées sont impliquées. Si les militaires sont pseudonymisés sur la quatrième de couverture, il y a quelques noms connus du côté des écrivains avec Laurent Genefort et Xavier Mauméjean. Des scénarios élaborés conjointement, quatre sont présentés dans ce court livre de 220 pages, sans que l’on sache qui en sont les auteurs.
Le premier scénario postule l’émergence d’une nation pirate, présente sur toutes les mers du globe et née en partie du refus du puçage généralisé des individus (faisant suite aux premières expériences réalisées lors de l’épisode du covid). Ces pirates en viennent à attaquer le centre spatial de Kourou, mettant en péril l’installation de l’ascenseur spatial français.
Le second scénario reste dans la thématique piraterie, avec l’installation sur les côtes de l’Afrique du Nord (mais pas que) de groupes pirates puissants s’attaquant aux différents navires passant devant les côtes. De naufrageurs ils deviennent aussi hackeurs en s’attaquant à l’interface neuronale qui lie les marins aux embarcations. A tel point qu’un officier se retrouve infecté et fait ouvrir le feu sur d’autres navires d’escorte. Et comme tout est automatisé … La crise de confiance qui en résulte est énorme.
Le scénario suivant se base sur l’existence de différentes bulles de réalité, des espaces sûrs, accessibles aux influences organisées et qui délitent les liens sociaux à grande échelle. La Nation n’existe plus, seules restent les tribus. Le pays le plus touché est la Grandislande et la ville de Grand-City (traversée par la rivière Timide …) fait sécession du pays. Pour évacuer ses citoyens, la France y intervient avec l’Opération Omanyd. Mais en parallèle le contexte sanitaire se dégrade … Beaucoup de défis quand il s’agit de rapatrier 200 000 personnes.
Le dernier scénario du livre met en scène l’opposition entre Troie et la Ligue Hellénique. Une minorité troyenne fait sécession en Thrace et c’est la guerre à coup d’armes hypervéloces. Des hyperforteresses voient le jour, seules à même de contrer ces menaces mais immobilisant les bulles de protection devant les besoins énergétiques et logistiques de tels monstres.
Avec de tels littérateurs dans l’équipe, on était en droit d’attendre des textes bien troussés, ou au minimum bien agencés. Hélas, on est plus dans une suite de notes (sauf le texte sur les carnets d’un ethnologue intégrant la P-Nation qui sort vraiment du lot). Mais la réflexion sous-jacente reste intéressante. Le scénario 1 fait immanquablement penser au film Waterworld, avec des libertaires qui se transforment en organisation armée ou en société post-moderne à tendance woke.
Le second scénario, avec un arrière fond anticolonialiste dans des Etats faillis, bénéficie aussi d’un texte mieux fait avec l’interview de l’initiatrice du mouvement pirate (p. 97). Le troisième scénario nous semble plus capillotracté, avec une sortie des Balkans (à l’unité peu évidente …) de l’Union Européenne sous influence de la Grande Mongolie. Comme dans les deux précédents scénarios, la part dévolue à la sphère informationnelle est très grande, signe que ce qui se passe au Mali et en Centrafrique fait réfléchir. Bon, le covid aussi … Le dernier scénario est le plus abstrait (voire pas clair pour le no man’s land entre les hyperforteresses p. 207). Il développe par contre de belles choses, comme les « murs numériques » qui continuellement rétrécissent (p. 192).
On remarquera de manière générale l’absence dans la sélection d’éléments en rapport avec le nucléaire. La dronisation du monde est par contre très avancées dans tous les scénarios à horizon quarante ans. Présupposé déterminant dans le déroulement des scénarios, le cadre moral reste celui de la fin du XXe siècle. Il est difficile de dire si les auteurs voient en cela une difficulté supplémentaire dans la conduite d’opération.
Facile à lire, avançant par touches dans un cadre chronologique flexible, ce livre de prospective polémologique offre un panorama très large, entre changements techniques et sociaux. Cerise sur le gâteau, l’aspect hard-SF de l’ascenseur spatial fait tout de même rêver. Tout n’est pas vraisemblable au premier abord dans les évolutions proposées, mais l’objectif est atteint.
(l’initiation meurtrière à la P-Nation avec la chanson Il était un petit navire p. 59 … 6)