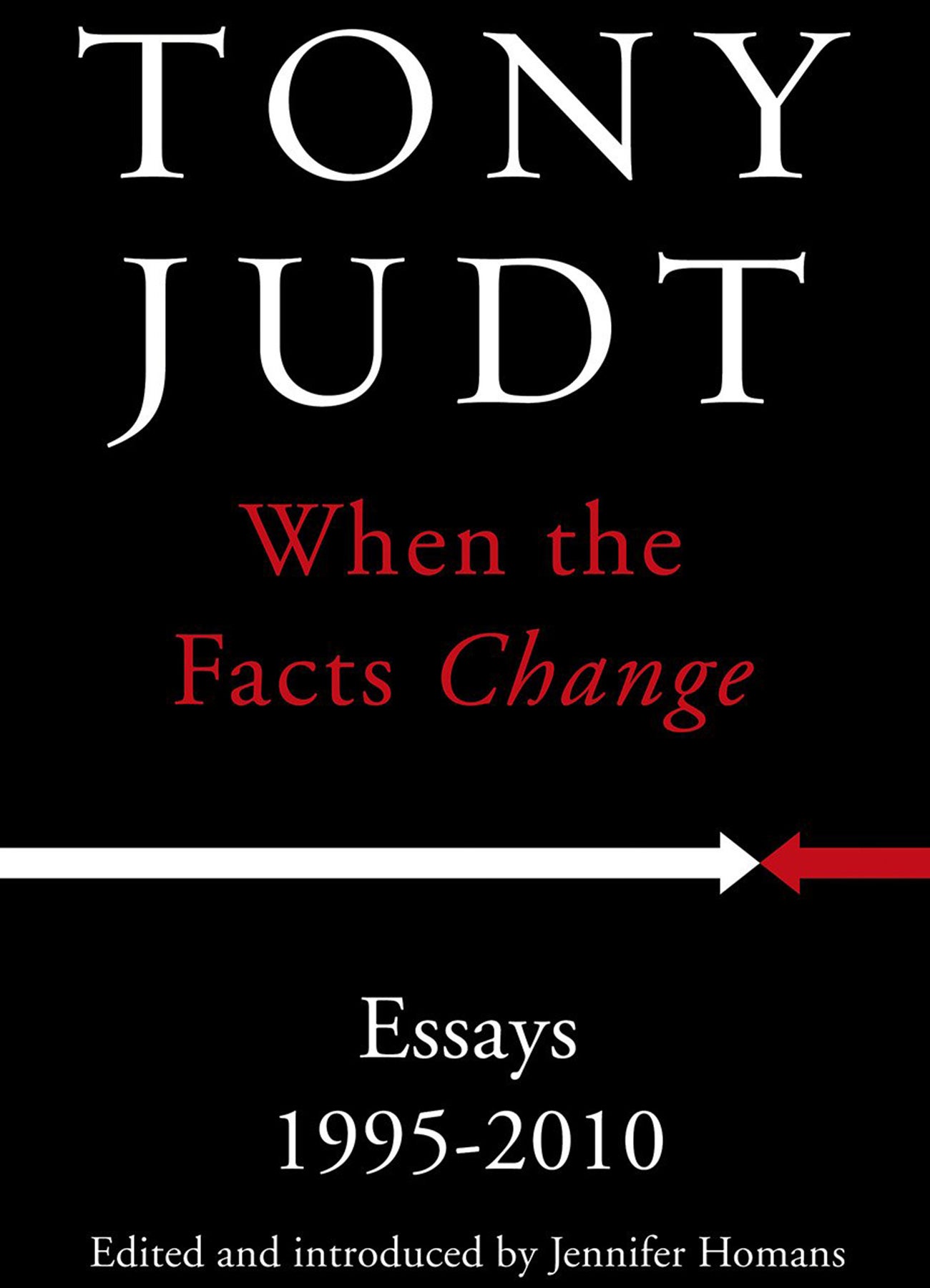Essai d’archéologie étrusco-italique de Joost H. Crouwel.

Le char, ce véhicule doté de deux roues tiré par des équidés où les occupants se tiennent debout, est dans la Grèce homérienne le véhicule des héros sur le champ de bataille devant Ilion ou la grande bataille de Qadesh qui opposa les Hittites aux Egyptiens en 1274 avant notre ère. Mais en Italie qu’en est-il ? Après l’étude des foyers les plus évidents de l’utilisation du char et des autres véhicules à roues de l’espace méditerranéen (Grèce, Chypre, Proche-Orient), J. Crouwel s’intéresse aux véhicules à roues en Italie avant l’Empire romain.
J.Crouwel distingue trois formes de véhicules à roues en Italie avant notre ère. La première est le char, dans la définition que nous avons donnée plus haut. La seconde est la carriole, avec deux roues mais où le ou les occupants sont assis. Puis enfin la forme la plus rare au vu des fouilles, le chariot, avec ses quatre roues et ses occupants normalement assis ou allongés.
Au niveau des chars, l’auteur dégage six types dans sa première partie, selon l’architecture de la caisse. Le premier type a par exemple une forme de U (à partir du VIIIe siècle), tandis que le second type est de forme triangulaire, le troisième type de forme rectangulaire, le quatrième semble être démuni de partie avant mais avec une caisse rectangulaire. L’axe des roues ne permet lui que deux variantes : soit c’est l’axe entier qui tourne avec des roues fixes, soit c’est seulement les roues qui tournent. Pour ce qui est des chars, la seconde solution est privilégiée à cause des besoins qu’impliquent un minimum de vitesse et les virages. A la différence des chars assyriens ou égyptiens, cet axe ne se situe sous l’arrière de la caisse mais au milieu (ce qui en modifie l’équilibre et donc l’usage que l’on peut en faire). Les roues (de l’axe fixe) sont à rayons, ces derniers pouvant aller jusqu’à dix, avec un tenon métallique pour les empêcher de quitter leur logement. Le système de traction forme la quatrième partie de cette analyse du char dans l’Italie pré-impériale, avec tout d’abord le timon (la longue pièce de bois qui doit supporter la tension de la traction) puis la liaison entre le timon et la caisse. Le harnachement est exploré dans la partie suivante, avec une description des différents jougs employés (même quand il y a quatre chevaux, comme dans le cas d’un quadrige, seuls deux sont harnachés p. 39), puis l’auteur passe à la description des moyens de contrôle : mors d’un seul tenant ou articulé, en métal ou en matière organique, le harnais, les rênes, les fronteaux et enfin la cravache et le fouet.
De toutes ces observations, s’appuyant à chaque fois sur des découvertes archéologiques ou des représentations, conduisent à la définition d’un usage, détaillé à la fin de cette partie. Pour ce qui est du char tiré par des équidés, sa présence remonte en Italie au XIe-Xe siècle avant notre ère (des miniatures dans le Latium, p. 52). Son usage est limité par le relief italien, où seule la plaine du Pô permet un usage extensif. Cet usage est militaire, mais ne sert pas de plateforme de tir pour un archer (comme en Mésopotamie, avec une description tactique p. 53-54), puisque sa largeur est insuffisante pour permettre d’avoir un conducteur et un tireur de front. De plus, aucune flèche ni carquois n’ont été retrouvés. C’est donc un véhicule qui sert à la noblesse à se déplacer à la guerre (comme dans l’Iliade) ou lors d’évènements civiques et qui est la marque d’un statut (p. 108), coûteux à entretenir (c’est pourquoi on en retrouve dans les tombes). Le fait de combattre de manière rapprochée, mais à partir d’un char, est elle aussi exclue (p. 58). Si l’influence grecque n’est pas absente dans l’architecture des chariots, l’auteur penche pour une introduction du char en Italie par le Nord et la Celtique (p. 101). Enfin, J. Crouwel évoque le char comme véhicule pour l’au-delà et comme véhicule de sport dont la postérité court jusqu’à l’époque byzantine (p. 64-69).
Le troisième chapitre passe aux carrioles. J. Crouwel en dénombre deux types. Puis, comme à propos du char, l’axe, les roues, le système de traction, le harnachement et les moyens de contrôle sont détaillés. Le seul usage prouvé de la carriole est le transport de personnes, assises ou allongées. La carriole se déplace lentement, avec les occupants non armés (des processions, des scènes de mariages, avec ou sans divinités). Elle peut être conduite par un homme à pied ou depuis son bord. Un parasol ou un pare-soleil accroché à la carriole peut être un symbole de statut. Si deux bovins forment l’attelage (comme le montre des modèles réduits, p. 88), un transport de biens (agricoles ?) peut être envisagé.
Les chariots sont les véhicules dont on a retrouvé le moins d’exemplaires mais il en est quelques représentations en Etrurie et en Lombardie (p. 89). L’auteur procède comme aux chapitres précédents. En plus de servir au transport assis ou allongé de personnes, il n’est pas exclu que le chariot ait aussi pu servir de corbillard (p. 95). Le transport de biens dans un chariot ne s’est développé en Italie qu’à la période impériale.
Si dans le premier chapitre J. Crouwel avait détaillé le contexte de sa recherche (le terrain et les routes, les animaux de trait), le dernier chapitre est celui des remarques conclusives, en forme de résumé. Il y est notamment question du sexe des personnes inhumées avec véhicules (il y a plus d’homme inhumés avec un chariot que de femmes, p. 105), où tout n’est pas assuré. Mais la pratique d’ensevelissement avec des véhicules semble avoir une origine locale (p. 104), à mettre en parallèle avec l’émergence d’une élite et la construction de tombes plus grandes, où il peut y avoir ensemble plusieurs types de véhicules (p. 102). L’auteur n’a pu réussir à distinguer un processus de développement au sein des chars et penche pour la contemporanéité de plusieurs types. Le type I est le plus nombreux, apparaissant au VIIIe siècle et devenant le prototype du char de course romain (p. 108).
Deux appendices complètent ce volume, le premier sur les véhicules à roues dans l’art des situles (des seaux en bronze décorés) et le second portant sur les chars celtiques. Une ample bibliographie, 80 pages d’illustrations et un index donnent à ce livre sa complétude.
J. Crouwel n’est pas un spécialiste de l’Italie (p. 63 sur Orvieto en Toscane), ni de sa langue (p. 90 par exemple), et cela se voit par moments (les différentes graphies de l’Ara della Regina à Tarquinia), mais le travail présenté n’en est pas moins remarquable. La masse documentaire est très grande, éparpillée à la fois dans le temps et dans l’espace. Pour mener à bien ce travail, l’auteur s’est appuyé sur ses connaissances dans les véhicules antiques autour de la Méditerranée mais aussi, ce qui est fondamental, sur l’archéologie expérimentale (p. 53). De nombreuses questions, que le lecteur se pose peu par lui-même il faut bien l’avouer, trouvent une réponse dans ce livre. Le chariot n’en par exemple pas le moyen terrestre le plus utilisé pour transporter des biens : la force humaine ou les animaux de bât lui sont de très loin préféré, même sur des routes romaines pavées. Ce même chariot peut aussi être tiré à bras (p. 94). Autre découverte, il n’y a pas de frein sur les carrioles, ce qui peut poser de sérieux problèmes en pente (et l’Italie centrale n’en manque pas, p. 85). La question de l’absence de fer à cheval aurait peut-être mérité un peu plus de développement (p. 97) puisque les auteurs romains parlent d’hipposandales (mais uniquement à la période impériale ?).
Les illustrations, monochromes, sont évidemment obligatoires dans un tel livre et elles sont très nombreuses (il y a aussi une carte avec les sites de découvertes des artéfacts). Il manque cependant un tableau récapitulatif des différentes formes de caisses, de jougs etc. pour chaque type de véhicule, avec chaque fois en regard une illustration-type. La présentation des types pourrait être ainsi bien plus claire. Le glossaire en début de volume est, pour tout lecteur d’ordinaire un distant du sujet, irremplaçable.
La lecture de ce livre nécessite une attention soutenue, à cause principalement de son aspect très technique, voir même aride. A ne pas mettre en toutes les mains, même si son pouvoir de clarification sur le sujet du déplacement terrestre dans l’Italie antique est très important, tout en étant beaucoup plus archéologique qu’historique.
(le char celte de Grande Bretagne peut être doté de suspensions p. 112, comme une Rolls Royce … 7,5)